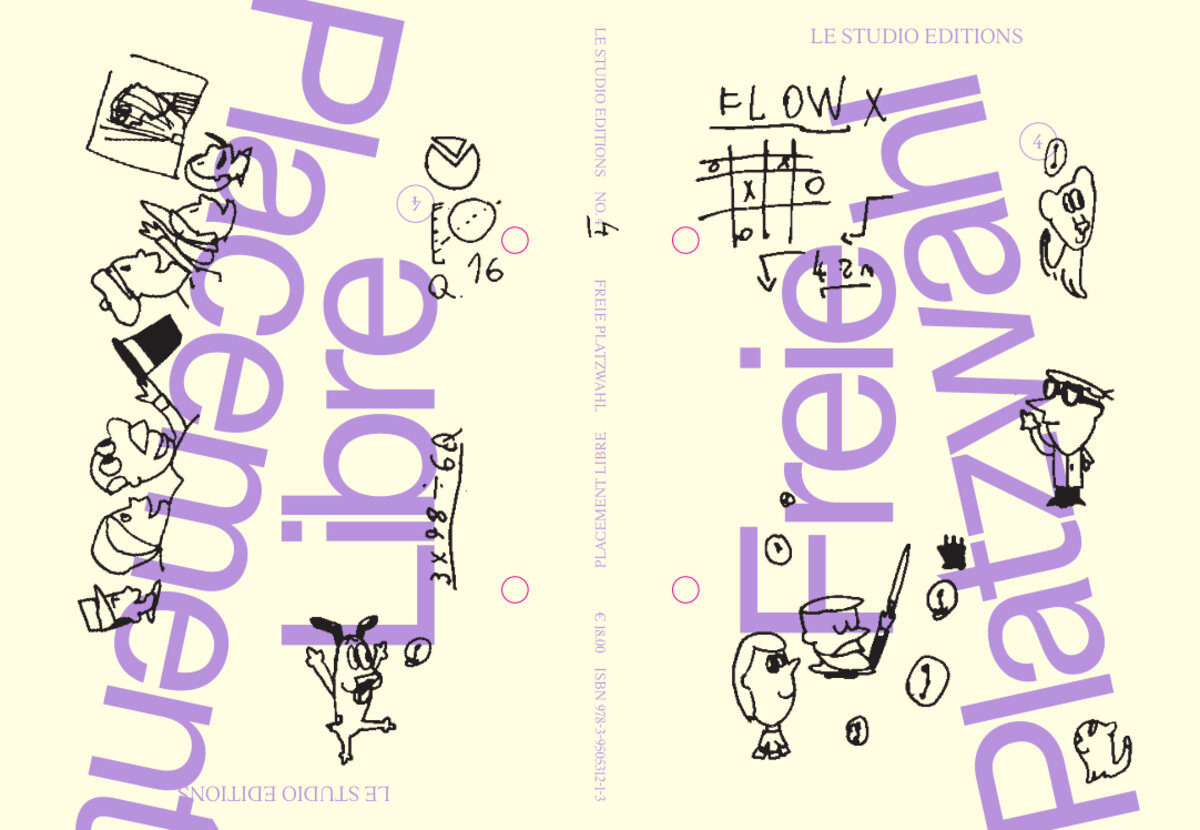
Agrandissement : Illustration 1
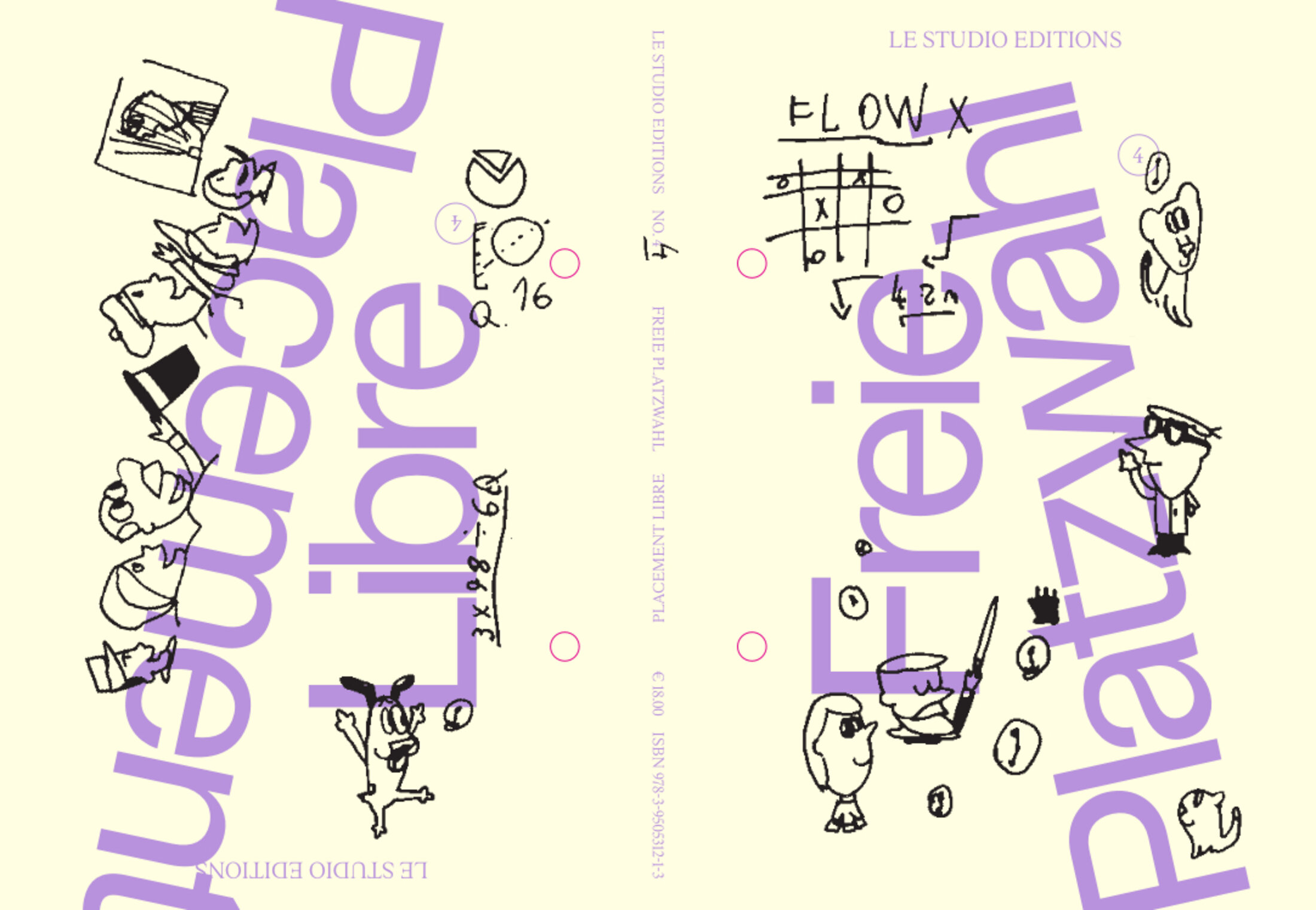
J'encourage vivement chacune et chacun à vous procurer cet ouvrage, très bel objet au demeurant, qui mérite la lecture. Ouvrage coordonné par Julien Bancilhon, psychologue à l'Hôpital de Jour d'Antony, rédacteur en chef du Papotin, musicien et membre du collectif La Belle Brute, et Julie Tapastau, animatrice socio-culturelle au groupe d'entraide mutuelle (GEM) La Maison de la Vague à Paris, association accueillant des personnes ayant connu des difficultés d'ordre psychique.
Avec des contributions de Julie Tapastau, Julien Bancilhon, Lise et Adah Lendais, Hanna Binder, Alex Bailey, Susanne Songi Griem, Corinne Eckenstein, Jérôme Albagli, Isabelle Pham, Tristan Tréjo, Julien Selignac, Camille Louis et Claire Doyon. Information ici : Edition No.4 — LE STUDIO Film und Bühne
L’ACCESSIBILITÉ NE SE DÉCRÈTE PAS, ELLE SE VÉRIFIE
Avant-propos non-consensuel
Probablement que la question des handicaps, qu’ils soient sensoriels, moteurs, mentaux ou psychiques, n’a jamais été aussi discutée que ces vingt dernières années[1]. Les enjeux qui y sont liés, qu’ils soient professionnels, économiques, matériels, institutionnels ou administratifs sont désormais des sujets présents dans l’espace public. Pourtant, paradoxalement, si l’opinion s’avère convaincue de la nécessité d’offrir un accès aux mêmes droits et services à tout un chacun et que les politiques publiques s’engagent à garantir la participation à la vie en société de toutes et tous, les témoignages des premiers concerné.e.s, en leur nom ou en collectif, nous rappellent combien la réalité vécue est immensément éloigné de l’horizon égalitaire souhaité. C’est de ce paradoxe que ce texte s’origine. De l’étrange discordance entre un discours officiel n’ayant de cesse la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées et le sentiment quotidien que, dans les faits, les obstacles, qu’ils soient physiques ou relationnels, sont encore permanents. Alors, avant de proposer une lecture de ce qui nous semble être les ressorts d’un aménagement égalitaire des espaces communs, revenons sur quelques éléments paraissant naturellement consensuel mais qui, parfois, risquent de masquer quelque peu des débats nécessaires.
Le terme handicap semble avoir toujours défini cette réalité vécue par des personnes dont l’altération de certaines fonctions (sensorielles, physiques, mentales ou psychiques) entraine la limitation d’activité ou la restriction de participation à la vie sociale. Pourtant cette catégorisation a une histoire[2]. Elle réunit en un ensemble des conditions d’existence qui, en d’autres temps ou d’autres lieux, n’auront pas été pensées comme rassemblées. La mesure du handicap se fait à la mesure du taux d’invalidité, c’est-à-dire à sa capacité à travailler, soit à son employabilité. Cette façon de « constituer une population » correspond à une époque, la première guerre mondiale, et la naissance des premières rééducations des blessés et mutilés pour leur permettre un retour à l’activité, aussi adaptée soit-elle, dans une période où la main d’oeuvre manquait cruellement dans l’industrie de l’armement ou l’administration par exemple. Là où, jusqu’alors se distinguaient les valides (aptes au travail) et les invalides (non-aptes au travail), la possibilité de rééduquer et de réadapter des blessés a ainsi bouleversé les catégories et les représentations, par le mariage de la médecine et du travail[3].
Le handicap constitue un nouveau regard sur des vécus vulnérables par le prisme de ce couple médecine/travail, là où la psychiatrie s’organisait sur un autre, parallèle, entre la médecine et la sûreté[4]. Le handicap s’organise donc autour de la norme travail, là où la psychiatrie s’organise autour de la norme comportementale. L’accompagnement dans le champ du handicap vise donc, par la rééducation, la réadaptation et les principes de compensation à retrouver une place dans le monde du travail, tandis que la psychiatrie vise le rétablissement d’un certain équilibre vivable (et normalisé) des conduites.
À l’aube de ce siècle, la fédération des usagers, la FNAPSY (Fédération nationale des associations d’usagers de la psychiatrie), et celle des familles, l’UNAFAM (Union nationale des familles et amis de malades mentaux) avaient uni leur force pour faire reconnaître la notion de handicap psychique jusqu’à l’inscrire dans la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. Ces conditions psychiques quittaient donc les représentations de la maladie vers celle du handicap, sans préciser que ces distinctions ne se remplacent pas, puisque, dans la définition même du handicap psychique, on reconnait ce handicap comme la conséquence d’une maladie psychique, sans déficience intellectuelle reconnue. Pas de ou, mais un et. Cependant, en précisant bien que ce que ces évolutions ont apporté au sujet du droit des concernés n’est pas du tout à minimiser, ce qui fit événement, c’est un certain déplacement d’un prisme normatif à un autre, du registre des conduites à celui de l’employabilité. Disons juste, de façon peut-être un peu expéditive, que l’époque consacre en priorité l’inscription des individus dans la sphère citoyenne par le travail et l’activité. Phénomène que l’on entend dans ces autres termes consensuels que sont l’insertion professionnelle pour les adultes et l’inclusion scolaire pour les enfants.
Qui pourrait décemment s’opposer à l’inclusion scolaire ? Qui pourrait raisonnablement affirmer qu’un enfant porteur de handicap n’a pas sa place à l’école ordinaire ? Là est la logique consensuelle, d’empêcher toute complexification des problématiques auxquelles nous avons à faire face. L’inclusion, vous êtes pour, ou vous être contre. Mais de quoi s’agit-il au fond ? Une chaise dans une classe ordinaire, au risque de ne s’y assoir qu’une heure par jour ? Un accompagnement humain personnalisé (de type Assistant de Vie Scolaire) dans un contexte ordinaire ? Une réorganisation des apprentissages basée sur les capacités et les forces pour chacune et chacun, quelque soit ses particularités ? Une adaptation pédagogique aux compétences de l’enfant et l’organisation d’une socialisation et d’échanges sur d’autres espaces éducatifs, créatifs ou ludiques ?
L’inclusion scolaire peut avoir des visages bien différents, et rien ne dit, si l’on en précise pas les contours, qu’elle offre, en soi, une quelconque émancipation au sujet concerné. La scolarisation ordinaire peut rejouer une logique discriminatoire au sein même du principe d’inclusion, en organisant systématiquement des adaptations fonctionnelles ou pédagogiques, comme elle peut être vectrice d’un profond soutien à certains s’appuyant sur l’imitation des pairs. Ainsi quand une déléguée interministérielle française chargée de la mise en œuvre de la « stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-développement » annonce qu’aucun enfant n’est laissé « sans solution », elle omet de détailler les solutions proposées et la réalité quotidienne vécue par de nombreuses familles : des enfants à peine accueillis quelques heures par semaine, la nécessité de quitter son emploi pour l’un des parents, des horaires aménagés sur les temps « non-pédagogiques », des AESH peu formés, mutualisés et parfois débordés, des confrontations à des évaluations inadéquates, des conditions sensorielles non-prises en compte, etc. L’étendard de l’engagement vers l’inclusion la plus généralisée, porté alors avec force, vient, dans le consensus ambiant, rendre invisibles les inégalités flagrantes que cette même inclusion peut générer si ses fondations ne sont pas profondément définies à l’aune du vécu et de l’avis des concernés.
L’accessibilité à la culture
Ce préambule nous permet à présent de réfléchir au sujet de l’accessibilité à la culture. Il suffit d’entrer ces mots « accessibilité culturelle » ou « accessibilité à la culture » dans un moteur de recherche quelconque et découvrir l’uniformité des définitions et des sujets qui s’y rapportent dans leur immense majorité. On y comprend que c’est un droit inscrit dans la loi ; qu’il est nécessaire de favoriser l’accès à chacune et chacun ; lever les blocages et de réduire les fractures dans le vivre-ensemble. S’engager pour et vers l’accessibilité de toutes et tous à la culture est donc une évidence. Encore faut-il savoir de quoi nous parlons.
L’accès, tout d’abord, procède-t-il d’une logique physique ou plus largement d’une réalité sensible ? Il est particulièrement fréquent de voir traiter le sujet de l’accessibilité par le prisme du bâti, dans ses dimensions architecturales ou d’équipements (Y a t-il une rampe d’accès ou un ascenseur ? Des signalétiques adaptées ? Des places de stationnements réservées ? Des sanitaires accessibles ? etc.). Question première si l’en est, bien évidemment, mais peut-être non-suffisante. Anne-Lyse Chabert nous en donne un aperçu dans son texte « L’accessibilité n’est-elle qu’une question de porte large et de logo handicap ? »[5] où elle apporte son témoignage de personne en situation de handicap moteur au travers de son activité de natation dans trois piscines parisiennes différentes, en y précisant les variations du vécu de l’accueil ainsi que ses liens avec l’environnement et l’équipement adapté proposé. On y lit combien la simple mise aux normes techniques d’accessibilité ne fait pas d’un lieu recevant du public un lieu accueillant pour les personnes concernées. L’accessibilité, pour être effective, d’un lieu, d’espace, d’un territoire, nécessite des conditions « vivables » ou non uniquement « viables »[6], à entendre comme techniquement faisables.
Quant à la Culture, là aussi, nous pouvons nous demander de quoi nous parlons. La culture est un mot particulièrement polysémique. Parler de son accessibilité nous entraîne de fait sur des chemins distincts. Dans un premier temps, il semble que l’on entende facilement la notion d’accessibilité culturelle comme l’accès à des oeuvres ou des pratiques culturelles entendues comme artistiques, la possibilité d’aller voir un film en salle de cinéma, une exposition au musée, une pièce au théâtre, un concert, les oeuvres littéraires etc. Cela peut s’élargir plus largement au patrimoine à toutes les propositions d’informations et de médias (papier, radio, tv et numérique). On garde là cette notion de rencontre physique avec les oeuvres — les biens culturels — prenant en compte la dimension de la circulation et d’une adaptation si nécessaire, pédagogique voire technique. Mais nous pouvons entendre le signifiant culture de façon élargie comme le socle commun des manières de penser et d’agir qui construisent la formation d’une collectivité. On entend alors parler de culture comme civilisation, « la culture judéo-chrétienne », « la culture chinoise » mais aussi comme phénomène d’identification collective « la culture Punk », « la culture Skate » ou « la culture Queer ». Par ce prisme de lecture, l’accès à la culture prend un autre sens. Il s’agirait là de donner accès à un univers symbolique partagé. Dans cette acception précise, on pourrait comprendre le désir décidé d’une communauté, jusque dans ses décisions politiques, de défendre l’accès à LA culture, comme un désir de solidifier ce socle de manières de penser, de sentir et d’agir auprès de tous ses membres, y compris, celles et ceux qui y logeraient dans les marges, pour des raisons majoritairement involontaires. On comprend là que l’expression « culture pour tous » peut s’entendre diversement. Nous ne parlons donc pas exactement de la même chose quand nous évoquons l’accès à des biens culturels (aussi divers soient-ils) offrant une acquisition individuelle de savoirs et rendant le sujet plus ou moins « cultivé », et l’accès aux représentations caractéristiques du mode de vie d’une société, d’une communauté ou d’une groupe, offrant au sujet des « habilités sociales » partagées.
Au-delà de la culture, la pratique
Si nous souhaitons aborder la culture comme la source d’un savoir appropriable par l’individu, soutenant sa construction subjective, jusqu’à consolider la formation de son esprit critique, alors son accès ne peut se résumer à sa simple mise en présence. Être face à une œuvre, un film, une pièce ou une installation ne suffit pas à faire rencontre. Au contraire même, elle peut générer un certain malaise si les circonstances ne sont pas accueillantes. Et cet accueil concerne aussi bien les conditions physiques objectives, l’hospitalité du lieu et ses hôtes, que la capacité d’accepter les personnes dans leur singularité, c’est-à-dire leur propre rapport sensible à ce qui est présenté comme la culture commune. On pourrait donner bien des exemples de situations où un public ne se sent pas à sa place dans des espaces ou des événements culturels qu’il ressent comme ne lui étant pas adressé. Où le vécu singulier de l’expérience ne saurait être reconnu comme légitime. La confrontation à des oeuvres d’art, qu’elles soient classiques ou contemporaines, visuelles ou vivantes pourra alors avoir des effets dépréciatifs pour le sujet. Si l’accessibilité à la culture est vécue comme une mise à disposition de biens dont on ne peut être que le spectateur passif, elle pourra dans certains cas ne faire que redoubler la stigmatisation qu’elle dit combattre. Du sentiment que l’on n’est pas à la hauteur de ce à quoi l’on assiste, on réprime tout un ensemble d’affects — qui pourraient même être d’ennui, de colère ou de désintérêt — pour ne garder que la gêne de « n’avoir rien ressenti ». Sous-entendu de n’avoir pas compris la dimension savante du créateur.
Au contraire, si on considère la culture comme une activité, c’est-à-dire pas uniquement dans la passivité de sa réception, mais comme un ensemble de pratiques qui concernent tout un chacun dans ses capacités créatrices et productrices, alors cela crée un écart. La culture « devient source et produit de la culture de soi, de la transformation de soi, car on ne se transforme jamais mieux comme sujet qu’en transformant des objets — surtout culturels »[7]. Dès lors on ne souhaite plus l’accès à la culture mais davantage l’accès aux pratiques culturelles (auxquelles d’ailleurs on préférerait le terme de pratiques de création). Et c’est d’un autre point de vue que l’on aborderait même cette question de l’être-spectateur qui peut en elle-même être une pratique que chacune et chacun apprivoisera à sa façon, à condition d’y être a minima autorisé-e. Si la façon personnelle d’apprécier une oeuvre vaut celle du voisin en ce qu’elles sont des expériences sensibles singulières et qu’elles sont chacune considérées comme valables, alors une certaine égalité des places se percevra[8].
C’est donc une question d’agir, de faire. Et cela n’est jamais plus manifeste que dans la pratique elle-même.
L’art et les Pratiques Brutes
Avec la mise en lumière des oeuvres de créatrices et créateurs vivant radicalement isolé(e)s de leurs communautés, du fait de leur internement en asile psychiatrique, de leur enfermement carcéral ou de leur grand éloignement rural, l’émergence de l’Art Brut, tel que Jean Dubuffet l’a nommé à la Libération, est susceptible de nous intéresser à plus d’un titre. Tout d’abord, repérons que Dubuffet, cherchant à définir une sorte d’ensemble cohérent sous ce signifiant art brut, et ne voulant pas le réduire à « l’art des fous », parle d’ « ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique »[9]. Nous avons donc affaire là à des personnes peignant, sculptant, brodant, écrivant, sans y avoir été initiés. Mais force est de constater qu’ils n’étaient pas indemnes de culture commune tant on voit dans leurs oeuvres la percussion de leur présent (les guerres, les évolutions technologiques, les figures historiques etc.) ainsi que leur connaissance des matériaux. On observe d’ailleurs que plus les techniques d’information et de communication envahissent le paysage, plus ces pratiques spontanées de non-initiés nous offrent comme une véritable relecture voire une digestion de la pop culture dans laquelle ils baignent. L’Art Brut a ceci de singulier qu’il a désormais ses musées propres ou ses galeries ; il a donc intégré dans ses grandes largeurs l’univers culturel et se pose dorénavant la question de savoir comment se rendre accessible aux publics sensiblement proches des autrices et auteurs des oeuvres accrochées. C’est peut-être là la distinction entre l’art brut et les pratiques brutes, entre un intérêt d’origine pour des oeuvres dans le premier cas, et dans une certaine manière d’accompagner le faire et l’agir dans le second.
Quand, au moment d’organiser un colloque à ce sujet[10], nous avons, avec quelques amis, fait le choix de parler de Pratiques Brutes de la Musique plutôt que de Musiques Brutes, c’était pour mettre la focale sur la logique active, sur le vivant de la pratique qui prime sur le résultat. Nous entendons par « pratiques brutes » ces manières spontanées d’aborder le sonore dans sa matérialité. De l’attraper comme une substance avec laquelle on entre en expérience pour en fabriquer des formes à soi. La technique est accessoire mais l’implication sensible y est cruciale. Parce que l’authenticité des affects en jeu sera le point d’écho chez l’autre, qu’il soit musicien à ses côtés ou spectateur à ses pieds.
Dans mon travail en pédopsychiatrie, je croise très régulièrement des enfants qui se passionnent et s’animent avec les instruments dans ma salle. L’amplification du micro, les effets branchés dessus, les claviers, les batteries électroniques, les jeux de delays diffractant le rapport habituel du geste au son dans l’espace. Le corps collé au enceinte pour certains, les cellules rythmiques même rudimentaires répétées sans sourciller pendant des temps inconsidérés, les cris modulés en mélodies bouclées, les saturations recherchées pour voir la surface vibrante animée du haut-parleur tressaillir comme si elle vivait. Et toutes ces façons jubilatoires de plonger dans le son nous rappellent celles des artistes des arts sonores expérimentaux, abordant le bruit avec la même jubilation et des gestes similaires, parfois juste mieux maîtrisés.
Avec cette proximité reconnue des passions quasi-sensorielles, en-deçà des exigences techniques ou des canons culturels, on comprend l’intérêt que se croisent ces acteurs reconnus de l’expérimentation sonore avec des personnes rencontrées dans nos espaces d’accueil et d’accompagnement aux intérêts communs. Ces rencontres, en l’occurence, sont nombreuses et existent un peu partout, mais souvent isolées les unes des autres et rarement reconnues par les institutions dans lesquelles elles ont lieu. Parce qu’elles sont difficilement évaluables autrement que par la joie qu’elles procurent. Or, cette joie est la confirmation de la qualité de l’échange. Elle lie des sujets et engage du lien social. On n’imagine mal, sauf à vouloir demeurer aveugle à ce qui tient lieu de moteur chez chacun, ne pas favoriser ce genre de rencontre et les faire évoluer, comme on complexifie toute connaissance. C’est comme ça que le groupe Astéréotypie composé de quelques jeunes autistes de l’IME de Bourg-La-Reine, né d’un simple atelier d’écriture, devint véritable groupe le jour où leur éducateur brancha sa guitare et proposa la mise en corps des textes, jusqu’à faire le tour des salles et des festivals de rock de France en 2022. Comme ça qu’un groupe comme les Harry’s part en tournée avec des jeunes autistes improvisateurs parfois non-verbaux. Comme ça que les deux chanteurs porteurs de trisomie 21 du groupe Les Choolers se vivent en artistes et plus en travailleurs handicapés.
Nous parlons là de la musique, mais la logique s’applique à tout champ d’intérêt, à toutes passions. Ce qui importe c’est d’accuser réception des branchements existants au monde des personnes que l’on côtoie. De repérer ce qui les anime et de créer les conditions nécessaires pour alimenter cet appétit. De donner accès à des expériences sensibles qui motive à la rencontre et à une envie d’encore. L’épanouissement qui peut s’y produire a une force incommensurable. C’est quand les corps des uns et des autres résonnent autour de passions communes que les assignations s’estompent et qu’une certaine indifférence[11] des rôles et des places s’immiscent dans les rapports.
Nous pourrons donc mettre toutes les rambardes que l’on veut, baisser le volume des hauts-parleurs[12] ou se présenter comme neurodivers-friendly, nous rendrons peut-être des espaces culturels accessibles, ils n’en seront pas pour autant accueillants. Mais la culture si elle est vivante ne se joue pas que dans les musées ou sur les scènes officielles, elle se loge partout où les pratiques de création se produisent et se renouvèlent. C’est peut-être alors là que peuvent s’expérimenter de véritables rencontres culturelles. Si rendre accessible la culture c’est donner la possibilité de se l’approprier, alors cela ne se décrète pas, cela se vérifie dans les actes.
[1] La loi du 2 janvier 2002, dite Loi 2002-2 rénovant les secteurs de l’action sociale et médico-sociale en soulignant tout particulièrement la promotion du droit des usagers puis celle du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, sont à ce propos des marqueurs clés.
[2] à ce propos, nous encourageons à la lecture de la thèse de philosophie de Stéphane Zygart, « Les handicapés et les autres, réadaptations et normes médico-sociales », publication prochaine aux Presses Universitaires de La Sorbonne.
[3] « la rééducation professionnelle des blessés et mutilés est devenue une nécessité inéluctable quand, après les premiers mois des hostilités, il est apparu que le nombre des victimes de la guerre serait effroyable. D’une part affaiblissement considérable de la main-d’œuvre valide, d’autre part accroissement considérable des non-valeurs sociales ». « Les cadres que nous avions donnés à l’assistance, craquent, étroits et vermoulus, sous la formidable pression d’une nécessité inconnue jusqu’alors. Il ne faut pas seulement secourir les individus, il faut aussi refaire les éléments de la vie active du pays, et cela, non pas après les hostilités, mais en pleine bataille » A.-L. Bittard, Les écoles de blessés, pensions, prothèses, apprentissage, placement, Paris, Alcan, 1916 p. 45-46 et II-III, cité part Stéphane Zygart dans sa thèse.
[4] Une Hospitalisation d’Office (HO) reste une décision du préfet sur indication médicale par exemple.
[5] Chabert, A.-L. (2016) « L’accessibilité n’est-elle qu’une question de porte large et de logo handicap ? » in Ethique. La vie en question, avril. 2016. Accessible en ligne ici : https://revue-ethique.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/revue-Ethique/articles/L_accessibilite_Chabert_version_corrigee_2_01.pdf
[6] la distinction viable/vivable est inspirée du dialogue entre Judith Butler et Frédéric Worms publié sous le titre « le vivable et l’invivable », Presses Universitaires de France, collection Questions de Soin, Paris, 2021
[7] Sébastien Charbonnier, « Culture commune versus émancipation ? Les effets pervers de la colonisation des auteurs philosophiques », Carrefours de l’éducation, édition Armand Colin, 2012/1, n°33, p.129
[8] « une organisation du sensible où il n’y a ni réalité cachée sous les apparences, ni régime unique de présentation et d’interprétation du donné imposant à tous son évidence. c’est que toute situation est susceptible d’être fendue en son intérieur, reconfigurée sous un autre régime de perception et de signification. Reconfigurer le paysage du perceptible et du pensable, c’est modifier le territoire du possible et de la distribution des capacités et des incapacités ». Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique éditions, 2008, p.55
[9] Jean Dubuffet, L’art brut préféré aux arts culturels, 1949 (Manifeste accompagnant la première exposition collective de l’art brut à la Galerie Drouin, reproduit dans Prospectus et tous écrits suivants, Gallimard, 1967)
[10] Les Rencontres Internationales autour des Pratiques Brutes de la Musique, dont la première édition eut lieu en 2017, se tiennent tous les ans dans le cadre du Festival Sonic Protest (Paris et banlieue).
[11] « le but du jeu, c'est qu'il y ait une indifférence qui s'installe entre les valides et les invalides – mais c'est très difficile pour deux raisons. La première, c'est que les rapports de soin et de prise en charge sont dissymétriques : il y en a un qui soigne et l'autre qui est soigné, il y en a un qui prend en charge et l'autre qui est la charge – au moins c'est clair... même si c'est brutal. La première difficulté donc c'est le caractère dissymétrique, la deuxième c'est que même quand il n'y a pas de soin et que vous ne prétendez pas soigner la personne handicapée, il y a ce qu’on appelle le stigmate ou le caractère liminaire des personnes handicapées ». Stéphane Zygart, Qu’est-ce qu’intervenir ? les Nouveaux Cahiers Pour la Folie n°11, éditions EPEL, 2020, p.22
[12] Nous nous rappelons du coup de communication de l’enseigne Carrefour se vantant d’être les premiers à mettre en place une « heure silencieuse » à destination du public autiste. Une heure à la luminosité réduite, la musique et les annonces coupées et la priorité en caisse. Une heure proposée les lundis entre 14h et 15h…



