Dans les réflexions critiques sur le front de nos servitudes numériques, il semble que la fascination intellectuelle exercée par l’architecture invisible algorithmique nous masque ce qui est devant notre figure, je veux dire littéralement.
Dans son essai The Game, l’écrivain Alessandro Barrico revenait sur l’année 2007 où Steve Jobs présenta le premier Iphone lors d’une des incontournables keynotes d’Apple. Barrico décrivait l’effet que déclencha l’objet sur l’assemblée : un frisson, un Waouh contagieux. Car avant même de l’avoir entre les mains et d’en faire usage, tout le monde en percevait la promesse. Il ne s’agissait pas d’un objet nomade à fonction unique, comme l’avait été par exemple l’Ipod pour écouter de la musique, mais d’un objet total dont la visée était de les englober tous, un objet dont on ne se lasserait jamais parce qu’il encapsulerait le monde et comblerait les vœux de ses usagers par les réponses fluides, intuitives qu’il apporterait, et ce à moindre effort.
Ce petit téléphone n’était ni plus ni moins que la boîte de Pandore 2.0. Tandis que Steve Jobs nous vendait l’espoir d’un monde connecté, pacifié, ludique, il libérait sous le capot de son design ultra-soigné les maux de l’ère numérique en imposant l’outil de leur propagation massive (en janvier 2025, 7,42 milliards de smartphones sont utilisés dans le monde) : la fragmentation de l’attention, la polarisation des opinions, la baisse de l’empathie…
Jobs nous avait apporté la peste et il en avait conscience, les pouvoirs publics et les services de renseignement également. Comme le révèle le philosophe Byung-Chul Han dans Thanatocapitalisme, les services de renseignement américains surnommaient le père d’Apple « Big Brother ». Quant aux utilisateurs de téléphone portable, ils avaient droit au gentil sobriquet de « zombies ».
Mais notre fétichisme de la technologie et de l’ingéniosité humaine nous a dissimulé l’essentiel, à savoir l’inscription concrète, matérielle de l’Iphone dans la vie courante. Avec son écran tactile, l’Iphone a modifié « nos relations corporelles au monde », comme l’écrit le sociologue allemand Harmut Rosa dans son immense ouvrage Résonance. Ce théoricien est l’un des rares à s’être intéressé, avec l’auteur de SF Alain Damasio ou avant lui le cinéaste canadien David Cronenberg, à la technologie dans ce qu’elle fait à nos corps, réflexion ô combien cruciale, tant nos postures reflètent notre ouverture/fermeture au monde et nos dispositions à l’égard de ceux qui nous entourent. En observant des gamers derrière leur ordinateur lors d’un évènement à San Francisco, Alain Damasio avait remarqué que les geeks se recroquevillaient sur eux-mêmes, dans une position rappelant celle du fœtus, et qui révélait, à ses yeux, une forme de phobie du contact et de refus de la relation avec autrui. Chez David Cronenberg, la technologie bouleverse nos perceptions et nos sens, on ne sait plus exactement qui de la machine ou de l’homme est l’hôte ou le virus, mais, ce qui finit par arriver, c’est que l’un et l’autre fusionnent dans un cauchemar, une hallucination paranoïaque où l’individu n’a plus aucune prise sur ce qui l’entoure.
Avec le Smartphone, les imaginaires des auteurs de la SF et du genre horrifique sont réunis : l’Iphone s’érige en mode de préhension, d’accès, et de perception privilégié du monde et re-designe notre identité, nos rapports à nos prochains et nos expériences à travers notre double numérique. Nul besoin d’aller chercher les trésors d’astuce et de manipulation imaginés par les acteurs du capitalisme de surveillance pour transformer nos pensées, notre intimité, nos actes, en comportements prévisibles dont on parviendrait à extraire une plus-value marchande, comme l’a brillamment fait Soshana Zuboff, car là encore, nous risquons, plein de bonnes intentions, de voir nos aspirations émancipatrices et critiques aspirées par la matrice et renvoyées au rang de menaces abstraites, proférées par de tristes Cassandre. Le Smartphone a l’avantage d’être tangible, et la lecture critique de son usage ne nécessite pas un appareil théorique ultra-élaboré, non, il suffit d’observer et de décrire ce que l’on voit dans le métro pour constater les ravages de notre laisse numérique – et celui est au bout de la laisse n’est peut-être pas celui qu’on croit. Rosa parle de « culture du regard baissé » ou de la « nuque baissée ».
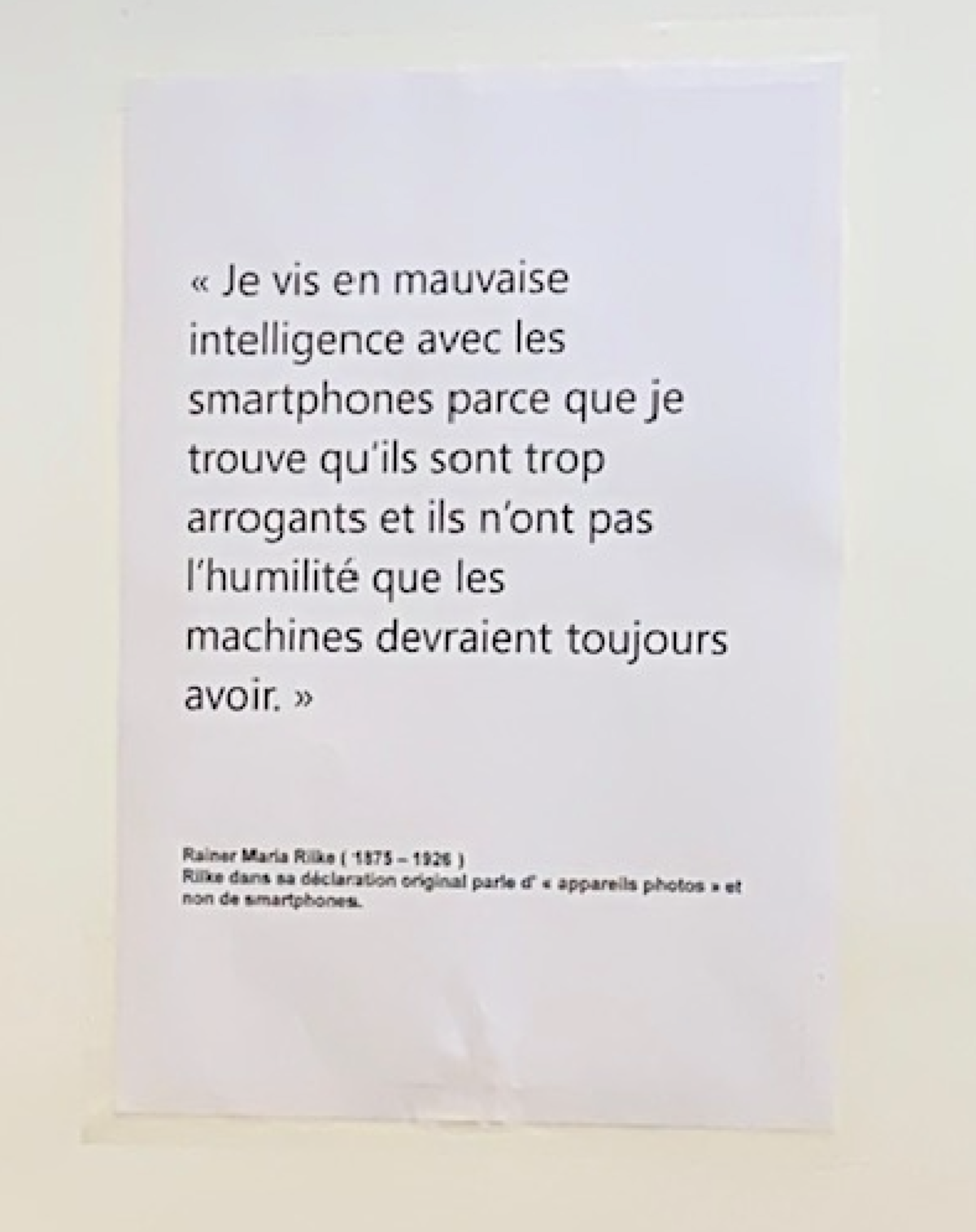
Agrandissement : Illustration 1
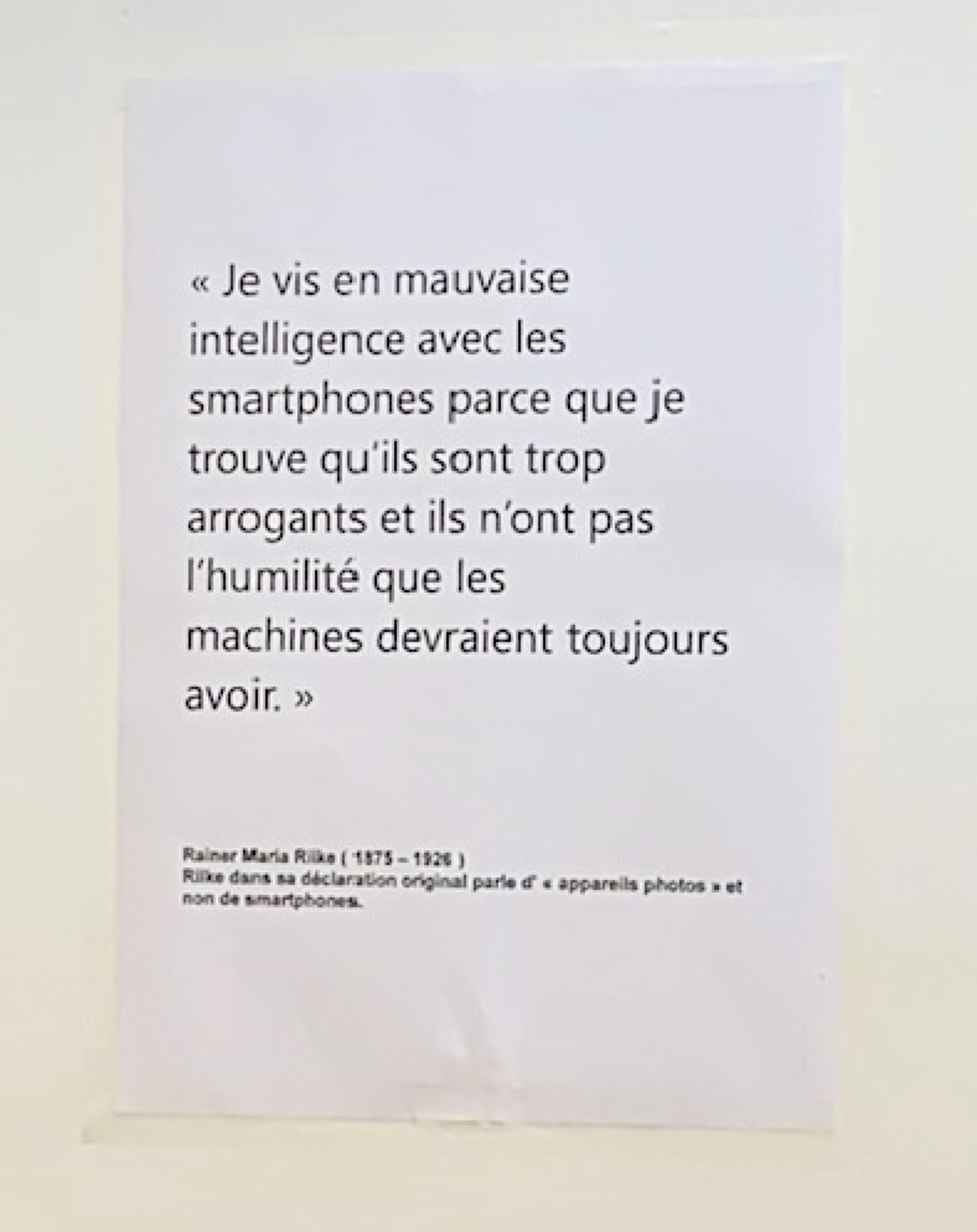
Rivés à l’écran, notre visage se dérobe, ce visage que j’offre à l’autre, ce visage qui me permet de me présenter et d’entrer dans l’espace visuel et sensible de mon semblable, opérant ce décentrement essentiel : devenir le prochain… de mon prochain. Les êtres humains s’éprouvent dans le monde comme regardants et regardés, écrit Harmut Rosa, or l’Iphone prétend nous épargner cet effort qui nous fait tendre vers l’autre. Source lumineuse de toutes nos attentions, l’écran isole, fragmente, fait de nos corps des remparts qu'il prétend dans un même mouvement nous aider à surmonter dans l’espace virtuel. L’Iphone devient le guide devant lequel, physiquement, on s’incline.
Si bien qu’être rivé à son Iphone, c’est être rivé à son corps, ce qui fut l’une des caractéristiques de l’hitlérisme, selon le philosophe Emmanuel Levinas. Dans les totalitarismes du 20ème siècle, des êtres isolés, coupés du monde, n’aspiraient qu’à la communion-fusion dans l’Un, le tyran. Aujourd’hui, la formule a à peine changé, l’isolement est rompu par le désir d’être de la partie, de fusionner dans la communauté symbiotique numérique, dont le Smartphone constitue le rond-point de la circulation sociale, articulant et dés-orientant notre rapport à nous, aux autres, comme en avait eu l’intuition Zuckerberg en galvaudant le terme « friend » – l’ami, une forme de lien vigilant, garant du lien social et de la communauté plurielle politique.
Mais que perdons-nous au juste, dans ce glissement de l’ami au « friend » ? Nous tournons le dos à l’espace à la fois physique et immatériel entre les hommes où tout est à construire par un patient travail du lien et de la juste distance qui se nomme amitié, cette fièvre discrète qui monte et s’empare du lien social lorsque des forces anti-démocratiques prétendent le dissoudre, l’absorber dans un grand tout amalgamé. Travail exigeant, passionnant, sans cesse à renégocier où le jeu des affinités électives peut se déployer dans une chorégraphie subtile et délicate.
Puis-je regarder?
Puis-je sourire ?
Puis-je saluer ?
Puis-je parler ?
Puis-je toucher ?
Puis-je aimer ?



