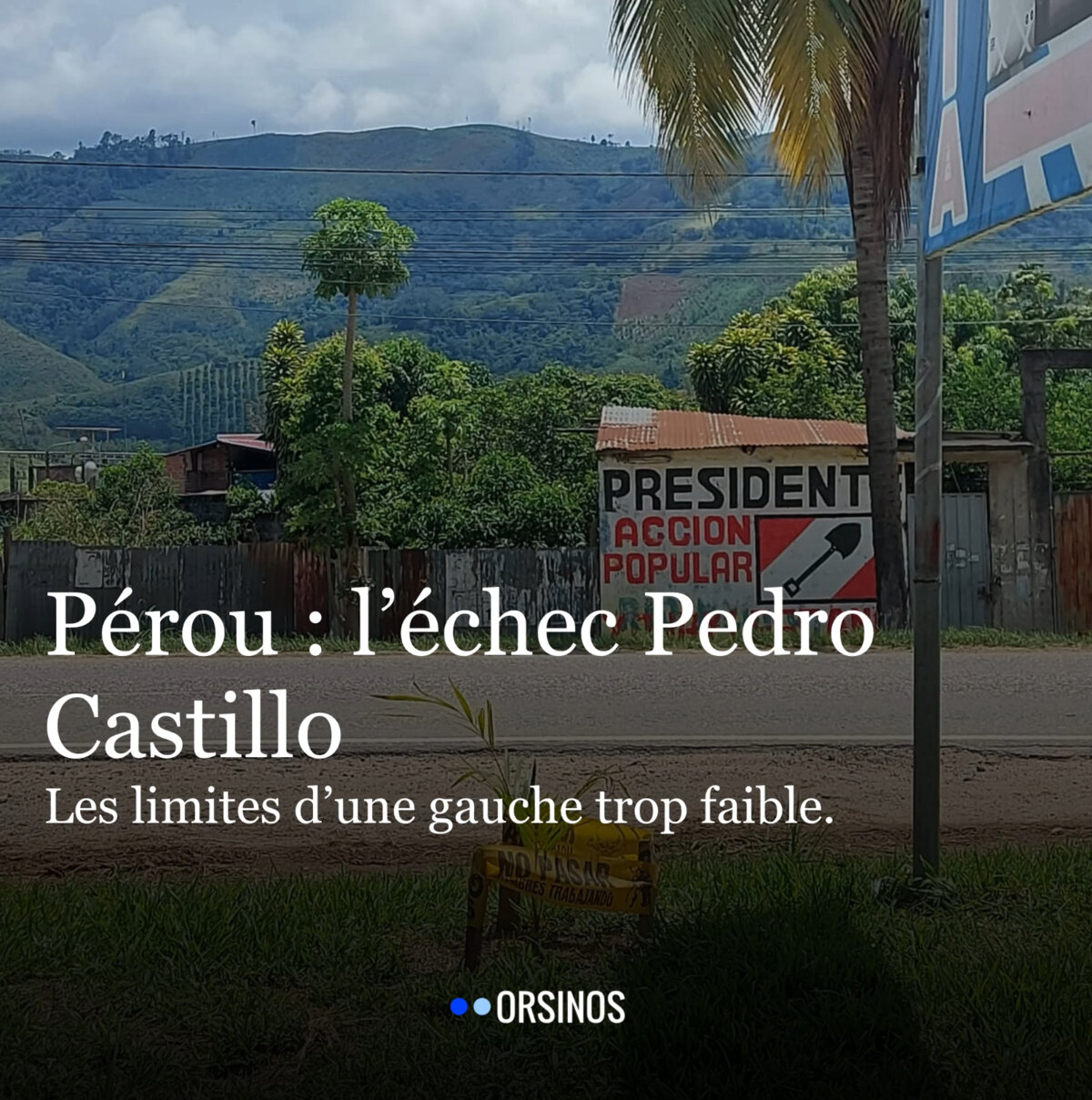
Agrandissement : Illustration 1

D’un côté un pays représenté par Keiko Fujimori, fille d’ancien président et soutenu par une grande partie de la classe politique. Elle recevra notamment le soutien de la plupart des médias, de l’équipe nationale de football et fut la candidate des grandes villes et des classes aisées. De l’autre, un Pérou porté par la candidature de Pedro Castillo, enseignant et militant syndicaliste autochtone. Candidat non formaté au schéma politique habituel, il aura représenté les intérêts d’un pays pauvre en opposition à une élite riche et corrompue. Son élection le 19 juillet 2021 aura donc créé la surprise dans tout le pays.
L’illusion du renouveau
La classe politique du pays souffre aujourd’hui d’un large discrédit auprès de l’opinion publique. Depuis 2016, cinq présidents se sont succédé, tombant quasiment tous pour des affaires de corruption. Ces faits de corruption ont par exemple impacté les mandats de 6 anciens présidents et 4 candidats à la présidentielle de 2021.
La politique libérale du pays a jusque-là été désastreuse pour la grande majorité de la population. 1/3 vis sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 100$ par mois. Le pays reste marqué par une grande disparité entre ses territoires. La concentration des richesses se fait autour des zones urbaines, quand les régions rurales connaissent un taux de pauvreté ultra-important. À l’intérieur des villes même, la disparité est marquée. Lima en est un exemple type. Son hypercentre concentre ses habitants les plus riches quand en périphérie se déploient les quartiers les plus précaires. À Lima, c’est 27% de pauvreté, soit plus d’un habitant sur quatre.
La succession des gouvernements libéraux a eu pour conséquence une intégration différenciée des territoires. On constate même des inégalités au sein des politiques menées. Ici, depuis plus de vingt ans, plus on est proche du décile des populations les plus riches, mieux on est intégré aux politiques sociales et économiques du pays et plus on voit ses conditions de vie s’améliorer. À l’inverse, plus on est proche du décile des populations les plus pauvres, plus l’exclusion est importante et plus la pauvreté augmente.
L’arrivée d’une politique de gauche au pouvoir apparaît donc comme une vrai volonté de renouveaux pour les péruviens.
Des idées fortes et nouvelles
Pedro Castillo arborant en permanence son chapeau devenu iconique et symbolisant ses origines natives de la région de Cajamarca se classe d’extrême gauche sur les questions économiques.
Parmi ses mesures souhaitées, une forte hausse des budgets liés à l’éducation et la santé. On note aussi la nationalisation des entreprises notamment du secteur énergétique. Autrement dit une reprise du contrôle de l’État sur les richesses énergétiques du pays. Il faut savoir qu’actuellement au Pérou, les cinq régions au plus fort taux de pauvreté sont toutes des régions qui disposent de projets miniers importants détenus par le secteur privé. Régions où les populations vivent d’une agriculture vivrière, n’ont pas de retraite, pas de système de santé, pas d’eau courante, un niveau d’éducation faible et font face à l’insécurité alimentaire.
Un vrai sentiment d’abandon s’est donc créé pour ces populations. Dans ces régions, 70% de l’activité minière va dans les poches des entreprises privées. Sur les 30% restant, la moitié tombe dans la corruption. Les populations ne touchent que très peu de bénéfices de l’activité minière sur leur territoire.
Faiblesses face aux grands patrons
Très vite lors de son mandat, Pedro Castillo s’est retrouvé bloqué par les contraintes capitalistes, économiques et les relations diplomatiques qu’il entretient avec les autres pays. Son projet de nationaliser les grandes entreprises minières s’est retrouvé contraint par les grands patrons et les pays occidentaux achetant à bas coût ses ressources. C’est un début de mandat désorganisé et un aveu de faiblesse de la part de Pedro Castillo de ne pas tenir tête au grand capital. Le système qu’il souhaite profondément changer l’a absorbé et l’extrême dépendance du pays aux grandes puissances économiques et à ses pays voisins le contraint de revoir ses objectifs à la baisse.
« Au tout départ, nous avions de l’espoir dans ce gouvernement de gauche qui représentait la voix du peuple et l’envie de briser les règles du néolibéralisme. Cependant, nous avons vite vu que ce gouvernement ne cesse d’improviser, mais aussi qu’il est très faible et qu’il n’effectue que de petits et lents changements. » Joshy, comme de nombreux péruviens, nous ont fait ce retour sur le président Pedro Castillo.
Pedro Castillo, l’ultra-conservateur
La politique radicale et progressiste de Pedro Castillo s'arrête quand il s’agit de traiter les questions sociales. Les femmes et les personnes LGBTQI+ n’obtiendront pas plus de droits lors de son mandat, bien au contraire. Pedro Castillo est de confession évangéliste et est donc opposé aux mariages pour toutes et tous et anti-avortement. Il refuse tout cours d'éducations sexuelles dans les écoles, prônant l'abstinence comme vision éducative. Ses convictions religieuses impactent sa politique et il le revendique. On notera aussi le souhait de rétablir la peine de mort et une hostilité à l’immigration. Il souhaite en effet exclure les migrants qui selon lui commettraient des crimes au Pérou.
Une position que l’on retrouve aussi en France, avec Gérald Darmanin par exemple, ministre de l’Intérieur, qui continue d’alimenter ces perceptions. Pour rappel, s’attaquer à l’immigration pour répondre à la délinquance reste infondé. Ce sont plutôt vers des luttes contre les inégalités sociales, scolaires, territoriales et contre la pauvreté qui faut aller. Ce constat a évidement été rappelé par les statisticiens et sociologues spécialisés. Il n’a cependant pas été commenté par les politiques dont le débat tourne principalement autour des questions de sécurité (aka toute la droite française).
Clémence Rio & François Perdriau - Orsinos
SOURCES :
- Discriminations et inégalités, deux facteurs clés de la délinquance :
- Changement climatique: les agriculteurs andins résistent grâce à des pratiques ancestrales. Wyloën Munhoz-Boillot:
- Pérou: Pedro Castillo, de la campagne andine au second tour de la présidentielle. Wyloën Munhoz-Boillot:
- La paroles des féministes péruviennes. Entretien avec Joshy, militante péruvienne - Orsinos:
https://blogs.mediapart.fr/orsinos/blog/210122/la-parole-des-femmes-peruviennes-0



