La semaine de la rentrée après les vacances d’hiver, nous avons débuté une nouvelle séquence pédagogique sur le théâtre avec une classe de première : On ne badine pas avec l’amour, Perdican, Camille, tout ça. Mais ce jeudi-là, on revient sur des questions de méthode, on révise. Pendant une séance de deux heures, je prépare mes élèves au bac blanc écrit du lendemain, une épreuve de quatre heures où ils auront le choix entre un commentaire composé et une dissertation sur œuvre. Comme d’habitude, une pause est prévue à 9h, après la première heure de cours.
Durant la reprise après la pause, je remarque qu’une de mes élèves – appelons-la… Camille – tient un objet évoquant une palette de maquillage. Je ne relève pas ni n’interromps mon explication, absorbé par ma tâche, et soucieux de ne pas perdre du temps en cette dernière séance avant l’épreuve. Cela m’embête de ne pas réagir, mais passons, je ferme les yeux. Je sais aussi que Camille est une micro-influenceuse sur TikTok, spécialisée dans le maquillage. Elle est particulièrement douée dans son art. Je m'abstiens de faire une remarque qui pourrait être mal perçue.
Le soir, en consultant TikTok pour mes rendez-vous quotidiens avec Pascal Boniface, Marie-Cécile Naves, Luna Sweet Pain, Balance Ton Beauf ou Max de Fun, l'algorithme me propose une vidéo de Camille tournée dans une salle de classe du lycée. Mince. En observant son pull, je réalise qu’il s’agit de toute évidence d’une vidéo de la journée même : c’est bien le pull qu’elle portait ce matin. Mais dans quel cours a-t-elle filmé ? Et que dois-je faire ? Identifier le collègue et lui en parler ? Prévenir la direction du lycée ? Camille explique en début de vidéo vouloir se maquiller en classe et enregistre plusieurs séquences montées bout à bout. Autour d’elle, des camarades sont visibles et interagissent avec elle. Je ne comprends pas l’enjeu de la discussion de Camille avec sa voisine sur les lingettes Swiffer et les serpillères, mais ce doit être bien drôle. La scène semble anodine – un simple défi entre élèves –, mais pour moi elle ne l’est pas. Quelque chose me perturbe. Je regarde la vidéo une deuxième fois, puis une troisième. Il y a un détail qui m’échappe. La disposition des élèves, la configuration de la salle... Tout me semble étrangement familier, et pourtant quelque chose ne colle pas. Et puis, enfin, je comprends. La vidéo a été tournée en mode selfie, ce qui inverse l’image : la gauche devient la droite, et inversement. Ce que je vois ne correspond pas à ma mémoire de la classe, car l’effet miroir déforme mes repères visuels. Ce que je croyais être un autre cours, une autre salle, est en réalité mon cours, ma salle. La confirmation est implacable. La voix de l’adulte en arrière-plan, c’est la mienne ! Quoi ! Étais-je dans le déni ?
Chokbar, je prends immédiatement contact avec Camille via la messagerie interne du lycée, en mettant en copie ses parents, la direction et le CPE. Je lui demande de supprimer la vidéo et rappelle l’interdiction stricte d’utiliser le smartphone en classe. Le lendemain matin, la vidéo a dépassé 86 000 vues. Vers 6h, enfin, elle disparaît et Camille m’adresse un message d’excuses.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le soir même, je découvre deux nouvelles vidéos publiées par Camille. Dans la première, elle reprend quelques secondes de la vidéo supprimée, montrant ainsi à nouveau la salle de classe. Elle s’excuse ensuite auprès de sa communauté et explique que l’établissement lui a demandé de supprimer la vidéo, déplorant que ses abonnés ne puissent plus la voir. Dans la seconde, elle ironise sur son exclusion temporaire. Je m'interroge alors : les excuses étaient-elles sincères ? Je rédige mon rapport d'incident durant le week-end. La temporalité de TikTok et celle de l'institution sont déphasées.
Ma demande est de ne plus voir Camille en cours pendant deux semaines. Cette période doit me permettre de restaurer un cadre de travail rigoureux avec la classe avant son retour. Je mets en place de nouvelles règles dès le lundi suivant à 8h : sacs au fond de la salle, smartphones dans les sacs, plus de pauses lors des cours de deux heures, plus de notes au tableau. Je reste constamment face aux élèves, considérant que toute situation où je tourne le dos pourrait donner lieu à une nouvelle captation.
Le syndrome du professeur-PNJ
Je refuse d’être un PNJ (personnage non joueur) dans l’arc narratif de Camille, dont les abonnés demandent en commentaire : « un update ?? », ce à quoi elle répond : « On verra… ». Les PNJ : vous savez, ces personnages de jeux vidéo qui répètent inlassablement la même phrase dès qu’on interagit avec eux ? « Bienvenue à la taverne ! » « La quête du dragon commence ici ! » Ou encore, dans notre version éducative : « La dissertation consiste à répondre à une question posée sur une œuvre... »
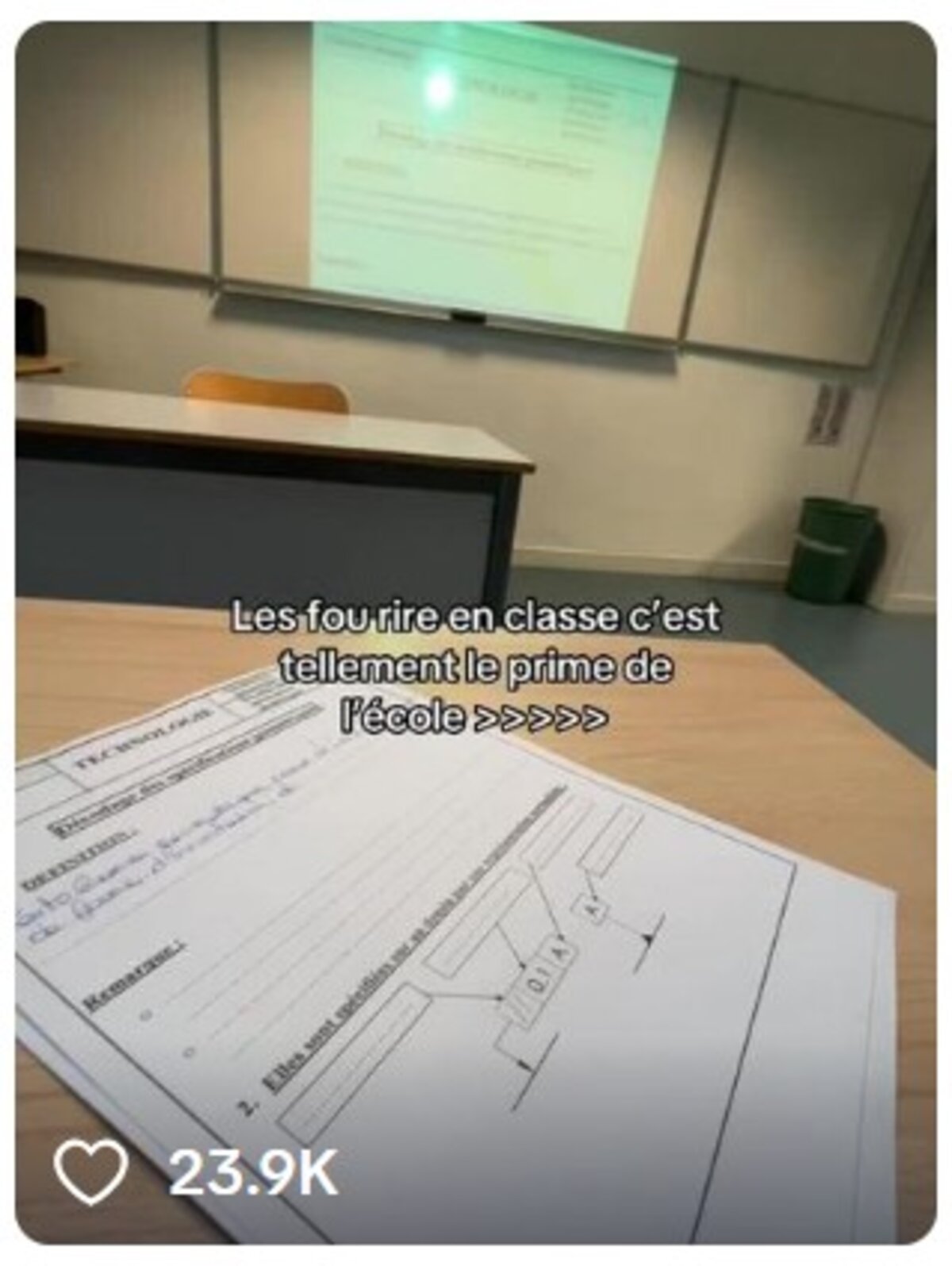
J’ai parfois l’impression que certains élèves nous perçoivent ainsi. Ils avancent dans leur propre quête – obtenir le bac – et, sur leur chemin, ils activent des PNJ disciplinaires : le PNJ littéraire pour expliquer un vers de Rimbaud, le PNJ mathématiques pour résoudre une équation, le PNJ anglais pour leur donner les bases du present perfect. Ils reviennent nous voir quand ils ont besoin d’un indice ou d’une information pour leur parcours, puis repartent aussitôt, oubliant que derrière le PNJ, il y a un être humain.
Avant Internet, il existait déjà un moment étrange où les élèves réalisaient que les professeurs avaient une existence en dehors de la salle de classe : c’était le choc de la rencontre impromptue et, dirions-nous avec les mots de 2025, gênante, au supermarché. « Oh non, le prof achète des yaourts !? Il mange ? Il vit hors du lycée ? » Certains en restaient marqués pendant des jours.
Avec les réseaux sociaux, ce choc a pris une nouvelle dimension. Le professeur n’est plus seulement quelqu’un qu’on aperçoit hors contexte à la boulangerie, c’est aussi une silhouette floue qui peut apparaître en fond d’une vidéo TikTok, un bruit de fond dans un live, une figure anonyme que l’on peut commenter et moquer. L’idée même qu’un professeur n’existe pas que pour enseigner semble parfois absente du logiciel de certains élèves.
Sauf que, contrairement à un vrai PNJ, je ne suis pas programmé pour délivrer des explications sur commande tout en restant stoïque face aux perturbations. Je n’ai pas non plus signé pour devenir un contenu à exploiter pour amuser une communauté en ligne. Je suis un professeur, et mon rôle est de former les élèves dans le cadre de missions d'enseignement bien définies, pas de servir de toile de fond à des scénarios numériques.
Conclusion : une école, pas un décor
Quid du droit des enseignants face à leur exposition sur les réseaux sociaux ? Le règlement intérieur du lycée parle beaucoup des droits des élèves, mais qu’en est-il des droits des professeurs ? L’anonymat de notre parole et la confidentialité de nos cours sont des principes fondamentaux à affirmer.
Ce constat se renforce encore lorsque, quelques jours plus tard, je tombe sur une vidéo d'un autre compte TikTok mentionnant mon lycée. Dans les commentaires, je découvre des attaques diffamatoires contre trois de mes collègues. Aucun mécanisme de veille ne protège les enseignants contre ces dérives.
Nous ne pouvons pas être la risée des élèves. Nous ne pouvons pas accepter que des jeunes nous jugent, nous classent et nous exposent sur le web sans que nous en ayons connaissance. L’autorité enseignante exige une vigilance constante. Nous avons un devoir d’éducation sur la distinction entre vie privée et espace public. Ce que nous enseignons ne doit pas être dénaturé et instrumentalisé pour des vues et des abonnés.
Le cas de Camille est révélateur d’une mutation inquiétante. Certains élèves veulent percer sur les réseaux sociaux, monétiser leurs vues, créer du contenu en permanence. Ils doivent comprendre que l’école n’est pas un décor pour leur storytelling personnel. Mon rôle est d’enseigner, non d’être filmé, observé et jugé par une audience qui n’a rien à voir avec le cadre éducatif. L’instantanéité des réseaux sociaux est incompatible avec le temps long de la formation des jeunes. Il est impératif que l’institution prenne la mesure de ces enjeux et protège les enseignants contre ces dérives.
Sur le site du rectorat de l’académie de Paris : Diffuser l’image ou la voix d’une personne https://www.ac-paris.fr/diffuser-l-image-ou-la-voix-d-une-personne-quelles-autorisations-et-combien-de-temps-125525#:~:text=En%20effet%2C%20l'article%209,son%20utilisation%20sans%20autorisation%20pr%C3%A9alable%20%C2%BB.



