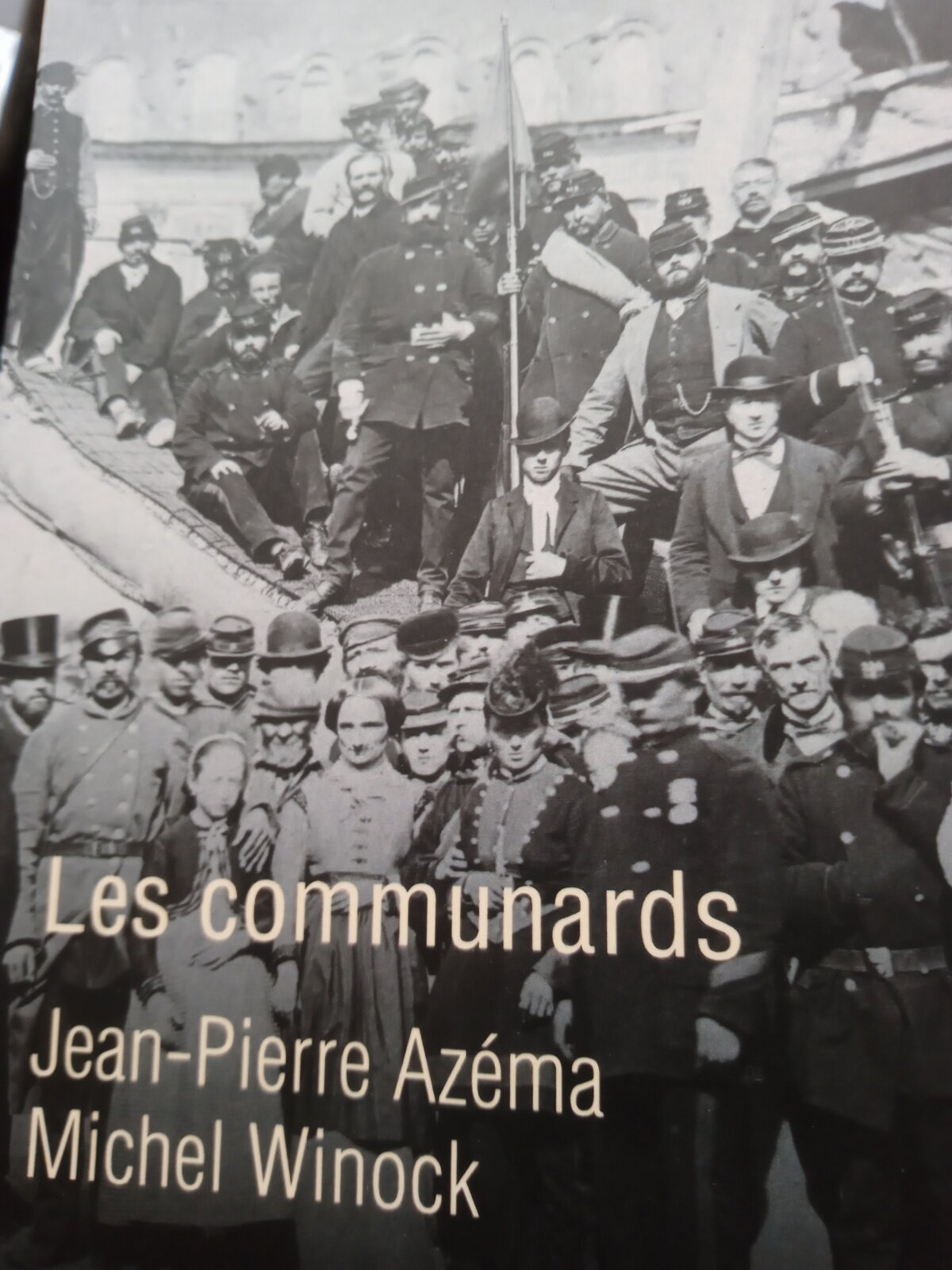
Agrandissement : Illustration 1
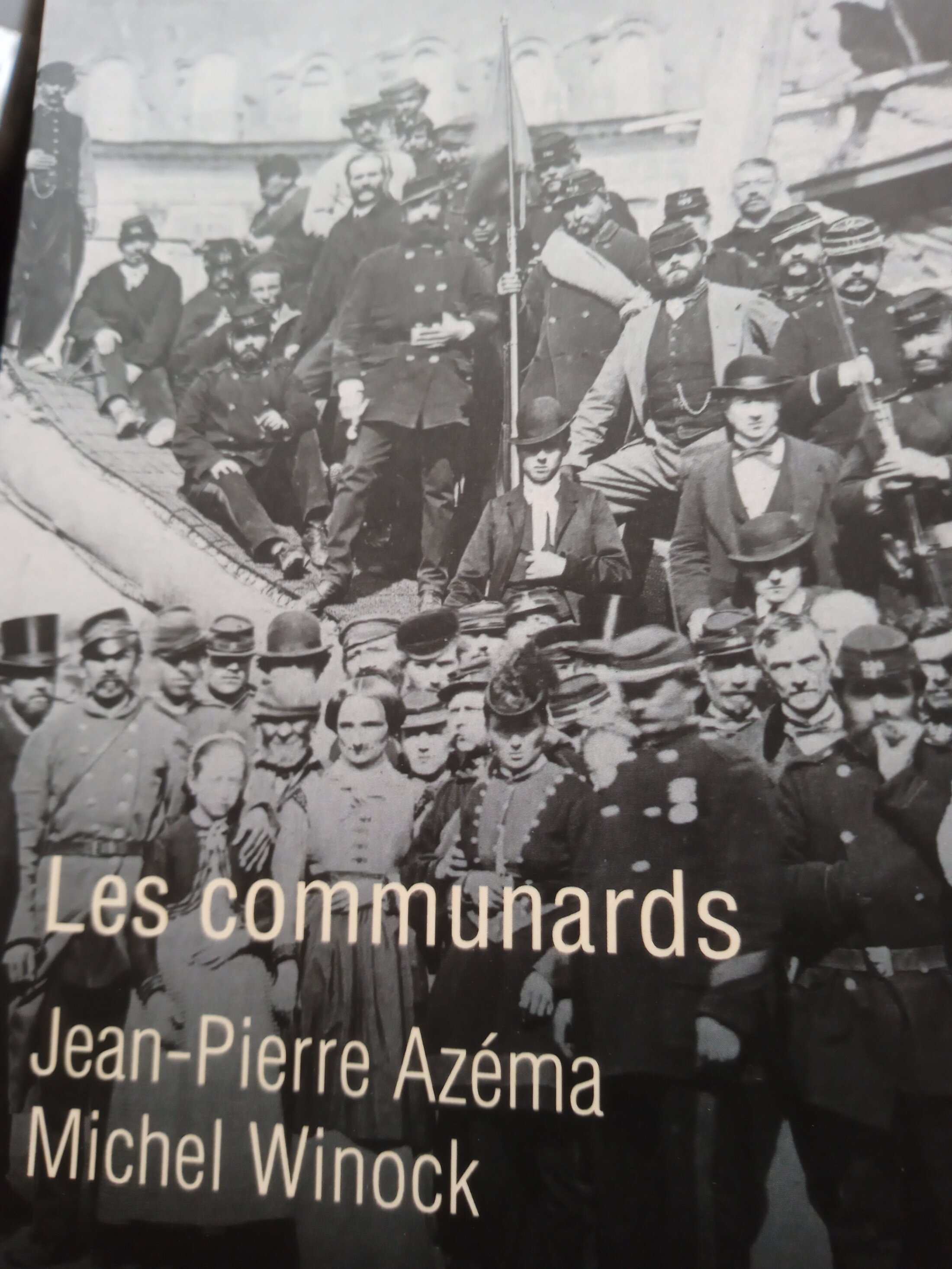
Cette année se déroule le 150e anniversaire de la Commune de Paris, ce mouvement insurrectionnel, qui se déroula, essentiellement, dans la capitale, et constitua un moment clef de l'Histoire, un espoir, bref mais intense, d'émancipation, de transformations sociales, et de revendications politiques, pour combattre les relents réactionnaires et rétrogrades de certains dirigeants de l'époque. L'intérêt de la Commune fut double, à l'époque: d'une part, témoigner de l'injustice notable de certaines politiques menées, au moment de l'Empire; d'autre part, constituer une source d'inspiration décisive pour de nombreux mouvements sociaux et pour la gauche, en France et dans le monde, dans les décennies et le siècle qui s'en sont suivies, pour penser des politiques de transformations sociales, dont se revendiquent encore aujourd'hui de nombreux citoyens.
Jean Pierre Azéma et Michel Winock, dans "Les Communards", Le Seuil 1964, collection Tempus, et Édith Thomas, dans "les Pétroleuses", Gallimard, 1963, collection Folio, nous retracent, de manière historique, avec toute la minutie et la précision chronologique qui s'imposent, le déroulement, en quelques mois, de ce mouvement social très intense, dont le prétexte prétexte fut, dans le paysage politique, la guerre entre la France et la Prusse. La capitulation de la première, et l'incurie des dirigeants de l'époque, dont Adolphe Thiers, notamment, dont la politique ne se démarquaient pas vraiment de la politique impériale et impopulaire de Napoléon 3. Du 19 Juillet 1870, date de la déclaration de guerre entre la France et la Prusse, jusqu'à l'écrasement de la Commune de Paris, qui prit fin le 28 Mai 1871, se trouve expliquées les causes de ce renversement inédit et soudain des valeurs, en phase avec les idéaux et les débats intenses qui agitèrent la Révolution Française, mais également les forces politiques de gauche en mouve-ment, pendant cette période.
Si la République fut proclamée le 4 Septembre, les conditions de la capitulation humiliante, le 28 Janvier 1871, consentie par l'armée française, qui dut céder 5 millions de francs, ainsi que l'Alsace et la Lorraine, et les conditions de siège effroyables subies par la population parisienne, et l'incapacité manifeste du gouvernement de l'époque à prendre des mesures fortes pour soulager le peuple de Paris d'une famine endémique et du froid hivernal, causèrent cette révolte irrépressible et décisive des forces de progrès contre les puissances réactionnaires. Ainsi, une "chambre conservatrice", après des élections, se met en place, mais l'idée de la Commune avait germé, dès les premiers pas de la proclamation de la République, pour marquer une rupture nette et franche avec l'Empire. Le gouvernement très vite se refuse à prendre la mesure de la situation, et n'organise pas la "réquisition" alimentaire pourtant nécessaire, se refuse à prononcer un "moratoire" indispensable sur les loyers, et impose la remise de ceux-ci à des "commerçants ruinés". Pire même, le rationnement s'organise cyniquement par le marché noir de fait, qui rend l'accès alimentaire inaccessible aux plus démunis, alors que des zones d'abondance scandaleuses persistent paradoxalement localement. De la sorte, le pouvoir réactionnaire de Thiers, pourtant élu le 2 Février, se retrouvera, très vite chassé à Versailles, incarnation symbolique de l'Ancien Régime liberticide, là où s'était installé les prussiens, devant lesquels il avait si vite capitulé.
Michel Winock et Jean Pierre Azéma, d'une part, Édith Thomas, de l'autre, retracent les évènements qui permirent brièvement aux communards et communardes, de prendre le contrôle des opérations et proposer des transformations révolutionnaires, dans le débat public, tant dans le domaine social, mais aussi éducatif, économique, et dans la vie citoyenne. Cet exercice de "démocratie directe", telle que Rousseau l'avait envisagé dans le "Contrat Social", fut expérimenté par les communards: de la constitution de la Garde Nationale, qui marcha, une première fois sur l'Hôtel de Ville, le 28 Janvier, jusqu'à la fin de cette expérience de démocratie citoyenne, le 28 Mai, en passant par la prise décisive de l'Hôtel de Ville, le 18 Mars, les parisiens connurent un épisode inédit d'expression et d'intense activité démocratiques, avec la présence de membres élus, la constitution de commissions (finances, éducation, guerre, etc), et la création de clubs en tous genres foisonnant comme pendant la période la plus active de la Révolution française: "Union des femmes", "comité de vigilance des femmes de Montmartre", le "club des prolétaires". Cette agitation fut propice à de nombreux débats auxquels se livrèrent les communards, et le caractère spontané et horizontal de ces débats en donnèrent un caractère démocratique et révolutionnaire. Les discussions portèrent notamment sur l'orientation socialiste ou anarchiste ou autoritaire, voire dictatoriale à donner à ce mouvement social, et sur la nécessité d'organiser les libertés publiques et/ou de les réprimer. La Commune de Paris retrouva ainsi les grandes lignes de discussion qui agitèrent la Révolution française, et notamment les grandes lignes de fracture entre les "montagnards", nécessairement "jacobins", et partisans d'une République "une et indivisible", et les girondins, partisans, au contraire, d'une "vision locale, décentralisée, autonome du pouvoir central", différenciée, telle que se réclamait finalement le mouvement communaliste. D'autre part, la Commune de Paris fit émerger des personnalités très diverses, donnant une place importante et une expression remarquable, à l'ensemble des catégories socioprofessionnelles de la population, dans toutes leur diversité: ainsi Charles Delescluze, montagnard d'âge mûr, cherchait à s'inspirer de la Constitution de 1793, et prônait la nécessité de manifester à "mains nues" contre l'ennemi versaillais, probablement par idéalisme. Ou encore Eugène Varlin, "l'ouvrier relieur", qui participa à des grèves, tout en adhérant à "l'Internationale de 1864". Ou encore Jules Vallès, l'écrivain, et fils d'intellectuels, engagé, politiquement, dès le coup d'État de 1851, et auteur d'une trilogie biographique, "l'enfant", "le bâchelier", "l'insurgé", témoignant de son engagement pour la Commune de Paris. Ou encore le poète Jean Baptiste Clément, auteur du "Temps des Cerises", et en l'honneur duquel le chanteur Jean Ferrat fit une chanson. Mais encore, le peintre réaliste Gustave Courbet, qui proposa d'abattre la Colonne Vendôme, symbole, selon lui, de l'oppression impériale. Enfin Blanqui, athée et partisan d'une école laïque, gratuite et obligatoire. Entre les mesures d'urgence qui s'imposèrent pour soulager la souffrance du peuple de Paris (moratoire d'un ou de plusieurs loyers pour les parisiens, du fait de la situation alimentaire et sanitaire catastrophique, la distribution de pensions de veuvage aux femmes des membres de la garde nationale tués dans les combats), distribution gratuite des biens cédés au Mont de Piété, aux indigents, la Commune fut également l'occasion de discussions acharnées sur la volonté de pratiquer la "séparation de l'Église et de l'État", avec la volonté de retirer aux congrégations religieuses, le monopole de l'enseignement notamment, et de s'orienter progressivement vers un État laïc, ce qui annonçait les lois de Jules Ferry, et la loi de 1905. De même, de nombreuses questions furent débattues, sans être résolument, comme la nécessité d'élargir la "liberté de la presse" ou de la restreindre, notamment vis-à-vis des journaux "réactionnaires". La nécessité de donner au nouveau pouvoir une orientation volontairement autoritaire, comme le souhaitaient les courants communistes, ou au contraire une orientation libertaire (courants socialistes, anarchistes).
Enfin, outre cette relative liberté et spontanéité des discussions entreprises, dans cet exercice de démocratie directe inédite, la diversité des acteurs en présence, et l'absence de système pyramidal qui y prévalait, la Commune se caractérise également, de manière singulière, par le poids pris par l'engagement décisif des femmes. Si celles-ci durent affronter, pendant ce mouvement social, les préjugés inexcusables de la presse versaillaises qui les décrivaient comme des personnes "avides de sang", "animées par la paresse", mais également par le regard condescendant de leurs collègues insurgés masculins, comme "Marx", qui bien que n'étant pas présent sur place, et commentant l'évènement politique de l'extérieur, voient dans l'engagement des communardes des "cocottes ayant retrouvé la piste de leurs protecteurs, à savoir, la famille, la religion, et surtout la propriété", elles ne lésinèrent pas néanmoins sur l'engagement citoyen: si la Commune ne porta pas précisément au devant de la scène des revendications féministes proprement dit, hormis la nécessité de se déclarer partisan du travail des femmes, comme Marx, à la différence de Proudhon, qui y était opposé, ou encore la nécessité de favoriser une dignité salariale pour la gente féminine, voire de promouvoir l'égalité salariale avec les hommes, pour endiguer le phénomène de la prostitution notamment, les femmes furent très engagées dans la protection des populations impliquées dans les combats: les clubs féminins regorgeaient d'ambulancières, de lingères, de cantinières, volontaires pour porter secours aux populations en difficulté. Là encore, c'est la diversité des actrices en présence dans ce mouvement social, et son caractère volontiers horizontal qui est singulier et caractéristique. Une figure "héroïque", néanmoins se distingue tout particulièrement: Louise Michel, à la fois institutrice, oratrice, et soldate, ainsi qu'ambulancière (elle sauva un communard sur la butte Montmartre, là où naquit le mouvement communaliste), participa à la sauvegarde des blessés place de la Concorde, lors de l'offensive de Thiers et des versaillais, pendant la semaine sanglante, et elle prit plusieurs fois le fusil, pour tuer des adversaires. À tel point que Victor Hugo lui consacra, en hommage, un poème, "viro Major", la décrivant comme un Enjolras féminin volontaire et déterminé dans la mêlée parisienne. Néanmoins, d'autres figures féminines s'illustrèrent pendant la Commune, comme la journaliste féministe André Léo, qui revendiqua l'instruction ainsi que la liberté de la presse, et plus généralement la Défense des Droits et des Libertés, et faisant l'éloge, dans "la sociale", son journal, des femmes prêtant mains fortes aux combattants de la Commune. Ou encore Marguerite Tinayre, femme écrivaine engagée, qui embrassa, pendant la Commune, la cause du socialisme. Ou encore Julie Daubié, engagée dans la Commune, et première femme reçue au baccalauréat, ce qui témoignait de la volonté des femmes de s'occuper de l'administration des choses, en s'élevant par l'instruction, l'éducation.
Enfin, du point de vue de la violence, le bilan est nuancé, même si l'on doit constater l'implacable répression dont furent victimes les forces communardes par la contre-offensive versaillaise de Thiers, pendant la semaine sanglante, où l'on compta entre "15 000 à 25 000 morts" communards, la plupart fusillés, comme ceux du mur des fédérés, au Père La Chaise, notamment, ou encore la répression qui marqua les combats à La Butte aux Cailles, dernier bastion de Résistance. Certes, les communards ont commis quelques actes répréhensibles, comme les incendies qui occasionnèrent des dégâts à l'hôtel de ville, aux Tuileries, notamment, et quelques otages éliminés, mais c'est sans commune mesure avec l'effroyable répression qui s'en est suivie. 10 000 condamnations, notamment, des condamnations à mort, des déportations en Nouvelle Calédonie eurent lieu, comme celle de Louise Michel, qui trouva alors l'occasion d'exercer ses talents d'institutrices auprès des populations indigènes locales, en apprenant leur culture, proche de la Nature, et put ensuite revenir en France, après l'instauration de la loi d'amnistie de 1880. Mais le mouvement communaliste se caractérisa également, du point de vue tactique et stratégique par un certain angélisme, que critiqua Marx, qui regretta que les communards, trop légalistes, ne réquisitionnent pas la banque de France, et préfèrent négocier avec elle, ou ne marchent pas sur Versailles pour anéantir et/ou neutraliser définitivement leurs adversaires, donnant l'occasion à ces derniers d'organiser la riposte et des représailles décisives. Enfin, si la Commune fut un mouvement local, essentiellement parisien, il essaima brièvement en province (Toulouse, Lyon, Narbonne, Saint Étienne), mais fut bien vite neutralisé, par manque d'organisation, et du fait des manoeuvres insidieuses de Thiers.
L'anniversaire des 150 ans de la Commune est donc l'occasion de réaliser un bilan et de reconstituer un témoignage historique exemplaire de ce mouvement social unique dans l'histoire du mouvement ouvrier, pour péréniser la mémoire et la conscience citoyenne en France et dans le monde, en faveur de forces de progrès et de transformations sociales.
"Les communards" de Jean Pierre Azéma et Michel Winock, Le Seuil 1964, collection Tempus, 1 volume, 187 p.
"Les Pétroleuses", d'Édith Thomas, Gallimard 1963, collection Folio histoire, 1 volume, 394 p.



