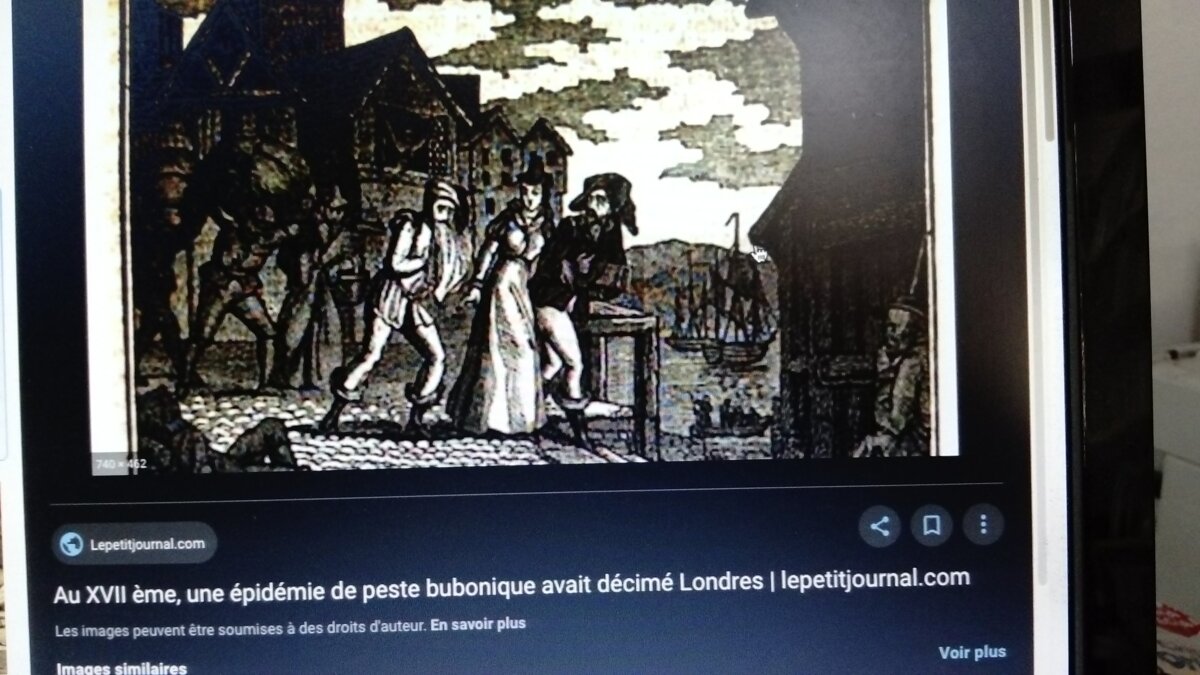
Agrandissement : Illustration 1
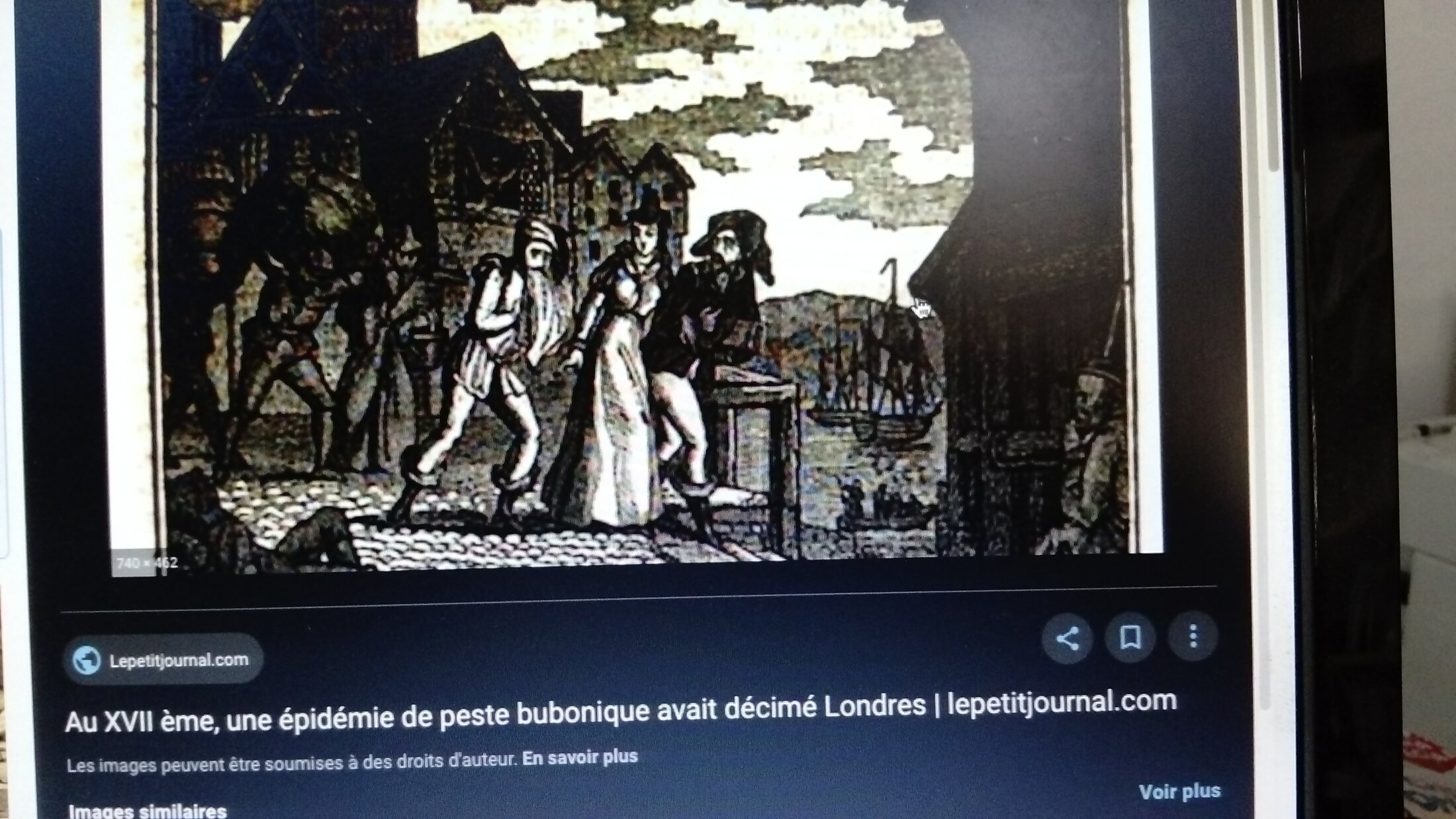
L'infection au SRAS COV 2 est apparue pour la première fois sur un marché en Chine, en Novembre 2019. Le 23 Janvier, la ville de Wuhan, qui a vu apparaitre cette infection, a été mise en confinement, sur ordre des autorités. Quelques semaines plus tard , la panique a atteint de nombreuses villes du globe entier, et l'épidémie s'est principalement répandue en Europe, notamment en France, en Italie et en Espagne, mais aussi en Grande Bretagne, ou encore aux Etats Unis. Cet épisode sanitaire a été "Décrété urgence mondiale pour la santé" par l'OMS, le 30 Janvier dernier, puis "pandémie", c'est-à-dire épidémie touchant de nombreux territoires du monde entier, le 5 Mars dernier. Depuis, les consignes de confinements se sont étendues sur de nombreux territoires de la planète, pour tenter d'enrayer cette maladie très contagieuse, ou du moins la transmission du virus, qui progresse de manière supersonique sur tous les continents du globe.
Tout a été dit sur cette épidémie terrible, susceptible de provoquer un effet de terreur, une sidération ou une onde de choc internationale: l'extrême contagiosité de ce virus, sa létalité trois fois supérieure en moyenne à celle d'une banale grippe, notamment parce qu'il peut provoquer l'apparition de signes cliniques conduisant à une détresse respiratoire gravissime, consécutive à une fibrose pulmonaire brûtale et massive. L'absence de traitement sûr et efficace rajoute aux interrogations et aux controverses incessantes: faut-il utiliser de la chloroquine, médicament utilisé depuis de nombreuses décennies dans le traitement du paludisme, mais aussi dans certaines maladies rhumatismales et/ou autoimmunes, et considérée par certains comme le remède miracle, pour soigner cette maladie? Faut-il se tourner de préférence vers des anti-viraux (remdesevir, efficace contre le virus Ebola, ou des anti VIH comme liptovar,/ ou ritonivar auquel on rajouterait l'interféron?) Faut-il se tourner vers des plasmas de patients préalablement infectés et développant des anticorps contre la maladie, pour traiter des malades atteints du SRAS COV 2? De nombreux essais cliniques sont en cours, comme l'essai européen Discovery, impliquant 2300 patients, dont 800 en France, et permettant une analyse comparée de 4 traitements, pour évaluer l'efficacité de chacune des solutions thérapeutiques préconisées. En Suède et aux Etats Unis, des essais cliniques ont également été engagés sur des patients pour tester l'efficacité de la chloroquine, malgré quelques effets indésirables à redoutés sur des patients cardiaques.
La polémique fait rage également sur le manque de préparation des dirigeants de nombreux pays du monde entier. Ceux-ci avaient-il suffisamment anticipé l'irruption de cette épidémie, ainsi que sa diffusion? S'étaient-ils préparés à la fabrication et la distribution de masques au personnel soignant (nouveaux héros de la lutte contre la maladie) ou à la population? Avaient-ils anticipé la détection de la maladie, par la réalisation de tests-diagnostics en quantité suffisante, pour repérer les personnes malades et/ou contaminées, et prendre ainsi les mesures nécessaires pour tenter de maîtriser la propagation de la maladie, et la création la progression d'un "monstre" indomptable? Ce type de débat interpelle l'opinion publique, notamment en France et dans d'autres Nations européennes. A contrario, certains pays semblent s'être mieux préparés, à l'éventualité d'une crise majeure, comme l'Allemagne, qui a intensifié la pratique de tests diagnostics très tôt, et qui disposait, dès le début de la diffusion de la maladie, d'un équipement en lits de réanimation supérieurs aux capacités de l'hexagone. On cite également le cas de la Corée du Sud, échaudée par des antécédents récents de pandémie, qui a généralisée très tôt ses tests de dépistage de la maladie à l'ensemble de la population pour freiner sa diffusion et limiter le nombre de morts.
Certes le problème des "pandémies" n'est pas nouveau: depuis l'antiquité, l'humanité est régulièrement dévastée par des épidémies qui terrassait des populations assistant impuissantes et terrorisées à leur propagation (épidémies de peste dans l'antiquité romaine et au Moyen Âge, voire à une période plus récente), épidémies de lèpre et de choléra. Elle ont même inspiré de nombreux écrivains, comme étant l'expression d'un mal absolu, ou dont l'origine serait inconnue ou complexe. Ainsi, La Fontaine dans les "animaux malades de la peste" qui dénonce l'erreur consistant à désigner des boucs émissaires qui seraient coupables ou responsables, à tort, de cette maladie : ainsi, la communauté chinoise serait-elle seule responsable de la propagation du COVID 19? Michel de Montaigne, à la fin du 16e siècle, auteur des "Essais", et qui avait la charge de la Mairie de Bordeaux, du déserter sa ville précipitamment, pour fuir l'épidémie de peste qui dévastait ses administrés. Rappelons qu'il fut, à son époque, médiateur auprès de Henri 4, pour tenter de mettre un terme à une guerre de religions en France. Camus, dans "la peste", en 1944, sous prétexte de décrire une épidémie survenue à Oran, dénonce, par métaphore, le mal absolu que constituait selon lui, le nazisme et le fascisme, même s'il n'excluait pas d'autres interprétations possibles pour comprendre son récit allégorique.
Dans la période contemporaine, les pandémies n'ont pas disparu, et elles ont même redoublé d'intensité. L'épidémie de SIDA, maladie apparue au début des années 80, à partir d'une diffusion du virus HIV, à l'origine, de l'animal à l'Homme, aura fait des millions de victimes, en quelques 40 ans d'existence, entrainant l'angoisse et la psychose de nombreuses générations. Là encore la tentative de fabriquer des boucs émissaires fut longtemps de mise. Récemment, des pandémies de grippes aviaires furent recensées: en 1999 (grippe H1N1), en2005 (grippe H5N1), en 2009 encore. Cette dernière pandémie, si elle fut nettement moins contagieuse que le COVID 19, tua néanmoins quelques centaines de milliers de personnes sur la planète. Malgré les alarmes et les préconisations récurrentes de l'OMS, incitant régulièrement les pouvoirs publics, ces dernières années, à se préparer à la répétition inéluctable de ce type de "catastrophes", les autorités restent souvent sourdes à ce type de remarques, sur le long terme, et nous pourrions reprendre, à cette occasion, une métaphore devenue célèbre, et utilisée pour défendre une cause voisine: "notre maison brûle et nous regardons ailleurs".
En effet, et plus globalement, cet épisode tragique du COVID 19 interroge notre rapport au monde et à l'humanité, de manière générale, c'est-à-dire son rapport à la nature. Cette épidémie est née, en effet, en Asie, d'une contamination des hommes par des animaux sauvages (chauves souris, pangolins) chassés de leur habitat naturel par une urbanisation galopante. Les hommes ne lésinent pas sur les moyens employés pour prélever, ou détruire une part excessive de la nature, et satisfaire ainsi leurs besoins de consommation. Ainsi, cette infection catastrophe serait le résultat d'un développement monstrueux, galopant et non maîtrisé, des comportements humains, au détriment d'une nature déréglée et martyrisée. La planète subit ainsi une alerte sérieuse: plus que le nombre de morts ou de malades, parfois gravement atteints, c'est à la fois le manque de moyens de nos services de santé, totalement débordés par cette crise sans précédent, et l'état de collapsus économique brutal et soudain de la planète occasionné par cette pandémie, qui interpelle (l'arrêt, pendant plusieurs mois des activités essentielles à l'économie de nombreux pays de la planète, provoquant une récession inévitable). Sans comparer cet épisode à celui de la grippe espagnole de 1918, qui avait décimé plusieurs dizaines de millions de personnes sur l'ensemble de la planète, à la suite de l'un des plus grand conflits militaires que l'humanité n'ait jamais connu, et provoquant une crise économique sans précédent, cet accident prévisible interpelle notre mode de fonctionnement culturel et économique: l'insuffisance des moyens alloués aux services de santé, la critique d'une croissance et/ ou d'un mode de développement infini, les politiques d'austérité, etc.
L’email a bien été copié



