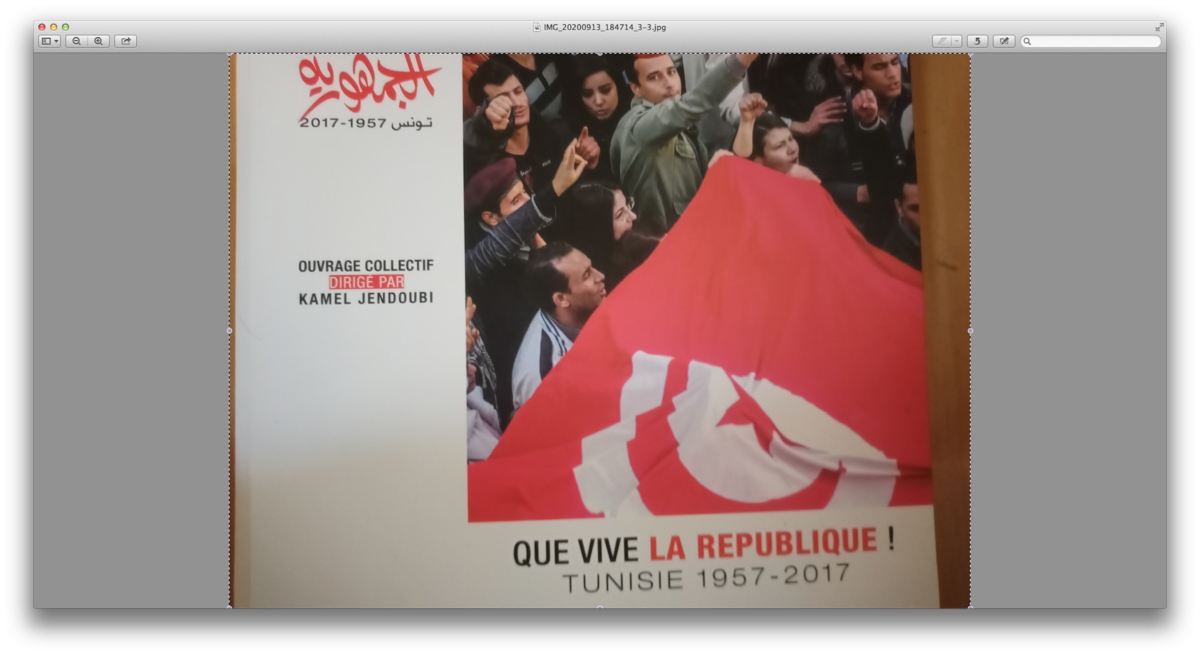
Agrandissement : Illustration 1
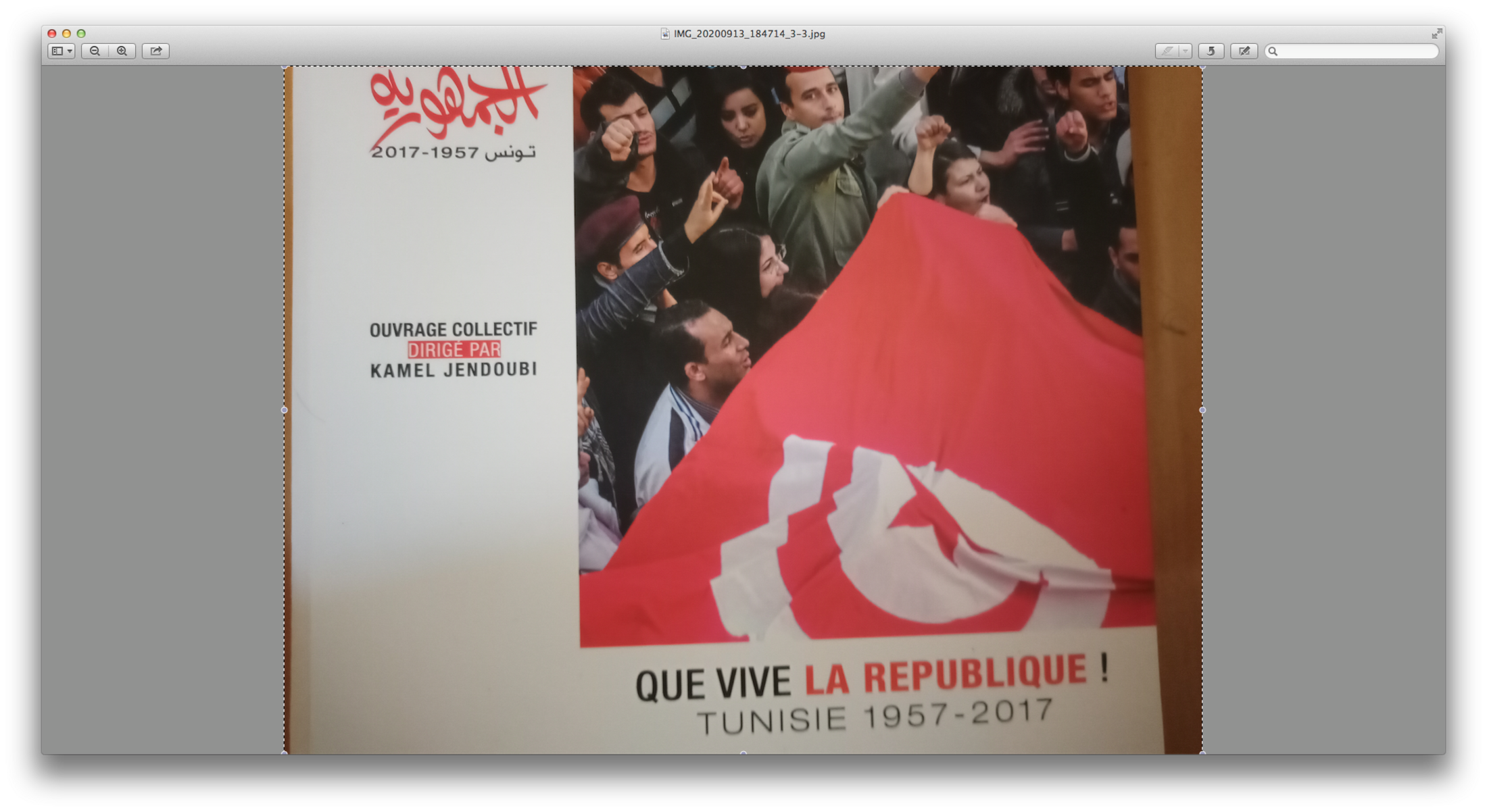
"Que Vive la République! Tunisie 1957-2017" est un ouvrage collectif, corédigé et écrit par une série d'acteurs majeurs de la société civile tunisienne, et coordonné par Kamel Jendoubi, ancien ministre des relations avec le parlement tunisien, pour établir un bilan et une analyse politique de l'histoire de ce pays, depuis les premiers balbutiements démocratiques, au 19e siècle, sous l'Empire ottoman, jusqu'à la Révolution de 2011, en passant par le combat anticolonialiste sous le protectorat français, et la période de la première République, après la proclamation de l'indépendance, en 1956. En 295 pages, Kamel Jendoubi et ses associés, pour l'occasion, mettent en lumière, par la méthode historique, sous forme d'articles de fonds, de calendriers historiques, de photographies, d'analyses, l'évolution sociale, économique, politique, de ce pays du Maghreb. Cette histoire politique met en exergue la lutte constante pour la liberté, l'égalité, la justice, qui ont jalonné les mouvements sociaux et politiques du pays du Jasmin depuis un siècle et demi, prémices d'une situation qui en fait une expérience unique dans le monde arabe.
Tout commence par les premiers mouvements d'émancipation, lors de la 2e moitié du 19e siècle, avec Kheireddine Pacha, qualifié de "réformiste et réformateur", qui fut "président du Conseil Suprême, puis grand Vizir", et dont les premières initiatives préfigurèrent les quelques "avancées modernistes", au sens de progrès social, de la république tunisienne, après l'indépendance: la substitution de tribunaux civils aux tribunaux religieux, à l'époque, prémices d'une sécularisation de l'islam, et l'importance, déjà à ce moment,, accordée à l'éducation, avec la scolarisation des plus jeunes, ainsi que l'abolition de l'esclavage, en 1846, soit deux ans avant la France, constituèrent les signes annonciateurs et salutaires d'un futur État indépendant et moderne, dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance et la décolonisation, et d'envisager des perspectives progressistes, à défaut d'une véritable démocratie.
Certes, la période du protectorat français n'a pas écarté toute tentative d'hégémonie et/ou de domination, mais la monarchie beylicale, soumise au pouvoir colonial français, même si elle lui préexistait, n'a pas empêché les mouvements de contestation de se manifester, que ce soit lors de la création du Parti libéral Constitutionnel, ou Destour, suivi plus tard de la création du Néo-Destour, ainsi que la création des premiers mouvements syndicaux, comme l'UGTT, participèrent de ce combat pour la liberté et l'émancipation, avec en exergue les exigence en matière de séparation des pouvoirs, dans le domaine politique, judiciaire, exécutif, et un désir de progrès social, notamment dans le domaine de l'éducation, avec l'émergence des premières figures charismatiques, politiques syndicales, qui allaient réussir à s'affirmer contre le pouvoir colonial.
De la première République, après l'indépendance, on a écrit beaucoup de choses, notamment concernant le règne sans partage de Bourguiba et de Ben Ali. Certaines mesures positives comme le Code du Statut Personnel, pour le Droit des Femmes, instauré en 1956, ou encore les mesures en faveur de l'éducation et la scolarisation du plus grand nombre, contribuèrent à faire de la Tunisie un pays moderne, favorisant certaines mesures de progrès social, et la volonté de Bourguiba, dans la Constitution de 1959, sans rompre avec l'islam, d'en réaliser une interprétation plus progressiste que d'en d'autres pays arabes. La République fut rapidement instaurée, pour constituer une rupture avec la monarchie d'antan. Mais les projets initiaux d'indépendance de la Justice, et d'indépendance du pouvoir exécutif, par rapport au pouvoir législatif furent déçus, dans la mesure où le pouvoir autocratique de Bourguiba, notamment, s'affirma de manière importante, pour brider les libertés publiques, notamment par la décision du "combattant suprême" de nommer lui même les magistrats, ou d'intervenir dans les procès, pour expliquer que les magistrats ne devaient pas s'"embarrasser de détails inutiles", dans la conduite des procès. L'ouvrage de Kamel Jendoubi met en évidence les dérives du pouvoir autoritaire de Bourguiba, avec la présence de grands procès: procès de la gauche tunisienne "perspectiviste , dans les années 60, procès de l'expérience collectiviste de coopératives mal gérées, procès des islamistes dans les années 80. De lourdes peines infligées, la pratique de la torture, et l'Etat de droit bafoué. La poursuite de l'autoritarisme, avec Ben Ali, et l'État policier, plus la corruption et l'enrichissement personnel du clan ben Ali, ainsi qu'une liberté de la presse inexistante. Le "féminisme d'État" instrumentalisant le "féminisme de la société civile", maintenait le régime politique de la première République dans une position ambigüe. L'ouvrage collectif de Kamel Jendoubi dresse ainsi un bilan sans concession mais contrasté de la première République, dans lequel le "combattant suprême" prend la figure ambigüe du "despote moderniste", qui réussit la décolonisation mais n'instaure pas la démocratie.
La Révolution de 2011, avec le départ de Ben Ali, les martyrs du 11 Janvier, puis ceux sacrifiés pendant la troika par des groupes terroristes, les premières batailles pour l'indépendance et la liberté de la presse, malgré la résistance affichée des mouvements intégristes, les premières mesures démocratiques, avec la constitution d'élections libres et pluralistes, la légalisation de multiples partis politiques réellement indépendants, le travail d'une Assemblée Constituante chargée de rédiger une Constitution, et le rôle pacificateur du Quartett, émanation de la société civile, et prix Nobel de la paix, en 2014, pour avoir su éviter une crise majeure au sein du pays, et inviter toutes les parties prenantes, de la jeune démocratie tunisienne à négocier. Le livre de Jendoubi pointe également les imperfections du régime actuelle, avec l'absence persistante d'une "Cour Constitutionnelle", qui ne permet pas, en tant que contre pouvoir, de corriger ou de trancher l'interprétation des lois, concernant notamment leur conformité ou non avec la Constitution: il se pose notamment le problèmes épineux de l'interprétation de l'islam, à travers les notions floues "d'atteinte au sacré" , et "atteintes aux bonnes moeurs", qui touchent à de nombreux sujets de société. Le problème persistant concernant l'État de Droit, et les libertés publiques, malgré une plus grande transparence, sur les insuffisances de l'État en matière de Justice, notamment par la publication des travaux de "l'Instance Vérité et Dignité", instance indépendante qui permit d'effectuer un bilan des régimes autoritaires depuis l'indépendance, en matière d'abus de pouvoir, et permirent d'effectuer des recommandations pour corriger ces injustices, à défaut de voir le pouvoir politique s'emparer réellement de ces préconisations.
L'ouvrage collectif de Kamel Jendoubi dresse ainsi un bilan historique sérieux d'une expérience politique et historique singulière d'un pays du Maghreb, d'une Nation, une sorte de droit d'inventaire efficace pour penser le devenir de cet espace géographique intéressant à plusieurs points de vue.



