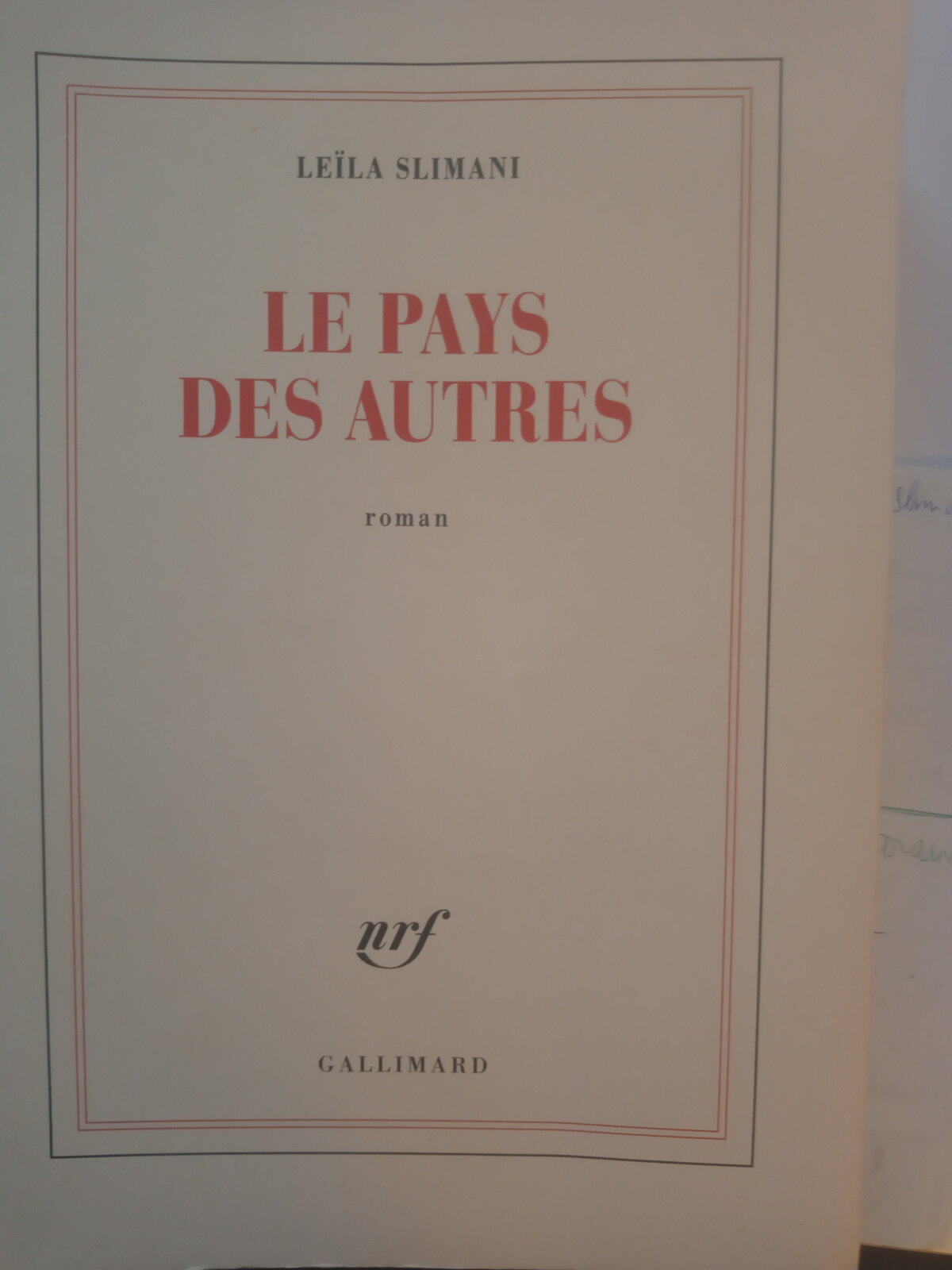
Agrandissement : Illustration 1
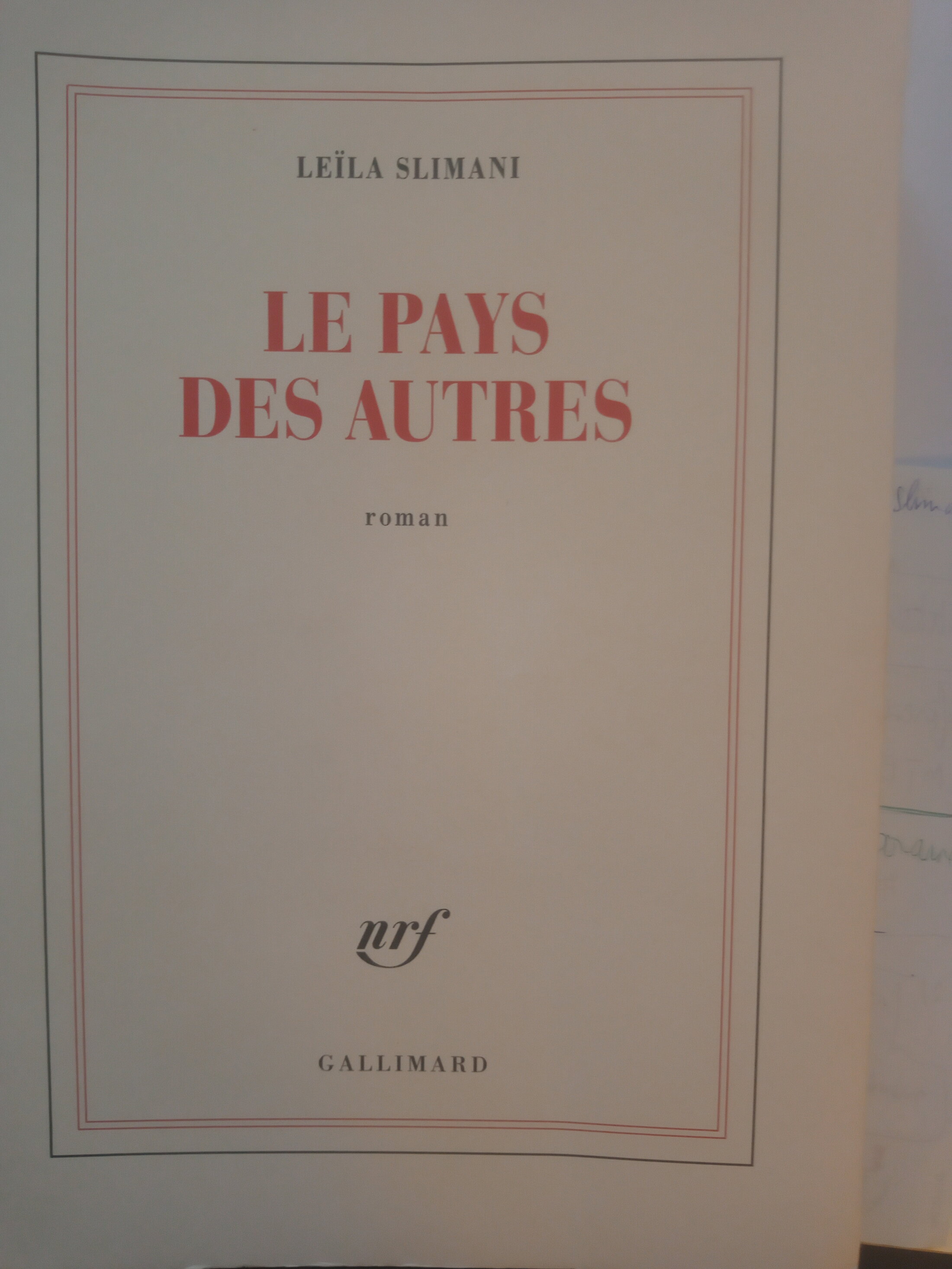
En Mars 2020, Leïla Slimani publiait "le pays des autres", roman autobiographique et premier épisode d'une trilogie (ce récit de fiction relate l'histoire néanmoins véridique de sa grand mère maternelle, avant la publication du "parfum des fleurs la nuit" en 2021, puis "regarder nous danser", 2021), et qui critique l'esprit patriarcal de la société marocaine, dans les années 50. Amine Belhadj et Mathilde se sont rencontrés pendant la deuxième guerre mondiale, et se sont mariés après ce conflit. Amine était un soldat marocain et combattait pour les français contre l'occupant nazi. Mathilde est française, issue d'une famille alsacienne. Tous les deux se sont unis et sont partis s'installer à Meknès au Maroc, où ils ont construit et ouvert une ferme pour y pratiquer l'agriculture et cultiver des agrumes. A travers ce couple mixte, dans laquelle Leïla Slimani dresse un portrait ambigü du couple et surtout du mari, Amine, la narratrice critique l'esprit patriarcal qui prévaut à cette époque: l'homme a le pouvoir, au détriment de la femme, notamment dans la vie domestique, mais aussi dans la vie sociale et économique, malgré les désirs d'émancipation féminins manifestes. Le pays dans lequel Amine et Mathilde sont partis s'installer est toujours "le pays des autres" dans lequel on se sent étranger et donc mal à l'aise: celui des "colons" qui possèdent les meilleures terres au détriment des autochtones qui éprouvent du ressentiment à l'égard de ces derniers, celui des nationalistes qui se radicalisent, ou celui des "hommes" qui ont le pouvoir de décision au détriment des "femmes".
La vie individuelle de ce couple mixte dans la ferme de Meknès est émaillée de rapports de force permanents, dans une subtile critique sociale: Amine s'occupe de l'économie de la ferme et entend prendre les décisions seul en conséquence. Mathilde, elle, fait la cuisine, s'occupe des tâches ménagères et prend soin de l'éducation de sa fille Aïcha, qui est scolarisée dans une école primaire catholique. Mathilde aimerait partager les tâches de son couple, en commun avec son mari, plutôt que de voir chacun s'exercer dans son domaine spécifique: à l'homme le pouvoir économique, à la femme les tâches ménagères, tel est le cliché imposé par la société patriarcale type, et qui peut parfois perdurer encore aujourd'hui. Mathilde aimerait néanmoins donner son avis sur la façon dont son mari gère sa ferme: la façon dont il aménage les travaux de terrassements et d'agrandissements et les instructions qu'ils donne à ses ouvriers. La manière d'orienter l'économie agricole, et notamment la culture des agrumes, notamment celle des d'orangers. Enfin les propositions hasardeuses, dont elle se méfie plus qu'Amine, comme ce paysan qui propose au couple de leur vendre des bovins (moutons ou vaches), mais dont l'offre se révèlera un leurre, malgré la présentation alléchante. Le désir de Mathilde d'intervenir dans la vie économique du couple se heurte à la résistance systématique d'Amine, qui ne comprend pas que le souhait d'émancipation des femmes passe aussi pour le travail et que le rôle des femmes dans la société ne doit pas se limiter à être cantonné aux contraintes des tâches ménagères de la vie domestique. Mathilde accueille favorablement la venue du médecin gynécologue hongrois, Dragan, dans l'univers de la ferme du couple, à Meknès. Dragan devient un ami du couple, et propose à Amine d'exporter ses oranges, en Europe, et notamment en Hongrie, son pays d'origine. Mais parallèlement il attise la curiosité et l'intérêt de Mathilde pour les sciences médicales. La femme d'Amine s'improvise bientôt infirmière bénévole, pour soigner, dans la ferme les bobos des enfants d'ouvriers employés par Amine.
Petit à petit, les rapports entre Mathilde et Amine vont se tendre, et l'équilibre précaire du couple se fissurer. Amine reproche à Mathilde de dépenser trop d'argent pour les vêtements de sa fille Aïcha. Mais celle-ci s'avère être une élève très douée à l'école, à la grande surprise de ses parents, qui reçoivent les félicitations de l'institutrice. Là encore l'école demeure un moyen d'émancipation pour les jeunes filles. Mais ces talents féminins ne sont pas mis en valeur ou accompagnés favorablement par la société patriarcale: tel est l'un des enseignements pointés du doigts par Leïla Slimani, dans son récit: ces talents suscitent incompréhensions, malentendus ou méfiance. C'est à l'école, au Lycée, que Selma, la soeur d'Amine, tombe amoureuse d'un élève français. Amine, pourtant marié à Mathilde, et donc composant avec elle un couple mixte, n'entend pas favoriser cette union, et ordonne à Selma d'épouser un marocain musulman, subissant ainsi l'influence ou les pressions de son frère Omar, nationaliste très radical, et donc tenant d'une ligne très conservatrice. La société patriarcale s'avère castratrice même dans la sphèr amoureuse. Mathilde, au lieu de susciter la compassion n'inspire que du mépris de la part des colons français qui ne comprennent pas qu'elle puisse être l'épouse d'un marocain, qu'elle aimait pourtant au sortir de la guerre. Finalement, Mathilde, comme Selma doit se résigner et remettre à plus tard ses rêves d'émancipation: Selma a épousé l'homme qu'Amine lui a choisi plutôt que celui qu'elle aimait, et Mathilde doit accepter le mode de de vie sociale qu'on a choisi pour elle, plutôt que celle qu'elle rêvait. Telle est l'épilogue du récit de Leïla Slimani, alors qu'Aïcha, la jeune écolière n'éprouve plus aucune sympathie à l'égard des colons qui subissent les assauts de plus en plus répétés des nationalistes et paysans se soulevant contre eux. La critique du monde patriarcal réside dans ce déséquilibre entre le rôle joué effectivement par les femmes dans la société et celui qu'elle souhaiterait pouvoir exercer dans un univers fait et décidé par les hommes, et l'existence d'un conflit manifeste né de ce déséquilibre.
Leïla Slimani, "le pays des autres", Gallimard, 366 pages, 20 euros



