En quoi la financiarisation a modifié structurellement le capitalisme ?
La financiarisation, processus qui a débuté à la fin des années 1970 à la suite des politiques de libéralisation de la finance, a fait basculer le capitalisme fordiste des Trente Glorieuses (1945 – 1975) vers un capitalisme « actionnarial ». Ses principales caractéristiques sont le rôle central des marchés financiers et des investisseurs institutionnels, un partage des richesses en faveur du capital et au détriment du travail, une gestion des entreprises dominée par les intérêts des actionnaires et les rendements financiers à court terme ainsi que la perte d’autonomie des politiques économiques des États face aux marchés financiers.
La révolution technologique du numérique a-t-elle accru les inégalités ?
La révolution technologique en cours, souvent qualifiée de quatrième révolution industrielle, fondée sur les innovations numériques et sur l’intelligence artificielle (IA), a amplifié plusieurs types d’inégalités. D’abord, les inégalités dans le monde des entreprises avec la domination des grands secteurs d’activité dominés par de puissants oligopoles : les GAFAM aux États-Unis et les BATX en Chine dans le secteur numérique, les Big Pharma (Pfizer, Bayer, Novartis), les « major » dans l’énergie (BP, Shell, Total) et les groupes bancaires (HSBC, Goldman Sax, BNP Paribas). Le numérique a conduit à trois autres formes d’inégalités. Notamment, la fracture numérique dans la population en fonction de l’âge et du niveau d’éducation mais aussi la restructuration du monde du travail autour de deux classes sociales : une classe de salariés précarisés par le développement de la robotique et une deuxième classe, en forte croissance, de contractuels indépendants, « entrepreneurs de soi », travailleurs indépendants formant le nouveau prolétariat du digital labor. Enfin, le numérique a amplifié les inégalités internationales avec la domination des pays à la pointe de la révolution technologique dont les entreprises multinationales ont profité des bas salaires des pays du Sud en créant des chaines de valeur globales.
L'intelligence artificielle apporte-t-elle des modifications encore plus profondes ?
La révolution de l’IA aura des effets nombreux et profonds, de nature systémique. Les utilisations de l’IA s’appliqueront dans de nombreux domaines, notamment l’analyse et le traitement de grosses bases de données (big data) ; la vision (reconnaissance faciale) ; le traitement automatique du langage (traduction). L’IA générative, caractérisée par sa capacité d’apprentissage, va amplifier le rôle du numérique. De nombreux métiers seront impactés (médecine, cinéma, journalisme, …), pour le meilleur (efficacité accrue) et le pire (disparition) tout comme d’une manière générale, l’ensemble de la société (sphères domestique, politique et productive). Il y a un débat sur l’ampleur des effets de l’IA. En premier lieu, la limite de l’IA est, à la différence de l’intelligence humaine, de n’apporter des solutions intelligentes que sur une fonction précise et bien définie. Par ailleurs, les experts sont divisés sur l’efficacité de l’IA, et plus généralement du numérique. Selon les grands cabinets de conseil tels que McKinsey, l’IA amènerait des gains de productivité de 2% à 8% par an dès 2028. Mais la plupart des travaux académiques sont plus nuancés, en se basant sur le constat que la multiplication des innovations technologiques depuis la fin du siècle dernier est allée de pair avec un ralentissement général des gains de productivité jusqu’aux années 2020. C’est le fameux paradoxe de Solow.
Est-il encore possible de réguler tout cela ?
Le capitalisme mondial est rentré au début du XXIe siècle dans une crise systémique, une des plus profondes de son histoire, dont la grande crise financière de 2008 n’est qu’une des manifestations. La profondeur de la crise est liée à son caractère pluridimensionnel : financier, social, écologique, démocratique et géopolitique. Cette crise globale est le signe d’un changement d’époque. La célèbre phrase d’Antonio Gramsci s’applique aujourd’hui : « La crise consiste dans le fait que l’ancien monde meurt et que le nouveau ne peut naitre ». Les pays capitalistes de la planète sont d’une grande diversité et ne réagissent pas de la même manière face à la crise, comme l’illustrent les cas des capitalismes états-unien et chinois. La sortie de crise est possible à plusieurs conditions. Les politiques menées avec succès dans les années 1930, à la suite de la précédente crise systémique du capitalisme, sont intéressantes à analyser car elles montrent la nature des politiques à mettre en œuvre. D’abord, abandonner les politiques libérales fondées sur le laisser-faire qui sont une des causes de la crise actuelle et développer des politiques publiques dans les domaines stratégiques tels que l’écologie et la réduction des inégalités. Ensuite, réduire le pouvoir des oligopoles, en démantelant ceux-ci comme cela a été fait dans le passé dans les secteurs stratégiques des banques, du pétrole et des télécommunications. Enfin, en construisant de nouvelles formes de coopération internationale, à commencer par la protection des biens communs de l’humanité, en particulier le climat. Il est clair que les politiques menées actuellement par plusieurs grands pays capitalistes, à commencer par les États-Unis sous l’administration Trump, tournent le dos à des conditions de sortie de crise. Mais ces politiques sont-elles soutenables à terme ?
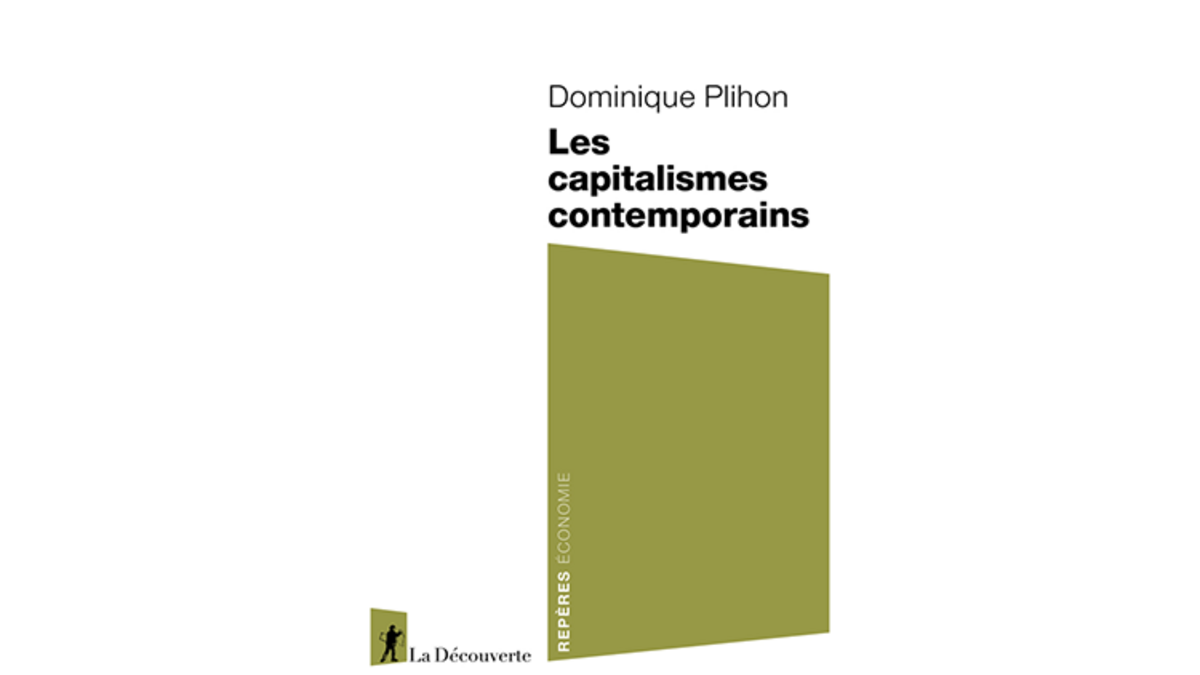
Agrandissement : Illustration 1
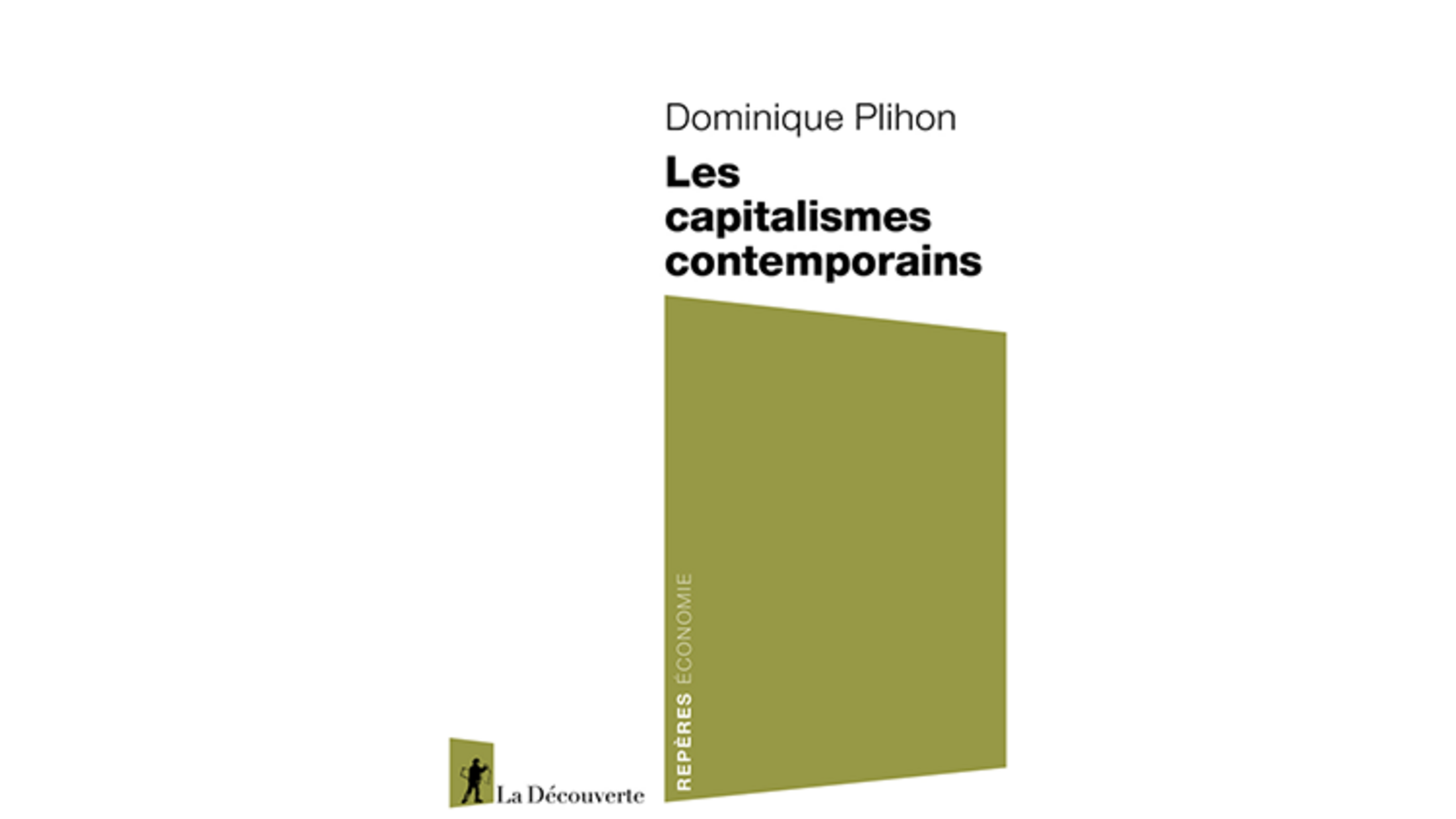
Cet entretien est également disponible sur mon blog et sur le site de l'IRIS.



