- Prologue
Grâce au souvenir cordial de Patrick Saurin, le beau livre de poésie nahuatl -"Ni xochitl, ni kuikatl, Le chant des fleurs" (JBE Books, 2023), écrit par Mardonio Carballo- arrive entre mes mains. Il est rédigé dans la variante de Chicontepec, Veracruz, Mexique et traduit en français par Saurin. Sa composition établit un dialogue entre la parole et l'image, puisque chacune des six sections du recueil de poèmes n'est numérotée. Son prélude est annoncé par une illustration fleurie de Fernando Laposse. Ce va-et-vient entre le mot et l'image définit l'écriture poétique comme un véritable art de la peinture, que les pinceaux colorent la page blanche, ou que les mots colorent le monde des choses en les nommant.
Comme le dit le prologue « Mots de fleurs » d'Alberto Manguel, « en voyant le monde » sans mots, le langage lui donne une « identité » à travers les noms, tout en construisant des « ponts » intersubjectifs entre les locuteurs. Plus qu'une référence directe, les différentes langues proposent des « métaphores » qui transportent des « objets matériels » vers une communauté dans son habitat particulier. Cette coexistence de l'être humain et de l'environnement génère une corrélation intime entre les deux. Sans parvenir à un dialogue direct - peut-être - les "objets" réels sont revêtus d'"émotions", puisqu'ils expriment leur être vital dans les noms qui les qualifient.
Par conséquent, « le chant des fleurs » pourrait être glosé par une paraphrase plus large. La mélodie d'une culture émane de la po-Ét(h)ique lorsqu'elle nomme le Monde. D'Anthos à Xochitl et Xuchit, la Fleur évoque la dissémination qui naît de la parole. Des choses « fleurissent » des choses dans le nom : xuchi-kisa, fleur-sortir ; mo-xochi-tia, se-fleur-cause/fait. Tandis que les pétales se dispersent dans le vent – les étoiles dans la nuit – la tâche de la poésie est de collecter (Logos, T(l)apixka). Il faut récolter sans cesse pour préserver l’énergie latente dans les archives communes de la mémoire cordiale.
Voici maintenant une revue détaillée des six sections du recueil, mettant en lumière le lien intime entre l'être humain et la faune et la flore qui soutiennent son existence. Comme mentionné, les divisions remplacent les chiffres habituels par de magnifiques dessins de fleurs et d'animaux (insectes, oiseaux, papillons, etc.) qui voltigent joyeusement à côté d'eux. Une seule de ces illustrations est jointe.
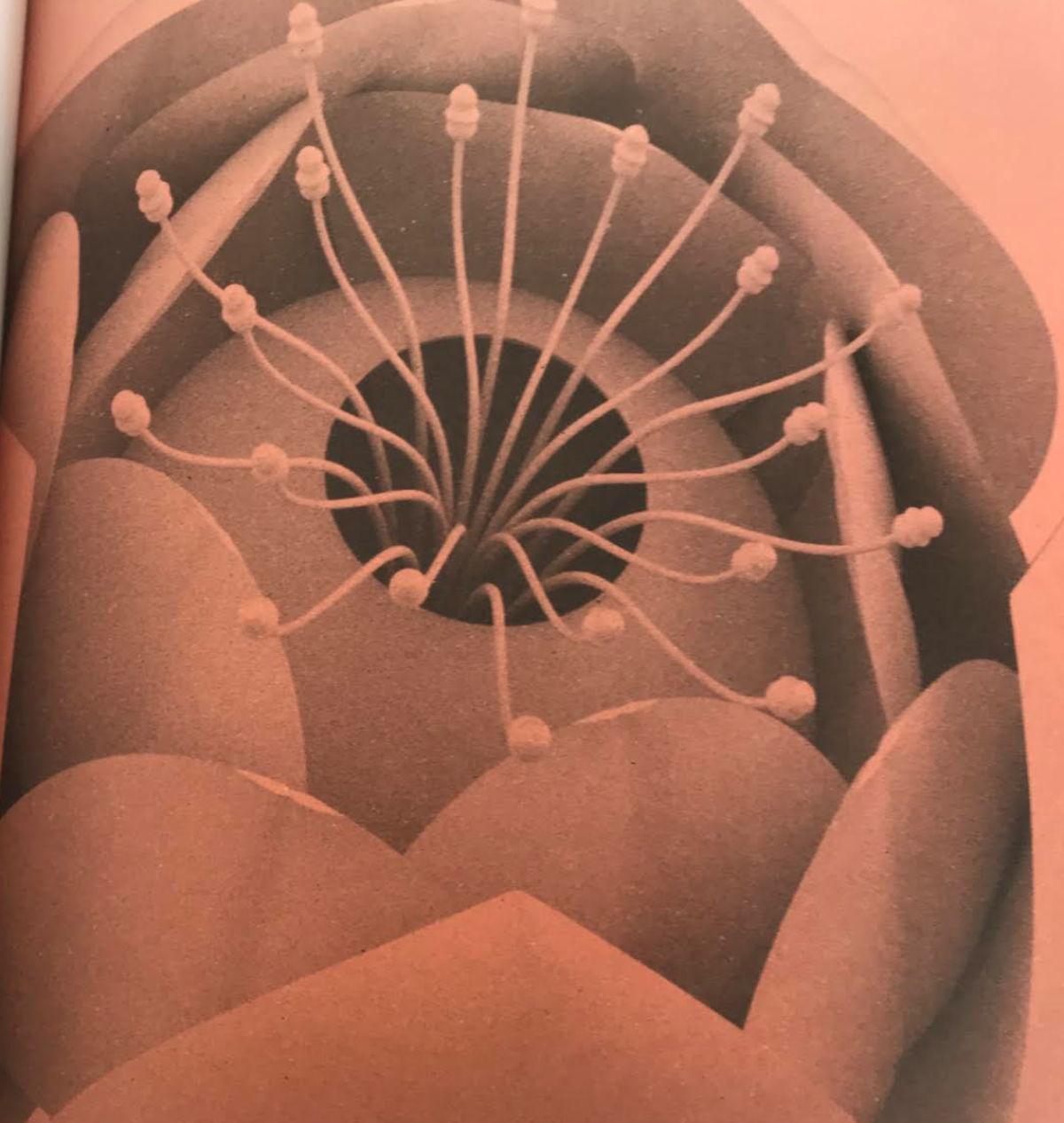
Agrandissement : Illustration 1
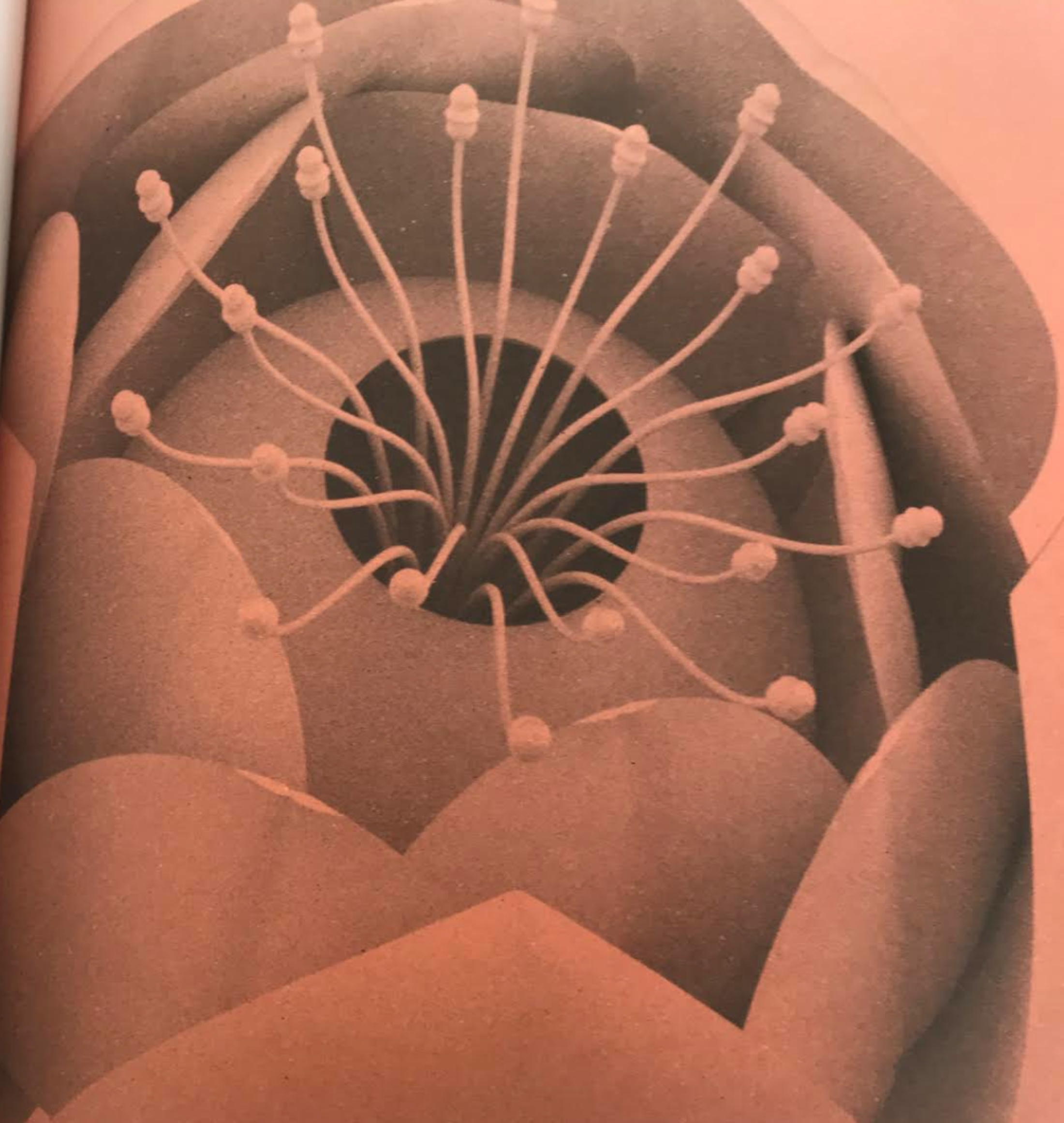
I. Texte - Textile
Composé de neuf poèmes - plusieurs sur le modèle du Haïku - à la référence fleurie prévue s'ajoutent l'énergie émotionnelle du cœur et de l'araignée comme prototype du poète. Dès l’origine, le bourgeon symbolise l’écriture poétique à l’état naissant. On l'appelle "pil-xochi-tzin, petite fille aux fleurs", où le diminutif exprime sûrement la révérence. Sa culture – mo-xochi-mil-chiua-ti, se-fleur-champ-de-maïs-cause/fait, faire fleurir le champ de maïs – évoque le champ qui produit la nourriture quotidienne. La « fleur de coton » offre tout à la fois la limpidité de la page blanche et la matière première de la robe : ichka-pil-xochi-tzitzin, coton-fille-fleur-diminutif. Pour cette raison, elle attire le charme des oiseaux – le colibri et le cenzontle – qui voltigent autour de son arôme. Ce parfum évoque également la séduction de « l'arbre xilo-xochitl, jeune fleur de maïs » dont l'extase comestible magnétise la jeunesse. Sans transgression d'aucune loi, le développement fleuri passe du grain enfoui et invisible, à la couleur aromatique, jusqu'à finir dans la poussière, la mort comme unique destin. Peut-être qu'il se dépose comme les feuilles et que les gouttes tombent (uetzi...) pour fertiliser la terre. Quant au « -yol-, cœur », le chant fleuri provoque une série de sentiments qui s'enracinent dans ses battements. Trois composés verbaux —-yol-uiteki, battement/foueter ; -yol-yamani, adoucir-soulager et -yol-tlalana, exalter/élever—certifient son importance. Centre émotionnel du corps, il accueille non seulement le rythme des couleurs et des parfums mais aussi le déverse dans l'écriture sonore. Enfin, la « tokatl, araignée » « tla-tsajti-nemi, tisse » un texte-textile qui dicte la manière d'écrire la plus appropriée, très différente de celle occidentale. Elle ne se poursuit pas en ligne droite de gauche à droite, ni vice versa. Elle ne descend pas non plus du sommet au ravin de la page. Au lieu de cela, elle semble inscrire son désir de devenir une étoile. Au modèle conventionnel de l'écriture linéaire, la toile d'araignée graphique oppose la rotation astrale, puisque la spirale trace l'univers de la poésie. Ainsi, la floraison, la pulsation et la révolution synodique dessinent le triangle notionnel de cette première section.
II. Cultiver
Sept poèmes composent la deuxième section, plus longue. La fleur d'oranger entame ce nouveau tournant avec son double contenu en union d'opposés : doux et amer à la fois. L'essentiel de son exemple est « d'ouvrir/germer, kue-poni » comme les lettres imprimées sur le papier. Les feuilles – leaves and sheets – tombent à mesure que le temps s’empare du monde et nous vieillit. Ce n'est pas en vain que la racine verbale – poni, puni(a) en nahuat salvadorien – ne fait pas seulement référence à la « germination, à l'apparition » d'une pousse. Elle associe également la « naissance » à l'éruption volcanique, dans une expulsion originelle qui façonne la terre, le corps humain et la flore (la variante salvadorienne n'apparaît pas avec le début/préfixe kwe/cue-poni et change le /o/ en / u/, puni(a), "accoucher, naître, éclater, germer"). La poésie perpétue le rythme circulaire des saisons annuelles. Cette vocation est inscrite sur la main. Dans la main, "la mère me lit, no-nan nech-ma-poua..." le destin du dessin des lettres puisque ses lignes établissent le lien entre "faire le champ de maïs, mil-chiua" et le "poème, xochi - tlajtol, le langage des fleurs", le discours des fleurs. Tatouée à la naissance, la main non seulement écrit mais, en transpirant ses larmes, se souvient de l'amour perdu dans la danse, ainsi que du vol de la mère comme un papillon. Heureusement, cette tristesse est dissipée par « l'étreinte » de « deux arbres » dont la joie de la rencontre arrose les feuilles et étend les fleurs au vent.
III. De la Lune à la pluie de larmes
Divisée en huit poèmes plus longs, il n'est pas surprenant que cette troisième section commence par « Metztli, Lune ». En effet, celle-ci guide la (re)production naturelle et humaine. Elle nomme les mois, tout comme elle est liée à l'héritage maternel de la langue. Aussi, elle est liée à la mer – ueyi-puyek-atl, grande-eau salée – qui préserve son attribut féminin et fournit la flore aquatique qui exalte le chant. La musique de la Lune diffuse le chant vers les étoiles. Son mouvement rotatif est une danse lumineuse qui accompagne l'arrivée du Prométhée mésoaméricain : Tla-kua-tzin, le Petit Mangeur, qui prodigue le feu. Il est aussi brillant que le zintli-kuikatl dont le fruit – « zihua-pil-zintli, la petite fille du maïs » – répand ses grains nutritifs vers l'enfance. L'enfance se nourrit de la tortilla, dans son voyage vers la Lune et le Soleil. L'Oiseau-Soleil —Tonal-Tototl— disperse sa chaleur en plumes au vent. Pendant ce temps, lors de l'apprentissage du « -Xochi-tlatoa, le langage des fleurs », l'enfant a la responsabilité de traduire « le langage silencieux des choses » dans sa langue maternelle. Mais tout l'environnement n'est pas que joie, puisque les fruits envahissants de la tête ou des fesses provoquent des danses moqueuses. Les abeilles voltigent autour de cette ruche qu'est le corps humain, ivre et triste. Il y a un rejet clair des « cheveux longs » et des « mal habillés » à qui tout hébergement chaleureux est fermé. Ce dédain est incarné par « l'ayotl, la tortue ». Une image de migrant qui porte sa maison sur son dos, peut-être que sa patrie est partie en exode. Le "sang" dirige son chemin, tandis que les "mouches" scrutent son ventre. Ses pleurs se confondent avec la pluie, en raison de la difficulté de distinguer l'eau qui tombe des larmes en irrigation poétique. Évidemment, le "-yol, coeur" surgit à nouveau pour exprimer cette mélancolie : -yol-kuika, chant cordial ; -yol-choka, pleurs cordiaux ; -yol-kokoa, souffrance cordiale.
IV. Plusieurs sens
Deux longs poèmes et cinq courts composent cette quatrième section. Les méandres du reptile construisent le sens – voie et sens (way and meaning) – que les mots acquièrent lorsqu'ils passent du son au contenu multiple : une rue aux multiples voies avec autant de bas-côtés qu'il y a de participants à un colloque (pensez à l'espagnol "sentido", terme appliqué à rue à "double sens" et aux mots). Par ce transfert, le colibri devient un personnage masculin dont le « long bec » imite le phallus, à la recherche de nectar et de pollen. Comme l'homme "ki-kal-akiz...mo-chan, pénètre dans ta maison". Le chant cordial, le rythme du chant, est un appel au couple qui l'accompagnera. Peut-être que cette correspondance imagine la copulation comme un acte de pollinisation – collecte de pollen et de nectar – semblable au travail de l’oiseau ; et vice versa, la collecte de la matière première pour le miel imite les rapports sexuels. La compréhension doit surpasser toute colère. Autrement, le « zem-poal-xochitl, fleur des morts, fleur-vingt/un-compte » s'inverse dans la mort de la fleur, c'est-à-dire la clôture de la poésie. Mais l'espoir naît du « grain » dont l'enveloppe contient la vie elle-même dans son enterrement, dans son semis annuel. Cette révolution synodique est concentrée dans le terme « xiouitl » dans son triple sens « année, comète, feuille ». Dans ce triangle de fuite notionnel, tout « passe, tombe et s'en va ». Cela reste en suspens si dans sa chanson, « to-yolo » ne fait pas seulement référence à l'énergie de l'âme qui fait bouger tout ce qui existe : « notre-cœur ». Il fait également référence à la « graine » qui contient le pouvoir végétal, « to-nej-nemi-liz, notre vie » elle-même.
V. L'Arbre du Ciel
Les quatorze poèmes de cette cinquième section élargissent le thème qui lie la poésie à l'environnement naturel. Au début, le poète regrette la disparition de la mère qui s'écoule vers l'infini comme les eaux des rivières et des ruisseaux. Son action procréatrice ressemble peut-être à celle du « zintli, maïs », dont la nudité même engendre « des animaux, des hommes et des femmes ». La « fleur sur le tronc » bouge au rythme du « vent », tandis que ses lèvres s'ouvrent au chant. De son côté, la « a-pipialotl, libellule » assure le poète de sa vocation de Virgile, puisqu'elle le guidera pour retrouver l'histoire. Dans un sens poétique, je lui montrerais l'endroit « kan nej-nemin...mijkatzizin, où vivent... les morts ». Le « nakaz-kuauitl, arbre à oreilles », est un emblème du « sacré ». Non seulement il entend le bruit du monde, mais ses oreilles parlent. Ils prononcent le Verbe-Logos créatif – Teo-Tlajtolme – du Monde, c'est pourquoi les oiseaux et le poète se rassemblent auprès de lui pour imiter son chant. Tout grand arbre danse, fleurit et enseigne — même au Soleil — que ses rayons lumineux sont de véritables pistils qui attirent les piqûres des abeilles lorsqu'elles écrivent. Cette même projection de la flore vers l'astral est reproduite par les étoiles, transfigurées en coton du ciel. Le témoignage poétique de ce miroir universel – ciel et terre en harmonie – le poète le transcrit dans les ailes blanches du papillon. Son vol est danse ; c'est la poésie chorale de la symphonie de l'Univers.
VI. Être humain oiseau
Cette section terminale est la plus courte, composée de cinq poèmes qui reprennent les thèmes de la fleur et du vol. Dès l'origine, les êtres humains assument eux-mêmes la vocation d'oiseaux – toto-men – ils dansent, chantent pour demander la pluie, tla-a-uetzi. L'arbre marque l'épicentre de sa demande. Si la pluie tombe sans tristesse, le tonnerre en prélude imite la fleur lors de la sensation colorée des éclairs. C'est une musique fleurie. Comme les autres sections, la fleur – lalax i-xochio, la fleur d'oranger – renouvelle la clameur et les émotions cordiales de celui qui la contemple. Si son exemple était appliqué, l'écriture poétique provoquerait un sursaut similaire, puisque le "-tlajtol...-yol-ketza, (le) mot...cœur-élève", grâce à la splendeur du "xochi-mantli, fleur-jeune/décoré". Ainsi se termine l’ornement poétique immergé dans toutes les langues.
VII. Colophon
Un examen plus détaillé nécessiterait de recenser toutes les espèces de la faune et de la flore. J'identifierais leur nom scientifique – leurs attributs botaniques et zoologiques – puis j'analyserais les noms nahuatl, jusqu'à conclure avec leurs qualités mytho-poétiques et leurs sentiments personnels. A défaut, le commentaire met en évidence plusieurs correspondances entre l’écosystème et les affections humaines. Cette identité mytho-poétique suggère d’élargir le canon littéraire monolingue vers une diversité linguistique tombée dans l’oubli. Cette inauguration est pertinente pour le Salvador, un pays dans lequel jusqu'en 2024 il n'existe pas un seul volume multilingue sur les langues maternelles ancestrales, dans leur mytho-poétique unique. Le déni de la présence dans le substrat définit l’union des contraires, c’est-à-dire l’oubli de la mémoire historique nationale. En ce sens, la lecture de Carballo incite à renverser ce rejet pour opérer une première ouverture vers la différence. Cela ne fait aucune différence si le modèle inaugural n’admet pas que les choses et les faits n’ont pas de nom propre en espagnol. Ce n’est qu’en évaluant les multiples surnoms qu’un dialogue s’ouvre avec la op/contre-position des multiples pseudonymes que chaque langue accorde au même fait. Ce n’est pas pour rien que le manque de souvenir rejette la réflexion sur le lien intime entre l’écosystème et l’être humain, c’est-à-dire l’Être-dans (Dasein). Il oublie aussi volontairement —-il/el-kaua— les racines corporelles qui guident la prétendue objectivité historique, la mémoire sans souvenir, -il/el-namiki (l'espagnol re-Cordar). Si dans la section I j’ai souligné la pertinence de « -yol, corazón » – sans re-Cuerdo/Cordialité en espagnol – le lecteur saura comment ce même manque d’affect enracine la dualité mémoire-oubli dans un autre organe anatomique. Bref, le lien corps-épistémè s’ajoute au lien substantiel entre l’être humain et la nature. Seule l’admission d’un canon multilingue reconnaîtra la subjectivité de l’objectif. La lecture de "Le Chant des fleurs" de Mardonio Carballo oriente une réflexion vers l'enfermement d'un canon littéraire monolingue.



