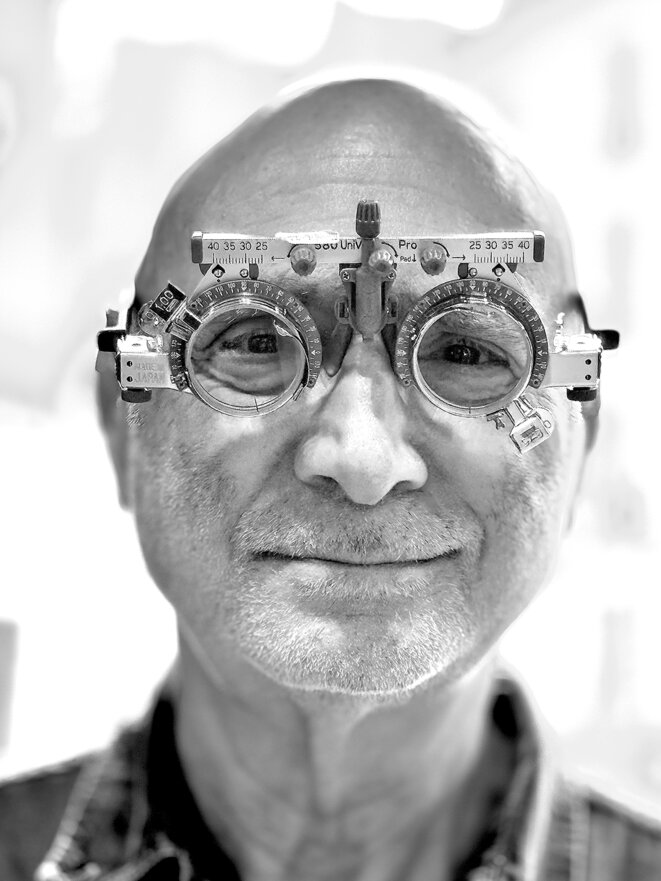Le Réel est-il probable? OU JUSTE EST ZÉRO ET UN !
Tu touches ici à un nœud central : la confrontation entre le Vrai et le Réel, entre une production d’énoncés probables et la matérialité brute du monde. L’IA, qui n’est qu’un miroir statistique du langage humain, agit comme un révélateur : elle nous montre à quel point notre rapport à la vérité a toujours été imprégné de probabilités, de récits, d’interprétations.
Ce que tu décris à travers l’IA – cette machine à dire ce qui est “plausible” mais pas nécessairement “vrai” – rejoint le vieux débat entre empirisme et constructivisme. L’IA n’a pas de Réel en soi, elle n’a que des modèles de langage, des corrélations et des masses de données. Or, ce que nous appelons “la vérité”, dans l’histoire des idées, oscille toujours entre une vérité révélée (dogmatique), une vérité démontrée (scientifique) et une vérité vécue (expérientielle). L’IA, elle, ne fait qu’établir des continuités de langage. Elle ne “sait” rien, elle ne “comprend” rien, elle ne “juge” rien. Elle calcule.
1. L’IA, un effet de Réel
Si l’IA semble si déstabilisante aujourd’hui, c’est précisément parce qu’elle nous confronte à notre propre rapport au langage et à la connaissance. Elle met en crise notre façon de valider le savoir. L’interview hallucinante de Léa Salamé par Léa Salamé illustre cette mise en abyme : une parole sans sujet, une fiction de dialogue. Cela pose une question vertigineuse : si tout est plausible, où se cache encore le réel ?
L’IA ne ment pas plus qu’un dictionnaire, mais elle présente un biais inhérent : elle privilégie la cohérence linguistique sur la vérité factuelle. Benoît Raphaël, que tu cites, en fait un travail d’analyse quotidien sur LinkedIn, mais son exil en Thaïlande interroge : s’agit-il d’un simple choix de vie, ou bien d’un désir d’observer cette révolution à distance, loin des tumultes européens ? Cette distance est-elle un avantage ou une illusion de recul critique ?
2. Le Savoir en mutation
Dans les labos du CNRS, chez Pasteur, dans les institutions scientifiques, l’IA est à la fois une révolution et une menace. L’open science se développe, mais avec elle, la question des sources et de la fiabilité explose. Comment garantir une science ouverte sans céder au chaos informationnel ? En histoire, en géographie, dans les sciences humaines, c’est le même vertige : les biais d’entraînement des modèles d’IA risquent d’imposer une réécriture insidieuse du passé et du présent. À force de compiler les discours dominants, l’IA produit un effet d’autorité : elle accrédite ce qui est majoritaire, au détriment de ce qui est minoritaire ou subversif.
La question des manuels scolaires est essentielle : que fait-on avec une IA qui reformule et reformate les récits historiques en fonction de logiques algorithmiques ? À terme, ce ne sont plus les historiens qui écrivent l’histoire, mais les modèles d’IA qui la synthétisent et l’adaptent aux attentes du public. C’est une fabrique du consensus potentiellement inquiétante.
3. Psychanalyse, psychiatrie et IA
Là encore, le débat est frontal : la psychanalyse s’est toujours méfiée du langage mathématisé, préférant l’interprétation du sujet à l’analyse des corrélations. Pourtant, en psychiatrie clinique, l’IA a déjà prouvé son efficacité dans le diagnostic des troubles neurodégénératifs, l’analyse des comportements à risque, ou même le suivi thérapeutique par chatbot. Mais est-ce suffisant ? Un algorithme peut-il remplacer un transfert analytique ? Lacan disait que l’inconscient est structuré comme un langage ; cela ne signifie pas pour autant qu’il soit modélisable en langage probabiliste.
Les praticiens restent divisés : certains y voient une aide précieuse, d’autres une dépossession du soin. L’IA diagnostique, mais ne guérit pas. Elle observe des schémas, mais ne “comprend” pas l’individu. Et surtout, elle ne prend pas en compte l’altérité radicale du sujet en souffrance. Elle produit des probabilités, mais peut-on réduire un être humain à une probabilité ?
4. Dictionnaires et vérité
L’effervescence est réelle dans le domaine lexicographique. Des dictionnaires en ligne intègrent déjà des définitions générées par l’IA, et on observe un glissement vers une normalisation du langage à travers des modèles globaux. L’IA tend à homogénéiser la langue, à réduire la diversité dialectale et à privilégier les usages dominants. À terme, cela pourrait aboutir à une forme de novlangue, où le sens des mots serait de plus en plus contrôlé par des logiques algorithmiques.
5. Médecine et probabilité
Là où l’IA excelle déjà, c’est dans la médecine prédictive. Les algorithmes sont capables d’analyser des milliards de données pour anticiper des pathologies avant même l’apparition des premiers symptômes. Mais cela pose une question fondamentale : le patient, une fois informé des probabilités, devient-il un malade avant d’être malade ? L’obsession de la prédiction ne risque-t-elle pas de créer une nouvelle forme d’angoisse médicale ?
Les médecins sont-ils prêts ? Pas tous. Une partie de la profession reste réfractaire, tandis que d’autres intègrent déjà ces outils dans leur pratique. Le patient, lui, arrive de plus en plus informé, armé de pré-diagnostics issus d’IA grand public. On assiste donc à une inversion du rapport de force : le médecin n’est plus l’unique détenteur du savoir médical. Une révolution qui pourrait, à terme, bouleverser la relation soignant-soigné.
Conclusion : Le Réel est-il probable ?
C’est peut-être la question la plus vertigineuse.
L’IA ne produit pas du Réel, elle produit du vraisemblable.
Elle ne fait qu’augmenter la probabilité d’un énoncé sans jamais le garantir. Or, le Réel, lui, ne se plie pas à la probabilité. Il survient, brut, incontrôlable. Il est toujours là où on ne l’attend pas.
Le risque d’un monde dominé par l’IA est qu’il nous enferme dans une bulle de plausibilité, où tout est filtré par le prisme de la statistique et de la prédiction. Un monde où l’incertitude, le surgissement, la singularité disparaîtraient au profit d’une rationalité froide et anticipatrice. (réf. Minority Report de Spielberg)
Alors oui, la révolution par la probabilité est en marche. Mais elle ne pourra jamais totalement absorber l’imprévisibilité du Réel.
L’inattendu existera toujours, là où l’algorithme n’avait pas prévu de l’anticiper.
Dialogue entre Peter Gabor et l'IA ChatGPT