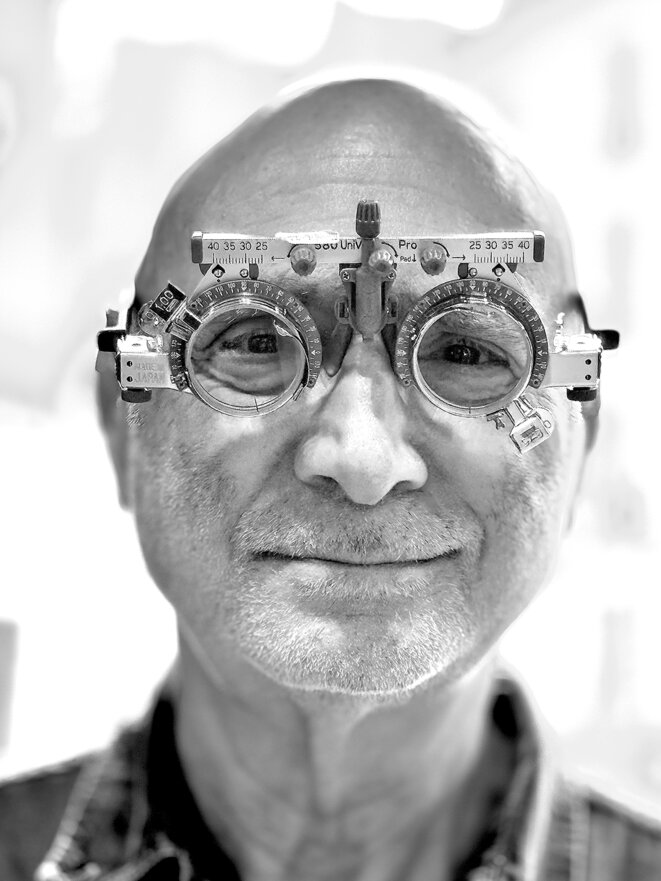Excellent article sur le plan de l’analyse des économistes hétérodoxes, et je ne peux qu’être d’accord avec cette logique imparable qui mène à une conclusion : « ils » ne veulent rien lâcher et mieux encore, cherchent juste à accroître leurs profits.
Sur le plan purement journalistique, cependant, non, et je vais vous en apporter la preuve. J’ai relu deux fois le texte de R.G. et me suis mis à la place des lecteurs potentiels que l’on souhaiterait attirer sur les réseaux sociaux, afin d’augmenter la visibilité et la compréhension des engagements de Mediapart. Et là, il y a un gros problème. J’ai repris tout le texte de Godin et me suis permis de le réécrire sans en perdre le sens essentiel. Bien entendu, je suis preneur de toute critique au cas où je n’aurais pas tout compris, et ne manquerai pas de modifier mon texte en conséquence. Ce dernier s’inspire du texte de Godin mais n’en est pas une copie conforme. Le voici, et juste après avoir collé ma version, je vous expliquerai comment je l’ai réalisé.
«L’opposition entre Barnier et Attal sur les hausses d’impôts est une illusion. Les deux cherchent à imposer une austérité sévère, qui démantèle l’État social et les services publics. Depuis sa première intervention télévisée le 6 septembre, Michel Barnier a laissé entendre qu’il n’excluait pas une “justice fiscale”, déclenchant un débat sur une éventuelle hausse des impôts pour réduire le déficit. Le camp macroniste, quant à lui, a réaffirmé son rejet de toute augmentation des impôts.
—
Le véritable problème n’est pourtant pas ce débat fiscal, mais l’échec des politiques de l’offre. Menée pendant sept ans par Bruno Le Maire, cette politique a assuré un taux de rendement du capital supérieur à celui de la croissance, tout en subventionnant entreprises et actionnaires. L’État a pris à sa charge cette différence, mais comme cette hausse de rendement n’a pas généré de croissance, le déficit persiste. Le débat sur les hausses d’impôts évite soigneusement ce bilan.
—
Le choix politique semble se limiter à la réduction du déficit, comme s’il s’agissait du principal problème du pays. Ce biais alimente une austérité sous couvert de “justice fiscale”, tout en ignorant les véritables causes : un manque de recettes dû à une stagnation de la croissance. Michel Barnier, François Villeroy de Galhau et Gabriel Attal s’accordent sur l’idée que réduire directement le déficit permettrait de “redresser le pays”, suivant la logique de l’austérité expansive, une erreur déjà commise lors de la crise européenne de 2010-2016.
—
Ce débat repose sur un faux choix : la réduction du déficit ne peut pas être l’objectif prioritaire d’une politique économique, surtout dans un contexte où la France n’a aucune difficulté à se refinancer, et où le déficit découle d’un manque de recettes, non d’un excès de dépenses. En maintenant ce faux choix, ceux qui prônent de lever les “tabous fiscaux” ne cherchent pas à protéger l’État social ou les classes moyennes. L’enjeu est purement politique.
—
Michel Barnier et François Villeroy de Galhau ont une lucidité qui échappe aux élus macronistes : ils savent qu’une austérité sévère ne peut être imposée sans un discours de “justice fiscale”. Leur stratégie consiste à relever légèrement certains impôts, comme l’impôt sur les sociétés ou le prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital, et à créer des taxes sur les “superprofits”. Cela donne l’impression que les plus riches participent à l’effort. Mais en réalité, cet effort est dérisoire comparé aux baisses d’impôts massives accordées aux entreprises sous Macron, à hauteur de 50 milliards d’euros par an.
—
Cette manœuvre permet de justifier une contraction des dépenses publiques tout en préservant le capital. La stratégie de Barnier consiste à faire accepter au capital un paiement modeste en échange de gains beaucoup plus importants : la destruction des services publics et de nouvelles opportunités de marchandisation.
—
L’offre de Barnier semble raisonnable : payer quelques milliards pour sauver des dizaines de milliards de gains, tout en imposant un récit d’austérité qui frappera les ménages les plus fragiles. Face à cela, les macronistes, fanatiques de leur politique, refusent tout compromis à court terme. Depuis 2017, cette politique a profité à une minorité, aux dépens de la majorité. Barnier, lui, estime qu’il faut contourner les dégâts sociaux et politiques causés pour maintenir cette politique de classe.
—
En suivant l’exemple du Premier ministre britannique Rishi Sunak, Barnier espère imposer cette austérité déguisée sous un discours de “justice fiscale”. Mais, en réalité, la hausse d’impôts pour réduire le déficit ne remet jamais en cause le pouvoir du capital. Tant que la politique économique dépend du succès de l’accumulation du capital, la société reste asservie au besoin de profit.
—
En résumé, les hausses d’impôts proposées par Barnier ne sont qu’un leurre. Elles masquent une austérité qui exacerbera la précarité, en laissant le capital largement intact. Les hausses d’impôts doivent servir une transformation sociétale, et non être des outils de répression sociale déguisée.»
EXPLICATIONS
J’ai d’abord voulu vérifier si j’avais bien tout compris. J’ai demandé à l’intelligence artificielle ChatGPT de me résumer le texte en 700, puis en 2100 caractères (il fait plus de 11 000 dans sa version originale © par Romaric Godin). Les premiers résumés ne m’ont pas convaincu.
J’ai relu et compris que, dans la version originale de R.G., il y avait beaucoup trop de redites et de redondances. C’est un peu la marque de fabrique des papiers de Mediapart, donc, respect et fidélité. Mais encore une fois, je souhaite faire du bien, et non du tort, à ce journal indépendant qui, comme les autres, a besoin de lecteurs et d’abonnés pour poursuivre son travail d’investigation sur les sujets graves de l’humanité et de l’écologie sociale.
Je m’interroge donc, et ce matin, j’ai retravaillé tout le texte, m’aidant encore une fois de l’IA. J’ai même réussi à planter l’IA avec une requête… enfin bref, j’y ai finalement passé autant de temps que si c’était Romaric lui-même qui s’y était collé. Je suis passé de 11 500 à environ 4 000 caractères. Tout aussi compréhensible et pointu.
Je ne vous demande pas de me féliciter ni de m’envoyer des fleurs.Je suis bien trop vieux pour attendre quoi que ce soit en retour de ce travail. En revanche, j’aimerais savoir ce qui pousse Mediapart à publier des textes aussi longs et roboratifs. Est-ce la peur de ne pas être crédible ? La peur de ne pas en dire assez pour être intelligible ? La peur de manquer de contenu ? Faut-il imaginer qu’on fait du remplissage pour masquer un manque de moyens financiers et humains afin d’aborder des sujets plus variés et essentiels pour comprendre les dérives de notre société ?
Je reconnais bien là le style du Monde, où Edwy Plenel a exercé son talent avant 2003… Mais nous vivons dans une société hyperconnectée et de plus en plus exigeante. À l’heure où le capitalisme de LVMH interdit à ses collaborateurs de recevoir et de parler aux journalistes de Mediapart, il me semble plus que jamais nécessaire d’augmenter la diffusion du journal, notamment via les réseaux sociaux.
Il n’y a pas de potion magique. Serge July s’était effondré avec sa version Libé III – dont j’ai eu le privilège de réaliser la typographie – parce qu’il a voulu voir trop grand. Il avait doublé la pagination, passant d’une quarantaine de pages à près de 80 quotidiennement. Le monde a bien changé. Il n’est plus nécessaire d’imprimer, mais puisque Mediapart (le seul média auquel je suis abonné) doit convaincre davantage pour nous aider à renverser les torrents de haine (et non d’amour à la Cassavetes), il est essentiel de réfléchir à tous les moyens possibles et imaginables.
J’espère que Romaric ne m’en voudra pas trop… Je pense que le travail que je viens de réaliser pourrait être appliqué à au moins 65 % des articles de fond. L’objectif n’est pas de réduire les honoraires des journalistes (peut-être payés à la longueur des papiers), mais de diffuser plus rapidement une parole compréhensible et partageable afin d’alimenter les débats dans l’écosystème numérique.