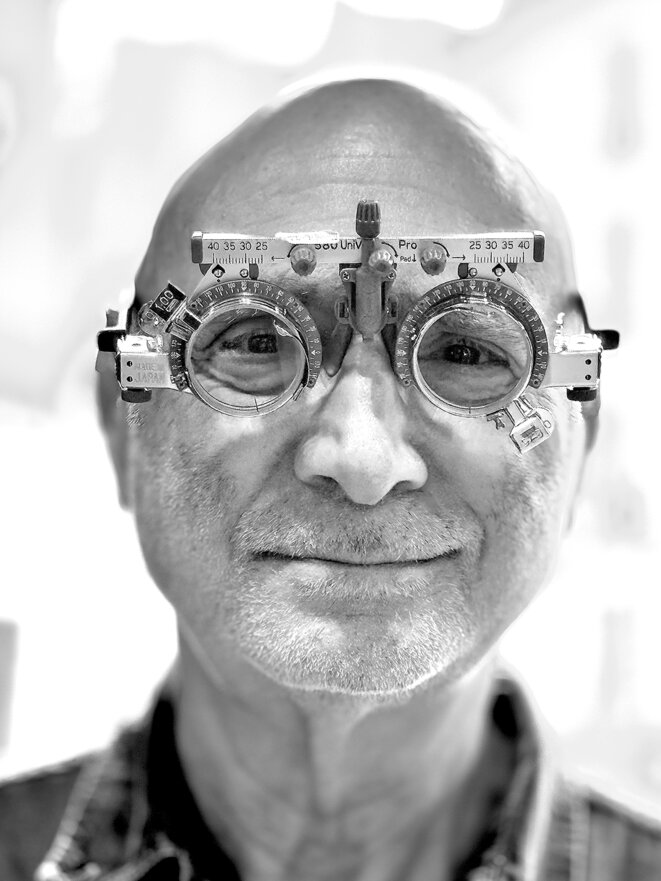L'entretien publié le 19 janvier 2026 par La Grande Conversation, mené par Jean-Louis Missika et Henri Verdier avec Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet à propos de leur livre Apocalypse nerds, documente avec précision les dérives autoritaires de certaines élites technologiques. Le diagnostic est sérieux, la documentation solide, l'alerte légitime. Mais cette analyse bute sur un angle mort récurrent dans la pensée progressiste française : l'évitement systématique de la question économique au profit de lectures culturelles et idéologiques.
1 | Un diagnostic nécessaire, une méthode familière
Il faut saluer le travail accompli. Hadjadji et Tesquet documentent avec précision les imaginaires politiques qui traversent une partie de la Silicon Valley: fascination pour l’effondrement, rejet des institutions démocratiques, projet de «souverainetés privées» gouvernées par le code plutôt que par le droit. Leur généalogie intellectuelle — de Joseph de Maistre à Curtis Yarvin, en passant par Carl Schmitt et les paléolibertariens — est convaincante.
Cette approche rappelle les meilleures traditions de l’histoire des idées à la française. On y reconnaît la méthode: cartographier les filiations intellectuelles, traquer les réseaux d’influence, dévoiler les continuités entre pensée réactionnaire européenne et techno-autoritarisme californien. C’est précieux. C’est même indispensable.
Mais c’est aussi là que le bât blesse. Car cette méthode a ses angles morts — et ils sont récurrents dans la critique progressiste française depuis au moins deux décennies.
2 | L’évitement de l’économie politique
L’entretien consacre des pages entières aux références philosophiques de Peter Thiel, à sa passion pour René Girard et Carl Schmitt, à sa fascination pour l’Apocalypse comme «révélation». On analyse son «imaginaire eschatologique», sa «vision palingénésique», sa recherche d’une «transcendance par la machine».
Tout cela est vrai. Mais tout cela évite soigneusement la question centrale: Qui capte la valeur produite par les révolutions technologiques contemporaines?
Les technologies numériques, l’automatisation et aujourd’hui l’intelligence artificielle ont généré des gains de productivité sans précédent historique. Or ces gains ne se sont traduits ni par une amélioration proportionnelle des conditions de travail, ni par une réduction massive du temps de travail, ni par une redistribution équitable des richesses. Ils ont au contraire alimenté une concentration extrême du capital au profit d’un nombre toujours plus restreint d’acteurs économiques².
Cette réalité n’est pas périphérique au phénomène analysé: elle en constitue le socle matériel. Sans analyse des rapports de production et d’appropriation, la critique du technofascisme reste suspendue dans l’air — comme si les dérives autoritaires relevaient uniquement d’erreurs idéologiques ou de pathologies morales, et non d’un système économique parfaitement rationnel dans sa logique d’accumulation.
Or, cette absence n’est pas fortuite. Elle reproduit un évitement qui structure depuis longtemps une partie de la pensée progressiste française: préférer l’analyse culturelle et idéologique à l’économie politique, au motif implicite que cette dernière serait «réductionniste» ou «archaïque».
3 | Terra Nova et la neutralisation de l’économie politique
Cet angle mort n’est pas propre à Hadjadji et Tesquet. Il caractérise plus largement la ligne éditoriale de Terra Nova, think tank qui publie l’entretien et dont l’un des animateurs, Jean-Louis Missika, mène précisément cet échange.
Depuis sa création en 2008, Terra Nova s’est construit sur une double opération: d’une part, la promotion d’une social-démocratie «modernisée», détachée de ses bases populaires au profit d’une coalition éduquée et urbaine³; d’autre part, la marginalisation des questions de redistribution économique au profit d’enjeux sociétaux et culturels. Cette orientation a produit des analyses stimulantes sur les mutations du travail, les questions de genre ou les enjeux migratoires.
Mais elle a systématiquement évacué toute remise en cause structurelle du capitalisme financiarisé.
L’entretien sur le techno-fascisme reproduit ce schéma. On y convoque à plusieurs reprises l’héritage des Lumières pour opposer Raison, État de droit et démocratie libérale aux tentations autoritaires contemporaines. L’intention est louable.
Mais l’invocation des Lumières finit par produire un effet paradoxal: celui d’un progressisme désincarné, privé de toute économie politique.
Les Lumières du XVIIIᵉ siècle ont pensé l’émancipation politique, la citoyenneté, la liberté individuelle. Elles n’ont évidemment pas pensé la financiarisation globale, l’automatisation massive ni l’extraction algorithmique de la valeur. Les convoquer aujourd’hui sans repenser la propriété, le travail et la redistribution revient à éclairer un capitalisme du XXIᵉ siècle avec des catégories qui n’ont pas été conçues pour lui.
4 | Une autre lecture existe — et elle n’est pas utopique
Pourtant, cette autre lecture existe. Elle n’est ni marginale, ni «datée», ni réservée à quelques nostalgiques de la lutte des classes. De nombreux économistes et chercheurs — Bernard Friot, Thomas Piketty, Gaël Giraud, pour ne citer qu’eux — ont montré que les révolutions technologiques contemporaines rendent objectivement possible une redistribution radicale des gains de productivité⁴.
Cette perspective ne consiste pas à «rejeter» la technologie ou à fantasmer un retour préindustriel. Elle consiste à poser une question simple: si les Machines, & les Révolutions Numériques produisent davantage avec moins de travail humain, à qui appartient cette richesse supplémentaire? Et selon quelles modalités politiques peut-on organiser son partage?
Réduction drastique du temps de travail, socialisation d’une partie de la valeur produite, sécurisation des parcours de vie, revenu garanti ou socialisé: ces propositions ne relèvent pas de l’utopie mais d’une économie politique réaliste, fondée sur l’observation des capacités productives actuelles. Dans cette perspective, la technologie n’est ni un danger à conjurer ni une promesse abstraite à célébrer, mais un champ de lutte. Elle peut servir l’accumulation sans limite comme elle peut permettre une réorganisation profonde des rapports sociaux. Tout dépend de la manière dont la valeur qu’elle produit est appropriée — ou partagée.
Ce déplacement du regard change tout. Le problème n’est plus seulement d’éviter un futur autoritaire, mais de décider collectivement ce que nous faisons des capacités productives inédites dont nous disposons déjà.
5 | Une question politiquement mûre — et systématiquement esquivée
Cette question n’est plus marginale dans le débat public. Elle l’a même déjà traversé, notamment lors de la campagne présidentielle de 2017, où la proposition d’un revenu universel portée par Benoît Hamon visait précisément à articuler progrès technologique et redistribution de la valeur⁵. On peut en discuter les modalités techniques, mais difficile d’y voir une «lubie hors-sol» quand des économistes aussi divers que Piketty, Tirole ou Cahuc s’en sont emparés — fût-ce pour la critiquer.
Or que constate-t-on? Que cette dimension économique est systématiquement marginalisée dans les analyses progressistes dominantes. Y compris — et c’est révélateur — dans un entretien de trois heures consacré au techno-fascisme, publié par un Think Tank qui se veut à la pointe de la réflexion sur les mutations contemporaines.
À l’heure où l’intelligence artificielle promet d’accroître encore les gains de productivité, continuer à penser la technologie sans penser le partage de la richesse revient à accepter implicitement que ces gains profitent, une fois de plus, à une minorité. C’est précisément ce qu’analyse Frédéric Lordon lorsqu’il décrit le capitalisme contemporain non comme un système «dévoyé» qu’il faudrait «moraliser», mais comme une structure d’appropriation qui fonctionne exactement comme elle est conçue pour fonctionner.
6 | Déplacer le débat — ou le laisser aux techno-fascistes
Vers la fin de l’entretien, Nastasia Hadjadji formule un diagnostic juste: «Le problème de la gauche, c’est qu’elle a épuisé son programme. L’utopie de la gauche au XIXᵉ siècle, c’était la construction de l’État-providence. Cette utopie a été réalisée et aujourd’hui, la gauche est exclusivement dans une posture de défense des acquis.»
C’est exact. Mais cela appelle une réponse: quelle est l’utopie progressiste pour le XXIᵉ siècle? Et pourquoi ce silence assourdissant dès qu’il s’agit de penser une réorganisation post-capitaliste de la production et de la redistribution?
La réponse est connue: parce que cette question est jugée «clivante», «archaïque», «hors du réel politique». Parce qu’elle impliquerait de rompre avec la social-démocratie néolibéralisée qui domine depuis trente ans. Parce qu’elle supposerait de nommer l’adversaire: non pas le «fascisme» comme pathologie morale, mais le capitalisme comme rapport social.
Or, en refusant ce déplacement, la critique progressiste abandonne le terrain de l’utopie technologique aux techno-fascistes eux-mêmes. Comme le note justement Olivier Tesquet dans l’entretien: «Ils ont des imaginaires prométhéens qui nous envoûtent collectivement.» Mais cet envoûtement tient moins à la force intrinsèque de leurs récits qu’à l’absence de récits alternatifs crédibles.
Conclusion: sortir de l’alternative stérile
L’avenir du techno-fascisme a le mérite de poser une alerte sérieuse et documentée. Mais à force de regarder les dérives possibles du capitalisme technologique, il évite d’interroger sa structure même. Or c’est précisément là que se joue l’enjeu central de notre époque: non seulement empêcher le pire, mais rendre possible le meilleur.
Penser une lecture sociale des révolutions technologiques n’est ni utopique ni archaïque. C’est, au contraire, la condition pour que le progrès cesse d’être un mot creux et redevienne une promesse collective — et pour que la critique du techno-fascisme cesse d’être un exercice intellectuel pour devenir un programme politique.
Notes
Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet, Apocalypse nerds, Comment les techno-fascistes ont pris le pouvoir, Éditions Divergences, Paris, 2025. Entretien: «L’avenir du technofascisme», La Grande Conversation (Terra Nova), 19 janvier 2026. URL: https://www.lagrandeconversation.com/monde/lavenir-du-technofascisme/
—
Thomas Piketty, Le Capital au XXIᵉ siècle, Seuil, Paris, 2013; Capital et idéologie, Seuil, Paris, 2019. Voir également: Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, Le triomphe de l’injustice. Richesse, évasion fiscale et démocratie, Seuil, Paris, 2020.
—
Cette orientation a été formalisée dans la note controversée: Olivier Ferrand, Romain Prudent et Bruno Jeanbart, «Gauche: quelle majorité électorale pour 2012?», Terra Nova, mai 2011. La note proposait explicitement d’abandonner les «classes populaires» au profit d’une coalition «diplômés-jeunes-minorités-femmes».
—
Bernard Friot, L’enjeu du salaire, La Dispute, Paris, 2012; Vaincre Macron, La Dispute, Paris, 2017.
—
Gaël Giraud, Composer un monde en commun. Une théologie politique de l’Anthropocène, Seuil, Paris, 2022. Voir aussi les travaux de l’Institut européen du salariat: https://www.reseau-salariat.info/
—
Programme présidentiel de Benoît Hamon, 2017, proposition n°11: «Instaurer un revenu universel d’existence financé notamment par la taxation des robots et de la valeur produite par nos données personnelles.» La proposition visait explicitement à redistribuer les gains de productivité liés à l’automatisation.
—
Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, Paris, 2010;
Vivre sans? Institutions, police, travail, argent..., La Fabrique, Paris, 2019. Lordon y développe l’idée que le capitalisme n’est pas un système «mal régulé» mais une structure d’appropriation cohérente qu’il faut remplacer, non «moraliser».