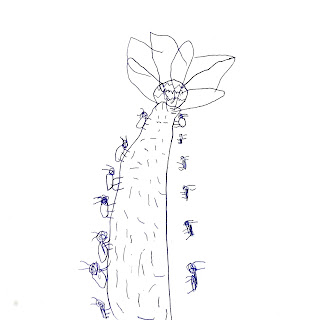Un jour, j'ai rencontré une éducatrice spécialisée bien plus âgée que moi, je lui ai naturellement posé la question de savoir pourquoi elle ne tentait pas le diplôme supérieur. Elle m'a répondu avec humour que ça ne l'intéressait pas du tout et qu'il y avait "trop de chefs, et pas assez d'indiens".
J'ai pris cette phrase comme une gifle en plein visage. Je n'ai pas compris et je me suis sentie personnellement attaquée. Je n’avais jamais entendu un tel discours. Pourtant 8 ans plus tard je m'en souviens encore, ainsi que la sensation qui m'a claquée avec. Elle avait touché une vérité violente.
Vis à vis de l'argent, et de la "réussite" depuis quelques années je suis tiraillée entre deux volontés contraires. Tout me parait plus clair après la lecture de "Refuser de parvenir".
Ce livre vient répondre très précisément aux questions que je me pose aussi bien dans ma pratique artistique, militante, et de travailleur social. C'est étonnat que ces 3 problématiques soient regroupées de la sorte, il semblerait pourtant qu'il y est une certaine logique.
J'ai longtemps été obsédée par la "réussite sociale", même quand il ne s'agissait plus alors d'argent ou d'un poste haut placé. Mais j'avais soif d'une certaine forme de reconnaissance et de je dois l'avouer, de notoriété. Il y a sans aucun doute de la vanité la dessous et une bonne part d'insécurité personnelle, qui croyez moi, est épuisante.
Dans cette recherche constante de reconnaissance, notamment de mon travail artistique, j'ai très vite été confronté à la question de sa "valeur". J'étais donc dans la logique suivante : "pour être reconnue il faut que mon travail ait de la valeur, si je ne suis pas reconnue, c'est que je n'ai pas de valeur" (oui on ne peut pas différencier l’œuvre de l'artiste de son vivant ;) souvent en tête que je n'avais aucune valeur ).
Donner un prix à mes productions ces dernières années a été un sujet épineux et insatisfaisant. Je naviguais entre deux pensées : "Il faut bien qu'on me donne les moyens de continuer à faire ce que je fais" / "Je fais ce que je fais pour le partager, et je ne veux pas qu'ils soient réservé seulement à ceux qui peuvent se le permettre".
On me répétait "ne te brade pas". J'appliquais donc des logiques marchandes (nombre d'heure passées/bénéfices) pour fixer les prix de mes productions mais ça me semblait toujours trop. Je n'étais à l'aise qu'avec le prix libre.
J'étais donc engluée dans des logiques capitalistes malgré moi, même si cela restait sans autres conséquences que d'anéantir mon moral et produire ce qu'on appelle de la "dissonance cognitive".
Cependant j'avais raison, il faut que je puisse continuer à faire ce que je fais. Et pour cela le mieux reste encore de trouver mon argent ailleurs et surtout ne pas avoir besoin de beaucoup d'argent (et je valide les pratiques : petit logement, petites dépenses économiques et écologiques, seconde main, anti-gaspi...Bref : autonomie !)
Mais ce que m'a apporté en plus le livre Refuser de Parvenir, c'est aussi, des mots sur ce que je ressens au niveau des acensions individuelles. Notamment quand on monte de projets collectifs. Signé les œuvres d'un nom commun me paraît salutaire pour ne pas tirer la couverture à soi, et je dis ça en en vivant actuellement l'expérience.
On retrouve le même phénomène dans le milieu associatif. Une fois qu'une association "parvient", qu'elle grandit/est reconnue d'utilité publique, le militantisme se fait aspirer par l'institution. Il se dénature en se soumettant aux subventions de l'état et aux logiques concurentielles.
Illustration de Judith, 4 ans.