Les anarchistes hexagonaux ont-ils encore le désir de penser (l’État) ?
Préambule à Séminaire Etape, Repenser l’État au XXIe siècle
Libertaires et pensées critiques (Lyon, Atelier de création libertaire, novembre 2023, pp. 5-12, http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Repenser-l-Etat-au-XXIe-siecle.html)
« Cherchons ensemble, si vous voulez, les lois de la société, le mode dont ces lois se réalisent, le progrès suivant lequel nous parvenons à les découvrir ; mais, pour Dieu ! après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne songeons point à notre tour, à endoctriner le peuple […] faisons-nous une bonne et loyale polémique ; donnons au monde l’exemple d’une tolérance savante et prévoyante, mais, parce que nous sommes à la tête d’un mouvement, ne nous faisons pas les chefs d’une nouvelle intolérance, ne nous posons pas en apôtres d’une nouvelle religion ; cette religion fût-elle la religion de la logique, la religion de la raison. Accueillons, encourageons toutes les protestations ; flétrissons toutes les exclusions, tous les mysticismes ; ne regardons jamais une question comme épuisée, et quand nous aurons usé jusqu’à notre dernier argument, recommençons s’il faut, avec l’éloquence et l’ironie. »
Pierre-Joseph Proudhon, Lettre à Karl Marx, 17 mai 1846
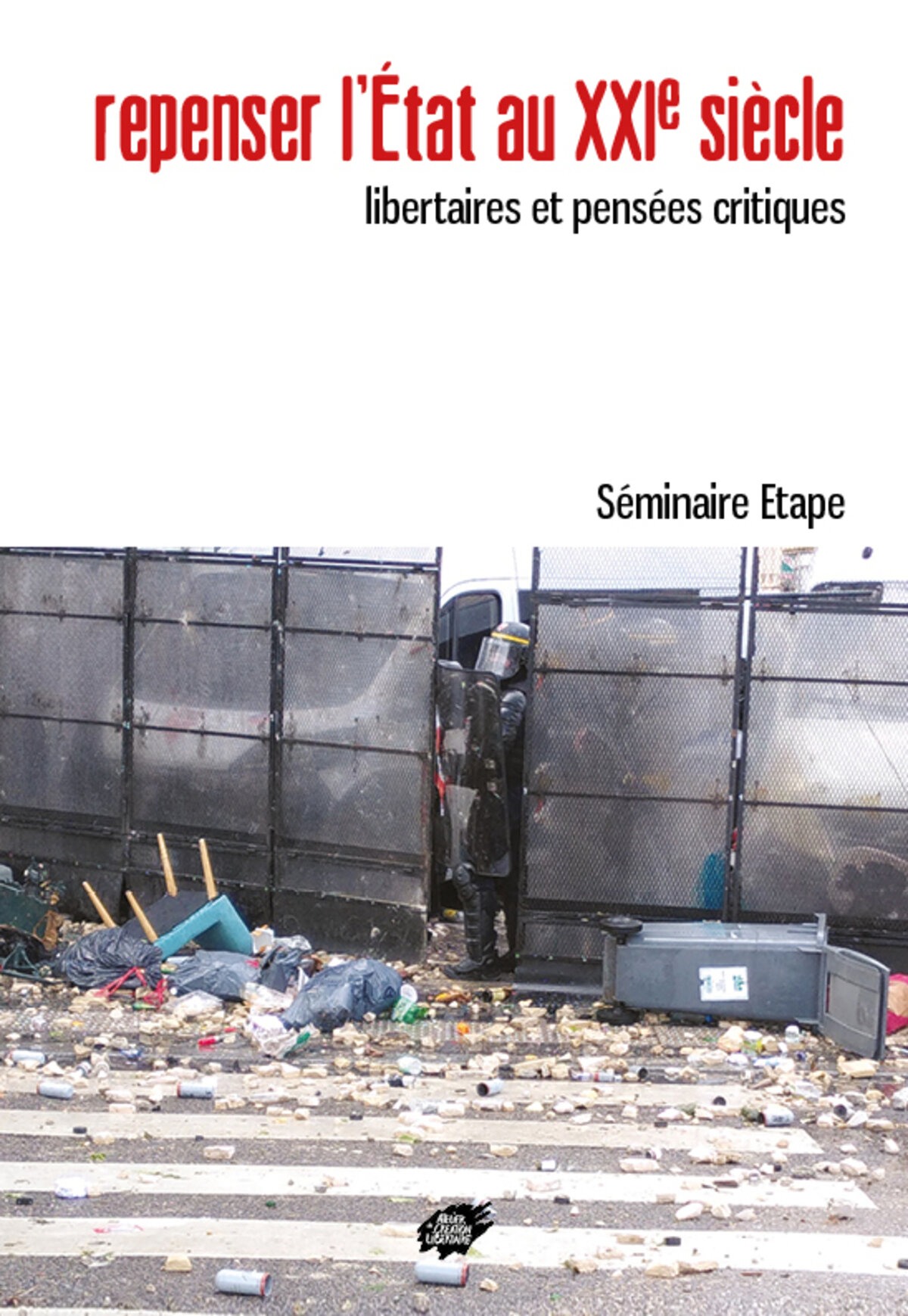
Agrandissement : Illustration 1
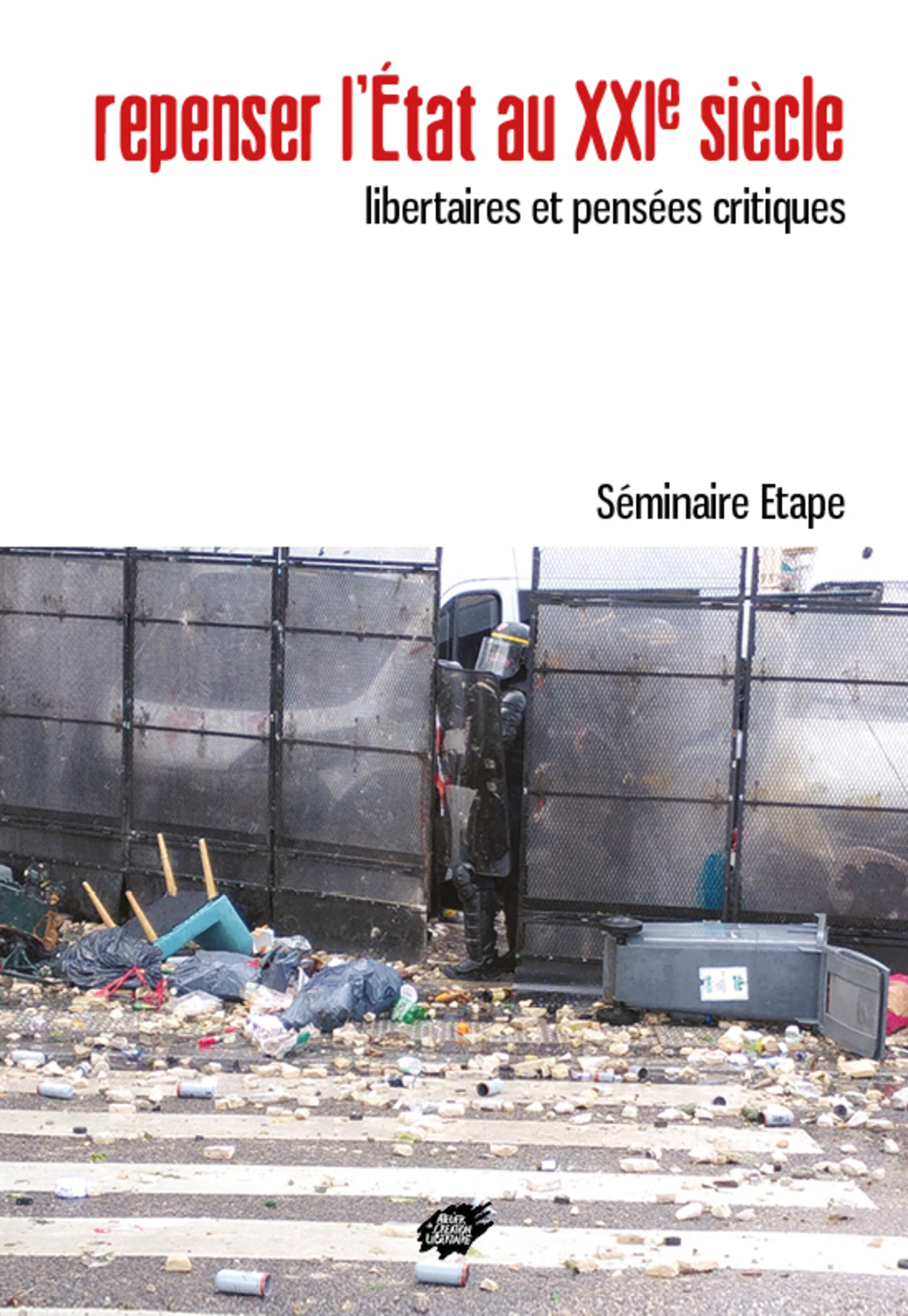
De la paresse intellectuelle en milieu anarchiste français organisé aujourd’hui
Après la chute du Mur de Berlin en 1989, beaucoup de pensées émancipatrices ont été affectées par une disqualification, y compris parmi ceux, socialistes démocrates, marxistes hérétiques ou libertaires, qui avaient radicalement critiqué et combattu le totalitarisme stalinien. Les marxistes ont, bien sûr, été les plus touchés. Cependant une partie significative des intellectuels marxistes a su ensuite rebondir, en s’efforçant de réactualiser de manière critique leurs repères théoriques. En France, beaucoup de choses se sont d’abord effectuées, à la croisée du travail intellectuel et du militantisme, autour du révolutionnaire et philosophe Daniel Bensaïd (1946-2010) et, sur le plan académique, autour de la revue Actuel Marx (créée par Jacques Bidet en 1986 et publiée aux Presses Universitaires de France).
Par contre, parmi les anarchistes, s’est souvent répandue une rumeur selon laquelle la chute du Mur de Berlin présageait la victoire des libertaires sur leurs vieux adversaires marxistes. Ce qui incitait à se reposer sur ses lauriers, puisque « les anars ont eu historiquement raison ! »… La réactualisation de la pensée anarchiste face aux limites des ressources conceptuelles d’hier et aux enjeux nouveaux en a souffert. Une certaine paresse intellectuelle s’est installée, surtout en France et encore plus parmi les anarchistes organisés, fréquemment partagés entre des activistes le nez dans le guidon et des nostalgiques d’un passé glorieux le nez tourné vers les Grands Ancêtres. Cette paresse a été renforcée par l’anti-intellectualisme toujours prompt à resurgir en milieu libertaire ; cet anti-intellectualisme ayant une face légitime - la critique du risque réel d’un magister des intellectuels sur le mouvement anarchiste - et une face illégitime - l’indifférence, voire l’hostilité, à l’égard du travail intellectuel au profit de la répétition de slogans.
Cela a touché avant tout la France. À rebours, le monde anarchiste anglo-américain, par exemple, a connu des renouvellements intellectuels. Ainsi un « post-anarchisme » (le philosophe Todd May, etc.) a émergé dans les années 1990 dans le dialogue avec les œuvres de penseurs « post-structuralistes » français comme Michel Foucault[1]. L’anarchisme anglo-américain a également bénéficié d’un dialogue stimulant avec les problématiques de l’intersectionnalité qui ont émergé en 1989 aux États-Unis dans les sciences sociales, comme le met en évidence dans la contribution à ce volume notre ami québécois Francis Dupuis-Déri. Et puis les travaux d’anthropologie anarchiste des chercheurs américains David Graeber et James C. Scott, auxquels ce volume accorde une grande place, ont contribué à une certaine effervescence intellectuelle libertaire. Enfin, le municipalisme et l’écologisme libertaires de l’Américain Murray Bookchin (1921-2006) ont connu, ces dernières années, un regain d'intérêt à travers le monde.
Certes, la France n’a pas constitué, après la chute du Mur de Berlin, un désert intellectuel anarchiste. L’Atelier de création libertaire (créé en 1979) continue d’alimenter l’édition anarchiste de manière originale. Et la publication en 2021 par l’ACL des Actes du colloque de Lille de mars 2018 sur Anarchisme et sciences sociales, sous la direction de Sidonie Verhaeghe, a marqué un frémissement quant aux rapports entre anarchisme et universités dans l’hexagone. La revue Réfractions constitue le lieu principal des débats intellectuels anarchistes francophones depuis 1997. Par ailleurs, des œuvres individuelles ont su ouvrir des questionnements renouvelés et diversifiés en langue française : Jean-Christophe Angaut, Pierre Bance, Daniel Colson, Philippe Corcuff, Ronald Creagh, Marianne Enckell, Bruno Frère, Vivien García, Laurent Gardin, Guillaume Goutte, Samuel Hayat, Tomás Ibáñez, Édouard Jourdain, Stéphane Lavignotte, Charles Macdonald, Gaetano Manfredonia, Frank Mintz, Émilie Notéris, Irène Pereira, Théo Roumier, Erwan Sommerer, Sidonie Verhaeghe… On doit aussi noter tout particulièrement la publication en 2022 du grand livre de Catherine Malabou, Au voleur ! Anarchisme et philosophie (PUF), qui confronte d’importantes figures de la philosophie du XXe siècle (Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Rancière…) à l’anarchisme. Pourtant, signe des temps, il a eu peu d’échos en milieu libertaire[2]…
Malheureusement, certains penseurs, intéressants au départ, se sont aussi égarés en chemin. Ainsi avec la création de la revue Front Populaire en 2020, Michel Onfray est passé d’une réflexion sur un anarchisme pragmatique comme aliment d’une gauche de gauche[3] à un positionnement idéologique à la gauche d’une extrême droite zemmourisée. Moins extrême, Renaud Garcia a toutefois succombé de manière confusionniste[4] au manichéisme anti-intersectionnel et anti-woke d’un certain air du temps réac[5].
Globalement le renouvellement intellectuel anarchiste ne se situe pas au même niveau en France que ce qui a été engagé dans la galaxie marxiste dans la même période. Et, surtout, elle a peu eu d’effets sur le large assoupissement intellectuel de l’anarchisme organisé hexagonal. C’est dans ce contexte d’une certaine atonie intellectuelle libertaire franco-française qu’est né en juin 2013 le séminaire de recherches militantes, libertaires et pragmatistes Etape (Explorations Théoriques Anarchistes Pragmatistes pour l’Emancipation), associé au site de réflexions libertaires Grand Angle (http://www.grand-angle-libertaire.net/), créé dans la foulée en septembre 2013. Outre les séances du séminaire (une séance mensuelle de janvier à juin chaque année à Paris depuis 2017) et les publications sur le site Grand Angle, nous avons publié un premier livre à l’Atelier de création libertaire en 2019 : Explorations libertaires. Pour une pensée critique et émancipatrice (avec les contributions de Jérôme Baschet, Patrick Cingolani, Philippe Corcuff, Stéphane Haber, John Holloway, Silien Larios, Sandra Laugier, Christian Laval, Lilian Mathieu, Ruwen Ogien, Irène Pereira, Ivan Sainsaulieu, Cyprien Tasset et Joëlle Zask, préfacé par Jérôme Alexandre).
Le présent ouvrage est consacré à la question de l’État. Le séminaire Etape a commencé à aborder le problème à travers deux séances en 2015 : l’une en juin avec le regretté Ruwen Ogien sur « Libéralisme, anarchisme et critique de l’État » (le texte tiré de cette séance a paru en 2019 dans Explorations libertaires) et l’autre en décembre avec Geoffroy de Lagasnerie autour d’« Interrogations sur l’État, Foucault et l’anarchisme » (le texte issu de cette séance est publié dans ce volume). Puis l’ensemble des séances de janvier-juin 2017 ont traité de l’État. Par la suite, cette préoccupation a continué a cheminé à côté d’autres.
Dans l’imaginaire anarchiste, l’État, comme la religion (le fameux « Ni Dieu ni maître », qui ne vient d’ailleurs pas d’un libertaire, mais du socialiste Auguste Blanqui) ou le vote (la promotion anarchiste de l’abstentionnisme), a souvent été constitué comme un repoussoir. C’est plutôt un certain manichéisme diabolisateur qui domine les expressions publiques libertaires sur la question. Cependant, comme pour la religion ou le vote, la galaxie anarchiste se révèle historiquement plus composite et nuancée dans ses analyses. C’est avec ce goût de la nuance que nous avons voulu renouer. En tentant de prendre nos distances avec la tendance à essentialiser l’État, en en faisant en quelque sorte une figure du Mal, des anarchismes normatifs (des anarchismes en tant que projets moraux et politiques), tout en faisant notre miel d’un anarchisme méthodologique (une posture d’analyse dé-fétichisant l’État)[6].
Présentation du livre : l’État sous différentes coutures
Notre ouvrage est constitué de cinq parties et de 26 chapitres.
La première partie se concentre sur les critiques de l’étatisme. Il commence avec la contribution du philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) à la pensée du Léviathan moderne, qui demeure encore souvent dominante dans les représentations politiciennes de la politique aujourd’hui. Rafael Perez rappelle qu’avec Hobbes apparaissent deux « mythes » de la Modernité occidentale : l’État et l’individu. Philippe Corcuff explore les effets de la problématisation hobbesienne sur la gauche radicale actuelle, de l’écho du dirigeant et intellectuel communiste italien Antonio Gramsci (1891-1937) aux penseurs post-marxistes se réclamant du « populisme » Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Manuel Cervera-Marzal suit, quant à lui, la piste fournie par Miguel Abensour (1939-2017) sur les anti-Léviathan : Emmanuel Levinas (1905-1995), Hannah Arendt (1906-1975) et Pierre Clastres (1934-1977). Le militant et sociologue anarchiste uruguayen Alfredo Errandonea (1935-2001) ouvre le chantier d’un renouvellement de l’analyse de l’État pour un anarchisme du XXIe siècle. Philippe Corcuff développe le point de vue d’un anarchisme méthodologique, en prenant appui sur des ressources intellectuelles puisées chez Ludwig Wittgenstein (1889-1951) et chez Michel Foucault (1926-1984), pour ensuite redécouvrir la pensée d’un marxiste hétérodoxe, Nicos Poulantzas (1936-1979).
La deuxième partie est consacrée aux apports de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu (1930-2002) quant à l’État. Geoffroy de Lagasnerie propose un double mouvement à partir de Foucault : une déconstruction de l’État, puis une certaine réhabilitation de l’État et du droit. Philippe Corcuff discute certaines propositions de ce second mouvement. Jean-Louis Fabiani, puis Franck Poupeau, qui ont tous les deux travaillé auprès de Pierre Bourdieu, reviennent successivement sur les complications du rapport du sociologue à l’État, entre attachement à l’État-providence et critique libertaire des institutions étatiques. Jean-Christophe Angaut s’intéresse à une des premières critiques de la forme parti, en tant qu’associée à l’État moderne, celle du sociologue allemand Robert Michels (1876-1936) et à ses prolongements chez Bourdieu et Foucault.
La troisième partie traite des rapports contemporains entre anthropologie et anarchisme à travers trois figures : les Américains James C. Scott (né en 1936) et David Graeber (1961-2020) et le Franco-Américain Charles Macdonald (né en 1944). Un texte de Scott et un texte de Graeber sont traduits, grâce à leur amicale autorisation (pour Graeber peu de temps avant son décès). Sylvaine Bulle s’arrête sur la théorie politique des sociétés non gouvernables du premier et Gildas Renou sur l’anthropologie de la valeur du second. Dans un texte inédit, Macdonald trace des repères anthropologiques quant aux relations entre État et anarchisme, tout en discutant la sociologie de l’État de Bourdieu.
La quatrième partie aborde quelques-unes des problématiques critiques contemporaines sur l’État. Irène Pereira s’intéresse au courant décolonial latino-américain. Francis Dupuis-Déri dessine un dialogue entre l’angle de l’intersectionnalité (et donc aussi des études de genre, les travaux intersectionnels étant nés du Black Feminism) et l’anarchisme. Albert Ogien défend le point de vue d’une démocratie radicale. Bruno Frère et Laurent Gardin interrogent la tradition anarchiste à partir des expériences de l’économie sociale et solidaire, en ébauchant la possibilité d’une forme État libertaire.
La cinquième et dernière partie ausculte différents terrains. Pierre Bance esquisse une pensée juridique pour des sociétés anarchistes sans États. Fabien Jobard examine les rapports entre police et État. Audrey Célestine compare les cas des États-Unis et de la France pour ce qui est des relations entre racisme et violences policières. Abdellali Hajjat avance l’hypothèse de la mise en place en France d’un État ségrégationniste (plutôt que d’un « racisme d’État ») à l’encontre des présumés « musulmans », en revenant sur l’« affaire du burkini » de l’été 2016. Irène Pereira propose une synthèse sur le rôle de l’école dans la (re)production des normes sociales dominantes (de classe et de genre dans une perspective intersectionnelle). Jérôme Alexandre, à partir d’une expérience de haut fonctionnaire au ministère de la culture, analyse la culture comme une « idéologie d’État », tout en donnant à l’inverse à l’art une portée subversive libertaire. Enfin, Nathan Delbrassine, en étudiant l’échec d’un projet nationaliste arabe de facture culturelle en 1919, entrevoit la possibilité d’un « État relativement émancipateur ».
Les domaines traités par notre ouvrage sont vastes mais n’ont rien d’exhaustif. Ce n’est qu’un premier défrichage bien partiel. Dans un souci d’ouverture et de dialogue, il ne propose pas que des contributions libertaires, mais donne aussi la parole à d’autres sensibilités critiques et émancipatrices. Et, au-delà de l’hybridation entre anarchistes et non-anarchistes, il est fondamentalement pluraliste. Et, par exemple, sur l’alternative sociétés anarchistes sans États ou sociétés à États émancipateurs, il livre des réponses diversifiées et même opposées.
Séminaire ETAPE
****************************************
Lyon, Éditions Atelier de création libertaire, http://www.atelierdecreationlibertaire.com/
Repenser l'État au XXIe siècle. Libertaires et pensées critiques
Séminaire Etape
ISBN 978-2-35104-186-4, 544 pages, prix de vente : 20 euros
Commande et informations sur : http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Repenser-l-Etat-au-XXIe-siecle.html
Ou dans toutes les bonnes librairies alternatives et libertaires
Table des matières
Préambule : Les anarchistes hexagonaux ont-ils encore le désir de penser (l’État) ?
I. Critiques de l’étatisme
À partir de Thomas Hobbes : individu et État
par Rafael Perez
La gauche radicale et le poison étatiste de « l’hégémonie », entre Hobbes et Gramsci. Le cas d’Ernesto Laclau et Chantal Mouffe
par Philippe Corcuff
Penser la politique avec Miguel Abensour en s’affranchissant du Léviathan. Emmanuel Levinas, Pierre Clastres et Hannah Arendt
par Manuel Cervera-Marzal
L’État, la participation populaire et les défis de l’anarchisme du XXIe siècle
par Alfredo Errandonea
De l’anarchisme méthodologique au marxisme de Nicos Poulantzas : réinterroger « l’État » pour mieux le penser
par Philippe Corcuff
II. Michel Foucault (1926-1984), Pierre Bourdieu (1930-2002) et l’État
Du droit à l’émancipation. Sur l’État, Michel Foucault et l’anarchisme
par Geoffroy de Lagasnerie
Pragmatiser l’horizon libertaire et désétatiser la gauche Quelques remarques critiques sur un texte de Geoffroy de Lagasnerie
par Philippe Corcuff
Pierre Bourdieu, l’État, l’anarchie
par Jean-Louis Fabiani
Lire Sur l’État de Pierre Bourdieu : aperçus libertaires et dualité de l’État
par Franck Poupeau
Robert Michels et la critique sociologique des partis politiques (jusqu’à Michel Foucault et Pierre Bourdieu). Démocratie et étatisme
par Jean-Christophe Angaut
III. Anthropologie et anarchisme : James C. Scott (1936-), David Graeber (1961-2020), Charles Macdonald (1944-)
Ne plus voir le monde et son histoire à la manière d’un État
par James C. Scott
James C. Scott et la théorie politique des sociétés non gouvernées
par Sylvaine Bulle
Critique de la bureaucratie comme zone morte de l’imagination
par David Graeber
La violence de l’équivalence Sur l’anthropologie de valeur de David Graeber
par Gildas Renou
Quelques réflexions anthropologiques sur l’État et l’anarchisme. Avec un post-scriptum sur la théorie de l’État de Pierre Bourdieu
par Charles Macdonald
IV. Théories critiques contemporaines
À la recherche de l’État dans l’option décoloniale
par Irène Pereira
Que faire de l’État dans la théorie de l’intersectionnalité ? Une réflexion anarchiste
par Francis Dupuis-Déri
Du peuple, par le peuple, pour le peuple… La condition de la radicalisation de la démocratie
par Albert Ogien
Que faire de la forme État ? Des potentialités de l’économie solidaire et des questions qu’elle adresse à la tradition libertaire
par Bruno Frère et Laurent Gardin
V. Terrains, entre étatisme et émancipation
La question du droit en anarchie
par Pierre Bance
Police et État : quel rapport ?
par Fabien Jobard
Racisme et violences policières. Vers une comparaison États-Unis/France
par Audrey Célestine
L’« affaire du burkini » de l’été 2016 : racisme d’État ou État ségrégationniste ?
par Abdellali Hajjat
Le rôle de la certification scolaire d’État dans la (re)production des normes sociales de domination
par Irène Pereira
La culture : une idéologie d’État
par Jérôme Alexandre
La culture comme vecteur de construction et de différenciation de l’État : vers un État de l’émancipation ?
par Nathan Delbrassine
Les auteurs
Annexe
Offre spéciale
Le premier volume du séminaire Etape est paru en 2019 sous le titre Explorations libertaires. Pour une pensée critique et émancipatrice (avec les contributions de Jérôme Alexandre, Jérôme Baschet, Patrick Cingolani, Philippe Corcuff, Stéphane Haber, John Holloway, Silien Larios, Sandra Laugier, Christian Laval, Lilian Mathieu, Ruwen Ogien, Irène Pereira, Ivan Sainsaulieu, Cyprien Tasset et Joëlle Zask).
L'Atelier de création libertaire propose une offre spéciale à l'occasion de la sortie de Repenser l'Etat au XXIe siècle : les deux volumes du séminaire Etape pour 25 euros au lieu de 34 euros. L'offre spéciale est disponible ici : http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Repenser-l-Etat-au-XXIe-siecle,1041.html .
Notes :
[1] Voir un choix des textes parmi les plus importants de ce courant dans Duane Rousselle and Süreyyya Evren (eds.), Post-Anarchisme. A Reader, London, Pluto Press and Black Point, Fernwood Publishing, 2011.
[2] Excepté dans le cadre du séminaire Etape… voir « Échanges libertaires autour d’Au voleur ! » [un dossier composé de textes de Jérôme Alexandre, Lucie Doublet, Georges Serein et Catherine Malabou], site de réflexions libertaires Grand Angle, 22 mai 2023, http://www.grand-angle-libertaire.net/echanges-libertaires-autour-dau-voleur-de-catherine-malabou/.
[3] Voir, par exemple, Michel Onfray, Le postanarchisme expliqué à ma grand-mère. Le principe de Gulliver, Paris, Galilée, 2012.
[4] Sur le confusionnisme comme hybridation entre des postures et des thèmes d’extrême droite, de droite et de gauche dans un contexte de crise du clivage gauche/droite, en favorisant alors de manière non intentionnelle l’extrême droitisation idéologique, voir Philippe Corcuff, La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2021.
[5] Dans Renaud Garcia, Le désert de la critique. Déconstruction et politique, Paris, L’échappée, 2015 ; réédition en poche en 2021 ; la préface à cette seconde édition, intitulée « De l’esprit de parti », marque un tournant encore plus nettement manichéen.
[6] La distinction entre anarchisme normatif et anarchisme méthodologique est dérivée de la distinction opérée par le sociologue allemand Ulrich Beck entre nationalisme normatif et cosmopolitisme normatif, d’une part, et nationalisme méthodologique et cosmopolitisme méthodologique, d’autre part ; voir le texte de Philippe Corcuff infra, « De l’anarchisme méthodologique au marxisme de Nicos Poulantzas : réinterroger "l’État" pour mieux le penser ».



