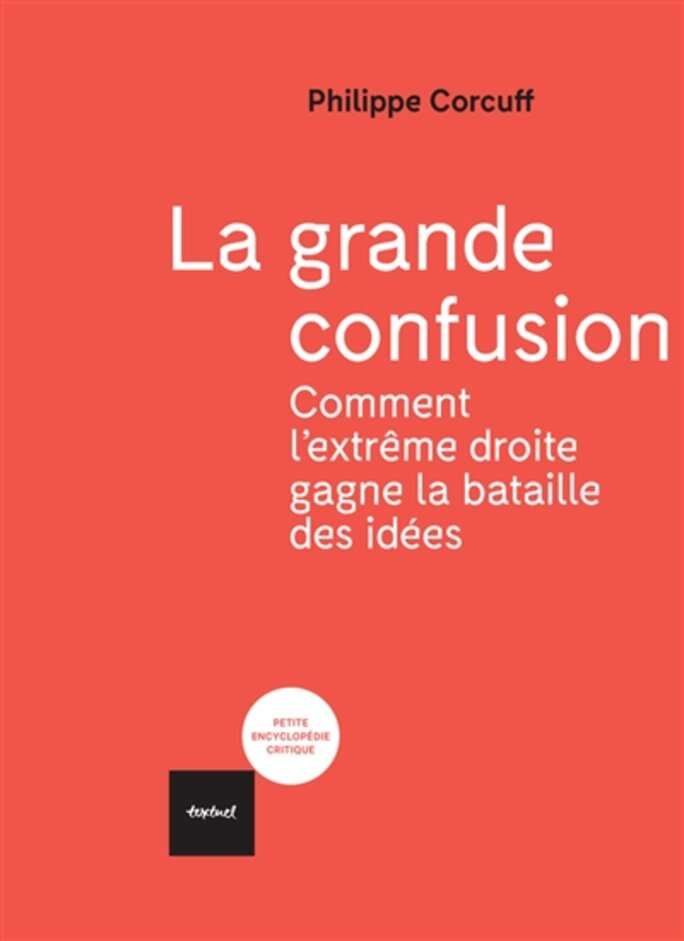Je me suis rendu à une séance de cet énième opus cinématographique consacré au super-héros créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger en trainant les pieds. La série des trois films mis en scène par Christopher Nolan (Batman Begins, 2005, The Dark Knight, 2008, et The Dark Knight Rises, 2012) m’avait intéressé par son côté sombre, même si le troisième volet révélait des aspects conservateurs. J’avais oublié que le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, avait co-écrit le scénario de l’excellent The Yards de James Gray (2000)…
Une adversité poisseuse
Dès le début du film, on est plongé dans l’esthétique glauque d’un monde ravagé par la corruption, le crime, l’illusionnisme de la politique électorale et surtout le brouillard moral. Le directeur de la photographie, Greig Fraser, qui a aussi officié sur Zero Dark Thirty (2012), Rogue One: A Star Wars Story (2016) et Dune (2021), nous fait ressentir le caractère poisseux du contexte dans lequel se déroule l’histoire. La pluie omniprésente trouble la perception, des acteurs comme des spectateurs. Dans un entretien, Matt Reeves livre des précisions techniques quant à la teneur spirituelle du film en parlant du « choix d’une faible profondeur de champ, où le flou nous indique qu’on ne peut pas tout voir »(1). Et d’ajouter :
« Je ne voulais pas que le film soit trop lisse, trop propre : Gotham se devait d’être décrite avec un certain degré de saleté viscérale. »(1)
Dans ce cadre, le super-héros (Robert Pattinson) est fragilisé, plus humain, moins gonflé par des dispositifs technologiques. Un homme solitaire, davantage dépouillé, lui-même affecté intérieurement par la gluance de l’époque, car agité par ses propres démons. Un Bruce Wayne au « teint pâle et maladif », souligne Reeves(1). D’ailleurs, au départ, Batman confond la justice avec la vengeance. Il y a du Taxi Driver de Martin Scorsese (1976) et du Seven de David Fincher (1995) dans ce Batman.
La corruption généralisée traversant pouvoir économique, pouvoir politique, justice et police est dans le collimateur. Un monde oligarchique, avec de vrais méchants et une hiérarchie non officielle dans les pouvoirs et dans le mal. Mais une trame de relations dévoyées constitue l’arrière-plan sordide et collant, comme la pluie et l’obscurité reliant et séparant les êtres, de l’action. Une trame qui déborde les protagonistes, grands ou petits, souvent pitoyables, de cette déliquescence, recouverte par les apparences de la respectabilité. Des adversaires, certes, de la justice, qui parfois prétendent l’incarner, mais sur fond de ce que le philosophe Maurice Merleau-Ponty appelle l’adversité (2). Davantage, plus profondément, que des adversaires dirait Merleau-Ponty :
« Quand nos initiatives s’enlisent dans la pâte du corps, dans celle du langage, ou dans celle de ce monde démesuré qui nous est donné à finir, ce n’est pas qu’un malin génie nous oppose ses volontés : il ne s’agit que d’une sorte d’inertie, d’une résistance passive, d’une défaillance du sens – d’une adversité anonyme. »(3)
Et Batman tend à s’enliser « dans la pâte du corps » et « dans celle de ce monde démesuré ». Ce que Merleau-Ponty décrit ailleurs comme « ce tissu que nous avons filé entre nous, et qui nous étouffe »(4). Les spectateurs devant l’écran comme Batman sur l’écran apparaissent étouffés par ce qu’ils voient autour d’eux et par ce qu’ils éprouvent à l’intérieur d’eux-mêmes. Contrairement aux délires de Julien Coupat et de ses amis dans leur Manifeste conspirationniste, le capitalisme comme, plus largement, le « tissu » des intersections des différentes formes d’oppression, à l’extérieur de nous et en nous, n’est pas fondamentalement l’œuvre d’un complot, même s’il est agité épisodiquement et superficiellement par des manipulations diverses, plus ou moins cachées(5).
Hypercriticisme du ressentiment

Agrandissement : Illustration 2

Face à ce monde gangréné, une alternative de justice semble se présenter, mêlant crimes de personnalités et révélations tonitruantes sur leurs turpitudes. L’esprit dérangé constituant l’âme apocalyptique de cette prétendue alternative s’efforce d’établir des passerelles avec le désir de justice-vengeance du super-héros. Ainsi un des messages laissé par le tueur pour Batman proclame « a real change »… Car l’hypercriticisme des inégalités et des malversations générées par l’ordre social dominant formulé par cette âme emplie d’aigreurs ressemble à la critique émancipatrice des injustices de notre monde. Ressemble seulement, dans un brouillard confusionniste qui ne dérègle pas seulement l’univers imaginaire de Gotham City mais aussi notre présent bien réel(6).
Cependant cet hypercriticisme n’est pas porteur de justice sociale et d’émancipation mais risque de déboucher sur une violence « postfasciste », si on entend par là les transformations actuelles de l’extrême droite par rapport aux fascismes historiques, dans des modalités diversifiées allant de Donald Trump à Vladimir Poutine, en passant par Éric Zemmour. L’âme damnée de The Batman a en commun avec Trump, Poutine ou Zemmour de porter une politique du ressentiment. Le ressentiment est entendu comme un phénomène socio-psychologique « que seule une vengeance imaginaire peut indemniser », selon les mots de Friedrich Nietzsche(7). Le philosophe et sociologue allemand Max Scheler a justement noté qu’une critique adossée au ressentiment « ne critique pas pour détruire le mal, mais se sert du mal comme de prétextes à invectives »(8).
Perfectionnisme éthique et démocratique
Batman ne va cependant pas succomber aux leurres confusionnistes facilitant les politiques « postfascistes » du ressentiment. Le perfectionnisme éthique et démocratique inscrit dans la tradition politique américaine est passé par là. Le perfectionnisme constitue un ensemble d’aspirations morales aux échos politiques analysé en particulier par le philosophe américain Stanley Cavell (1926-2018) en partant des penseurs classiques de la démocratie américaine que furent Ralph Waldo Emerson (1803-1882) et Henry David Thoreau (1817-1862), et qui a particulièrement marqué le cinéma(9) et aujourd’hui les séries télévisées(10). Dans cette perspective, l’effort de perfectionnement de soi (perfectionnisme éthique) va avoir des conséquences possibles sur l’amélioration du fonctionnement des collectivités à idéaux démocratiques (perfectionnisme démocratique). D’autant plus que, dans le cadre démocratique de « l’égalité de n’importe qui avec n’importe qui », selon l’expression de Jacques Rancière(11), l’avenir démocratique face aux déformations oligarchiques appartient avant tout aux individus ordinaires, à leurs initiatives personnelles comme à leurs actions coopératives.
Dans le doute et des hésitations, à travers des incompréhensions et des erreurs, bref avec le matériau des fragilités proprement humaines, le super-héros va suivre le trajet perfectionniste de l’individu démocratique. Il est cependant doté d’une aura de héros propre à stimuler les imaginaires émancipateurs des spectateurs dans quelque chose comme une auto-éducation démocratique cinématographiquement assistée. Batman, dans un parcours initiatique semé d’embûches, comprendra peu à peu le fossé abyssal séparant vengeance et justice, politique du ressentiment et politique de l’émancipation, malgré leurs ressemblances confusionnistes. Pendant ce double cheminement dans son monde intérieur et dans le monde extérieur, Batman rencontrera l’aide du lieutenant de police intègre Jim Gordon (Jeffrey Wright) et de l’illégaliste Catwoman (Zoë Kravitz), nettement plus sensible au juste qu’au légal. Le perfectionnement de soi a des composantes intersubjectives. Il est aussi relationnel.
Illusions trop réformistes ?
Le film de Matt Reeves semble encore croire à l’autocorrection des régimes politiques représentatifs à idéaux démocratiques qui sont les nôtres, malgré leurs tendances structurellement oligarchiques(12). Une jeune femme noire activiste deviendra maire, remplaçant les corrompus. The Batman serait-il trop marqué par des illusions réformistes, croyant exagérément dans les possibilités des institutions existantes de se réformer par leurs propres moyens ? Peut-être. En tout cas, il lui manque une radicalité sociale qui a été celle de la série TV The Wire (Sur écoute, David Simon, HBO, 5 saisons, 2002-2008), en affinité avec la sociologie critique(13). Toutefois des appuis moins optimistes demeurent dans le film. Batman lui-même, mélancolique, garde des doutes, et voit plutôt ces changements comme un pari et un horizon. Catwoman, sceptique par contre, quitte Gotham préférant de manière plus réaliste, mais aussi plus individualiste, les marges illégalistes.
Quoi qu’il en soit, ce Batman se dessine comme un outil de résistance émancipatrice face aux dérèglements confusionnistes et « postfascistes » de notre monde, dans la grande tradition d’un cinéma populaire, à l’écart de l’esprit chagrin d’une certaine cinéphilie critique.
Notes :
(1) Matt Reeves, « La corruption est un sujet fertile, elle ne s’arrête jamais », entretien avec Mathieu Macheret, site du Monde, https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/03/02/matt-reeves-cineaste-la-corruption-est-un-sujet-fertile-elle-ne-s-arrete-jamais_6115846_3246.html [accès abonnés].
(2) Sur la notion d’adversité, voir Maurice Merleau-Ponty, « L’homme et l’adversité » [conférence du 10 septembre 1951 aux Rencontres Internationales de Genève], repris dans Signes (1e éd. : 1960), Paris, Gallimard, 1987, pp. 284-308 ; « L’homme et l’adversité » [débats des 10, 12 et 14 septembre 1951 aux Rencontres Internationales de Genève], repris dans Parcours deux, 1951-1961, Lagrasse, Verdier, 2000, pp. 321-376 ; et « L’homme et l’adversité » [entretiens radiophoniques animés par Jean Amrouche, diffusés les 15 et 22 septembre 1951], repris dans Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959, Lagrasse, Verdier, 2016, pp. 62-71.
(3) M. Merleau-Ponty, « L’homme et l’adversité », dans Signes, op. cit., p. 304.
(4) M. Merleau-Ponty, Préface à Signes, op. cit., p. 47.
(5) Voir Philippe Corcuff, « "Manifeste conspirationniste" : une ultragauche au Seuil de l’extrême droitisation », site Conspiracy Watch, 26 février 2022.
(6) Voir Philippe Corcuff, La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », mars 2021.
(7) Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale [1e éd. : 1887], Paris, Gallimard, collection « Folio Essais », 1985, p. 35.
(8) Max Scheler, L’homme du ressentiment [1e éd. : 1919], Paris, Gallimard, 1958, p. 23.
(9) Voir, entre autres, Philippe Corcuff et Sandra Laugier, « Perfectionnisme démocratique et cinéma : pistes exploratoires », revue Raisons Politiques, n° 38, mai 2010.
(10) Voir, par exemple, P. Corcuff et S. Laugier, « Introduction : Pour un programme d’inspiration cavellienne d’analyse des séries TV », introduction au n° 19 de la revue en ligne TV/Series sur « Perfectionnisme et séries télévisées. Hommage à Stanley Cavell (1926-2018) », mai 2021.
(11) Dans Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et Philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 95.
(12) Voir P. Corcuff, "Nos prétendues «démocraties» en questions (libertaires). Entre philosophie politique émancipatrice et sociologie critique", site de réflexions libertaires Grand Angle, 5 mai 2014.
(13) Voir P. Corcuff, « Politique de The Wire : grandeurs individuelles, déboires collectifs et nouveau réformisme révolutionnaire », dans S. Laugier (éd.), Politique des séries télévisées. Voir, penser, changer la société, Paris, CNRS Éditions, à paraître en 2022.
***********************************
A noter prochainement :
Penser l’extrême droitisation en cours : pour une théorie politique critique
Conférence-débat
Mardi 15 mars 2022, 12h-15h
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Maison de la Recherche - Amphi MR002
2 rue de la Liberté - Saint-Denis