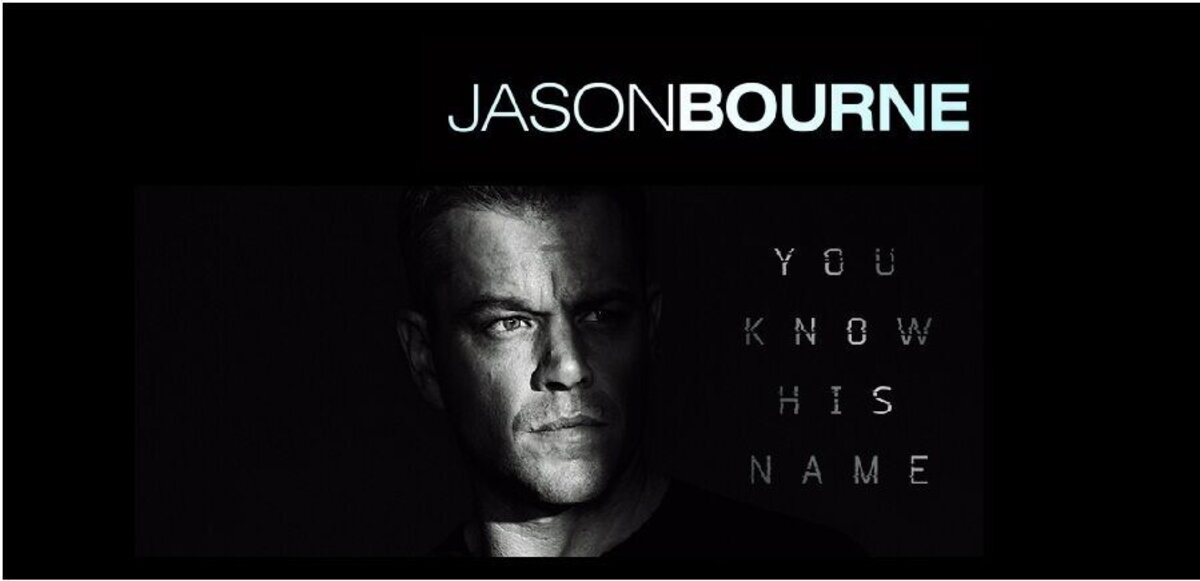
Agrandissement : Illustration 1
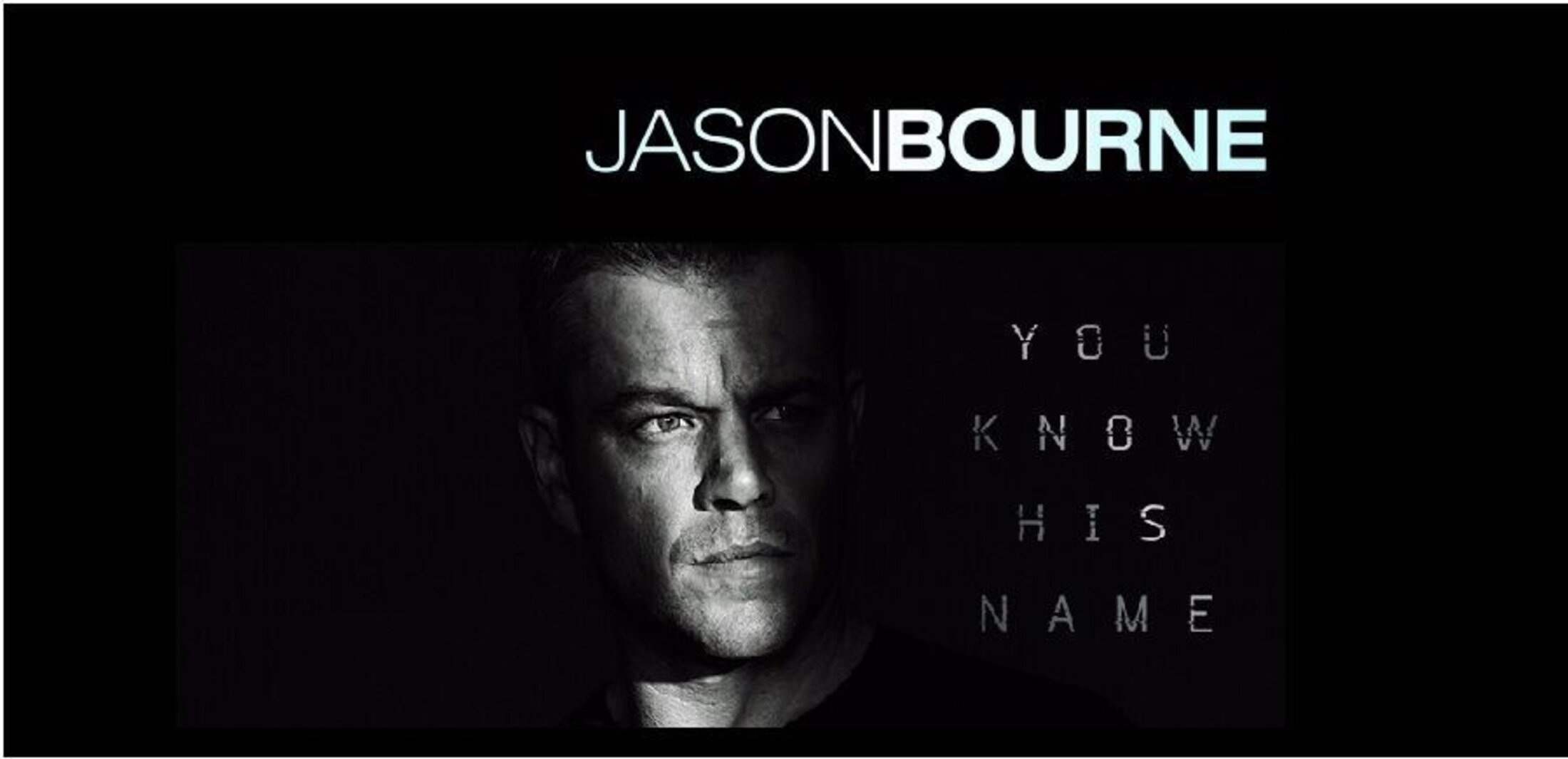
Á Gaspard, seulement 24 jours dans un monde inquiétant et pourtant troué de promesses
Après La mémoire dans la peau (The Bourne Identity) de Doug Liman (2002), La mort dans la peau (The Bourne Supremacy, 2004) et La vengeance dans la peau (The Bourne Ultimatum, 2007), tous deux de Paul Greengrass, Matt Damon rempile dans le rôle de Jason Bourne, ex-agent de la CIA recherché par son ancienne agence, dans Jason Bourne tout simplement, toujours sous la direction de Greengrass. Souffrant d’amnésie, celui qui fut un tueur super-entraîné s’efforce une nouvelle fois de recoller des morceaux éparpillés de son existence. Il le fait avec la mélancolie de celui qui s’est découvert criminel, dédié aux basses œuvres de l’impérialisme américain et que cela dégoûte rétrospectivement. La fibre pourtant encore patriotique, il tente de comprendre comment il a pu devenir une machine à assassiner au service d’intérêts obscurs.
L’Anglais Paul Greengrass est donc encore aux commandes avec une virtuosité étonnante dans la réalisation des scènes d’action. On se souvient de deux de ses films magistraux sur ce plan : Bloody Sunday (2002), à propos de la fusillade sanglante opérée par l’armée britannique en Irlande du Nord au cours d’une manifestation pacifique le dimanche 30 janvier 1972, et Vol 93 (United 93, 2006), quant à l’avion qui n’a pas atteint sa cible le 11 septembre 2001.
Grains de sable mélancoliques
Plus que dans les trois précédents, Jason Bourne apparaît ici plombé par ce qu’il a fait, vivant en marge et se perdant dans des combats de boxe clandestins. Se racheter est impossible, mieux comprendre peut-être…Car il a encore à savoir et à agir sur les dérèglements internes de la CIA, ses opacités, ses projets mégalos de surveillance généralisée du monde à l’heure d’internet et des réseaux sociaux (portés par le directeur de la CIA joué par Tommy Lee Jones). Davantage marqué par la culpabilité et lucide quant à l’impossibilité de la rédemption, il peut quand même empêcher que le monde ne s’enfonce un peu plus dans le pire. Jason Bourne est un grain de sable dans la machinerie politico-sécuritaire américaine généré par elle. Quand il y a du pouvoir, a souvent rappelé le philosophe Michel Foucault, il y a de la résistance, des résistances. Les univers de la domination ne sont pas homogènes. Ils sont plus composites que ne le croient les critiques qui surévaluent leur compacité et leur prégnance et qui, par là, contribuent à les fataliser un peu plus. Marx déjà pensait le capitalisme à travers des contradictions qui ouvraient des possibilités d’émancipation.
Cependant des contradictions et des grains de sable, ce n’est pas encore l’émancipation. Des points d’appui seulement rouvrant son horizon. Dans ce cadre encore limité, il y a les antihéros solitaires (comme Jason Bourne), figure si prisée par le roman noir et Hollywood, mais aussi des conflits d’intérêts individuels et de carrières qui traversent une institution bureaucratique comme la CIA, particulièrement éclairés dans cet épisode de la série. Les manipulateurs à l’ancienne ne sont d’ailleurs pas moins inquiétants que les jeunes loups aux compétences numériques. Mais leurs conflits ouvrent des espaces à l’action hérétique. Ne sous-estimons pas les divisions de l’adversaire et ne le rendons pas plus fort qu’il n’est !
Jason Bourne et Louise Michel ?
L’action collective, plus directement politique, est également présente, mais à la périphérie. Dans La mort dans la peau, une scène d’action était emmêlée dans une manifestation altermondialiste menée par ATTAC Allemagne sur Alexanderplatz à Berlin. Plus spectaculaire encore, dans Jason Bourne, une course-poursuite se mène à Athènes au moment d’une émeute radicale et anarchiste dans une Grèce écrasée par le néolibéralisme des institutions européennes. Dans le langage cinématographique même de Greengrass, les altermondialistes allemands comme les émeutiers grecs participent à faire dévier les logiques du Léviathan étasunien. Greengrass subvertit ainsi, sans avoir l’air d’y toucher car nous plongeant dans le rythme effréné du thriller, de manière moins frontale que dans Bloody Sunday, l’exclusivité individualiste de la représentation hollywoodienne de la résistance à l’oppression, tout en maintenant la place donnée à la force des fragilités intimes face aux machines de pouvoir. Au passage, il pointe l’hypocrisie des géants actuels des réseaux sociaux, entre proclamations « libertaires » et collaboration pratique à la surveillance globalisée.
Certes, l’émancipation n’est pas encore au rendez-vous, mais le sens éthique de la préservation de son intégrité personnelle par rapport à certaines valeurs comme les mobilisations collectives perturbent sérieusement la mécanique du système. Jason Bourne est là où nous en sommes, pas plus loin : il a notre mélancolie, née des désenchantements (dont les désenchantements vis-à-vis de nous-mêmes, individuellement et collectivement) et des défaites passés, et pourtant il refuse la fatalité de l’inéluctable. Pourquoi lui en demanderait-on plus que ce réalisme critique, en créant de mythologiques « lendemains qui chantent » ne tenant pas compte des déboires d’hier ? Il nous revient de montrer en pratique que nous pouvons faire quelques pas supplémentaires vers une utopie pragmatique et devenir des hybridations de Jason Bourne et de Louise Michel ajustées aux débuts du XXIe siècle…



