1 - État d’urgence et délitement à gauche
Paru dans le quotidien L’Humanité, lundi 22 février 2016, avec également les contributions de Philippe Marlière (« Une décision politique et une faillite démocratique ») et de Roger Martelli (« Urgence du commun, pas de la guerre »), http://www.humanite.fr/faut-il-redouter-la-prolongation-en-cours-de-letat-durgence-599845
En 2015, les attentats de Charlie hebdo et de l’Hyper Cacher, puis ceux du 13 novembre ont légitimement bouleversé le sentiment d’humanité de ceux qui sont attachés à une éthique d’émancipation. Les fondamentalismes islamistes sont des ennemis de l’émancipation sociale. Ceux qui à gauche ne l’ont pas compris, en relativisant ces crimes au nom de considérations géostratégiques dérisoires ou de comparaisons macabres, ont contribué au délabrement confusionniste des gauches.
Ceux qui, après avoir enlisé la gauche de gouvernement dans un social-libéralisme patronal, ont aussi mis un doigt dans le recul des libertés publiques et dans l’islamophobie d’État, avec la constitutionnalisation de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité, ont, quant à eux, cancérigèniser durablement la notion même de gauche. Il est presque fini le temps des années 1980 où les noces du mitterrandisme et du marché, avec leurs dégâts sociaux, se légitimaient par quelques concessions dites « libérales-libertaires » aux luttes émancipatrices post-1968. Le social-libéralisme se fait de plus en plus sécuritaire et autoritaire dans une forme de retour à un certain « ordre moral ». Le premier ministre Manuel Valls ne cache ainsi pas ses sympathies pour les nouvelles humeurs idéologiques « néo-réacs ».
C’est dans ce cadre déboussolant pour les valeurs progressistes qu’intervient la deuxième reconduction de l’état d’urgence. Son efficacité pour combattre le djihadisme reste pourtant à démontrer. Vraisemblablement parce que sa logique principale ne se situe pas là. Il s’agit plutôt de stimuler les peurs et les demandes de protection au profit de la sacralisation des institutions étatiques et, à leur sommet, de l’« homme d’État providentiel », qui espère sauver sa petite peau politicienne pour la prochaine échéance présidentielle. Peu importe si les vannes de l’arbitraire sont ainsi ouvertes en fragilisant les quelques acquis démocratiques de nos régimes représentatifs professionnalisés.
C’est là que l’on a besoin de redécouvrir la part libérale, au sens politique, de l’histoire du mouvement ouvrier contre des penseurs critiques comme Jean-Claude Michéa ou Frédéric Lordon, qui tendent fallacieusement à amalgamer libéralisme politique (limitation réciproque des pouvoirs et développement de droits individuels et collectifs) et libéralisme économique (idéologie du marché-roi). Il y a une actualité de Montesquieu dans De l’esprit des lois (1748) : « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Un des premiers textes politiques de Marx, en mai 1842, ne consistait-il pas en une défense de la liberté de la presse contre la censure ? On pourrait dire des choses semblables quant à la présence d’un héritage critique du libéralisme politique chez Proudhon ou Bakounine.
Face aux périls réels incarnés par le djihadisme, la prolongation de l’état d’urgence paralyse les indispensables résistances citoyennes. Nombre de réactions spontanées en janvier et en novembre 2015 avaient largement mis en avant le respect laïc de valeurs multiculturelles et plurireligieuses, contre les xénophobies portées tant par les fondamentalismes que l’extrême droite. Cela invitait à la multiplication au sein de la société d’expériences alternatives du « vivre ensemble », dans la reconnaissance du poids des inégalités et des discriminations, et de formes d’auto-organisation démocratique sur lesquelles on pose, à l’inverse, un couvre-feu étatiste. Cela impliquerait pour les gauches, si elles veulent encore avoir un sens émancipateur, de s’extirper du profond brouillard éthique, intellectuel et politique qui les encercle de tous côtés.
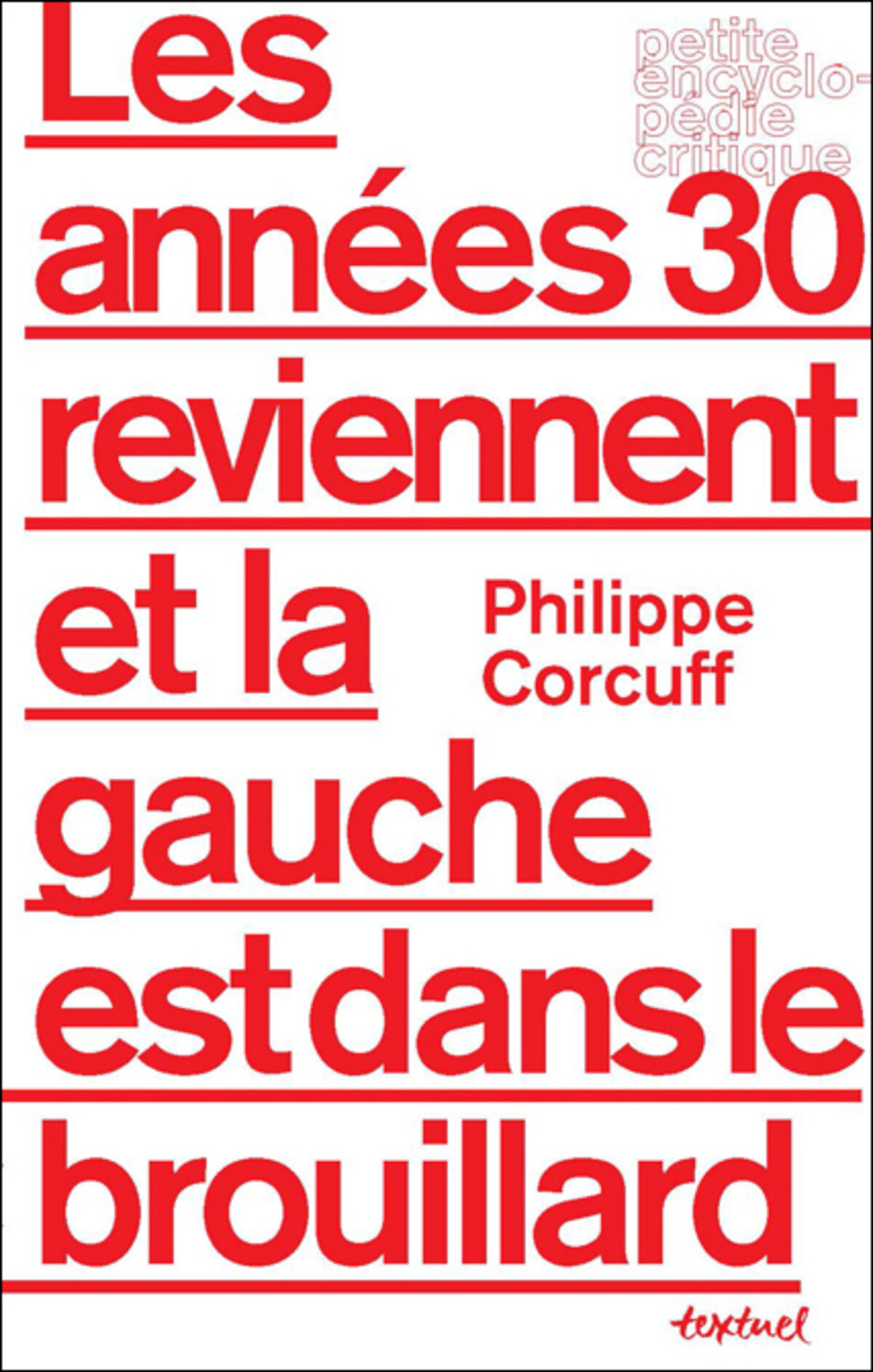
Agrandissement : Illustration 1
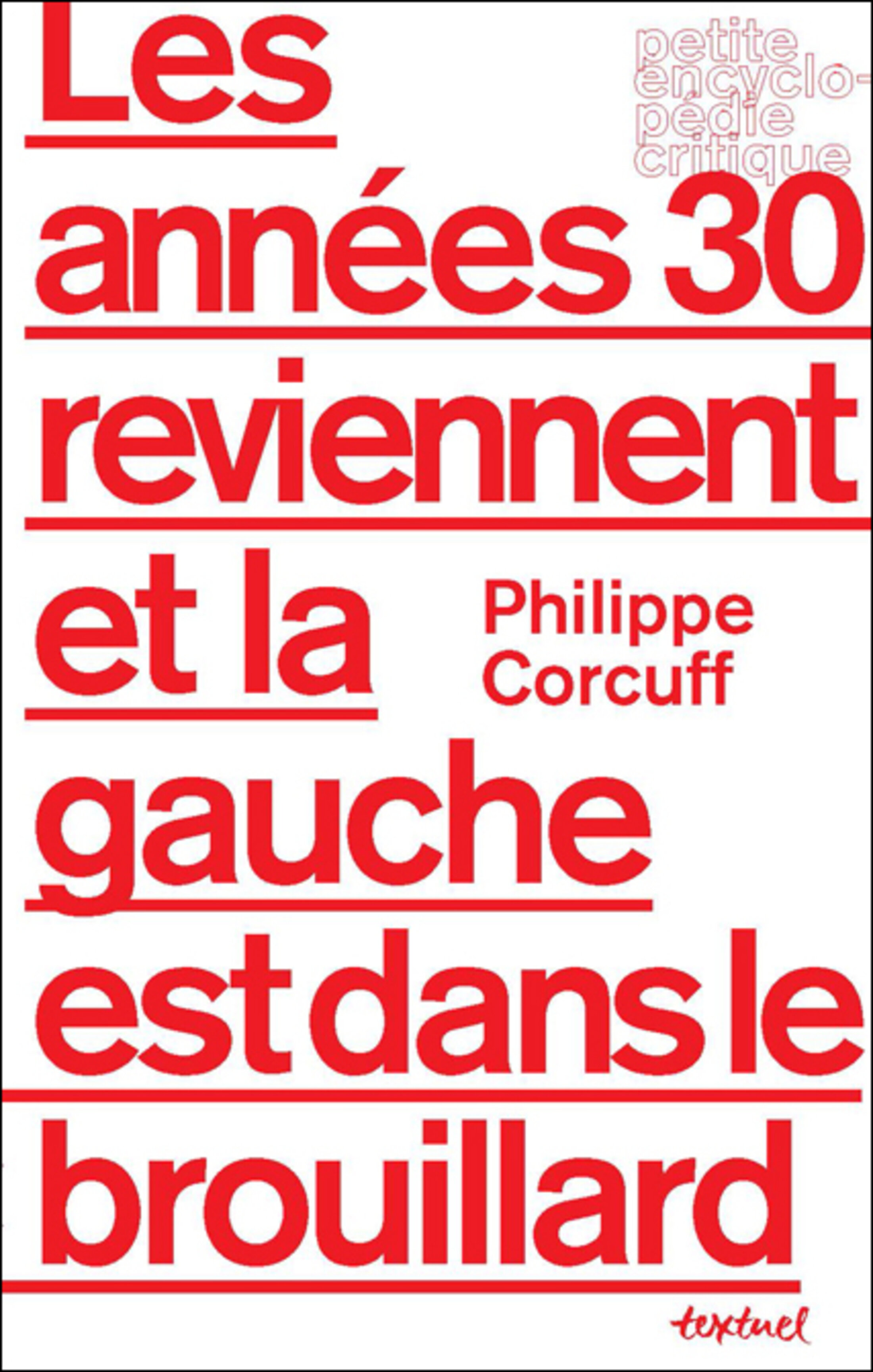
2 – Réfugiés et xénophobie : l’extrême droitisation en Europe
Paru en version espagnole dans le journal indépendant Diagonal sous le titre « La extrema-derechización política de Europa » (traduction de Gladys Martínez López), 10 février 2016, https://www.diagonalperiodico.net/global/29290-refugiados-y-xenofobia-hoy-francia-y-europa.html
La méfiance à l'égard des réfugiés, voire la stigmatisation, du côté des politiciens professionnels, de l'extrême droite à la gauche sociale-libérale de gouvernement, en Europe aujourd'hui s'inscrit dans un cadre global antérieur avec des spécificités nationales.
Je l'ai analysé dans le cas de la France dans mon livre Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard (éditions Textuel, 2014), mais cela pourrait être étendu à d'autres pays européens avec des particularités dues aux contextes nationaux. La France connaît une extrême droitisation politique autour du pôle « postfasciste » incarné par le Front national. Je parle de « postfascisme », car tant le contexte que les caractéristiques de l'extrême droite ont connu des déplacements (par exemple, dans le cas français une républicanisation des thèmes du FN, une démilitarisation du fonctionnement, etc.), en s'adossant toutefois toujours à un nationalisme xénophobe et autoritaire. Extrême droitisation, c'est-à-dire que tant la droite que la gauche sont aimantés par les thèmes de l'extrême droite, comme l'hostilité à l'égard de l'immigration en général et de la récente vague de migrants en particulier, l’islamophobie, le durcissement des politiques sécuritaires, le fantasme essentialiste et nationaliste d'un « peuple » culturellement homogène, etc. La droite, plus proche, est davantage aimantée et la gauche un peu moins mais de plus en plus.
Accompagnant cette extrême droitisation politique, un terreau idéologique néoconservateur, à la fois xénophobe, sexiste, homophobe et nationaliste, s'est constitué, avec en France deux pôles : un pôle islamophobe et négrophobe incarné par le journaliste à succès Eric Zemmour, venant d'une droite se radicalisant, et un pôle antisémite avec un essayiste ayant un certain écho sur internet, Alain Soral, figure « rouge-brune » passée par le Parti communiste et le Front national, s'adressant tout particulièrement à un public de « musulmans patriotes » sur une base « antisioniste » clairement antisémite.
Ce terreau néoconservateur est alimenté par des bricolages idéologiques associant des thèmes d'extrême droite, de droite, de gauche et de gauche radicale. Il peut même avoir des échos dans des secteurs de la gauche radicale française, pour certains une pente nationaliste (présentée comme seule solution face à la domination du néolibéralisme sur les institutions européennes), pour d'autres la vision essentialiste du « peuple », pour d'autres encore la tolérance à l'islamophobie à partir d'usages intégristes du bel idéal de laïcité. Quant à la gauche de gouvernement, on ne peut plus parler depuis le début des années 1980 de social-démocratie, au sens d'un compromis social et d'un État social négociés au sein du capitalisme au profit des salariés, mais d'une conversion à une forme de néolibéralisme appelé social-libéralisme. Ce qui constitue une évolution générale de la social-démocratie en Europe et au-delà.
Dans un premier temps, ce social-libéralisme a cherché à compenser les reculs sociaux par quelques réformes dites « sociétales » (type droits des femmes, mariage pour tous, etc.) qui peuvent être interprétées comme se situant au croisement d'effets des luttes émancipatrices des années 1970 et d'une visée de séduction électoraliste des couches moyennes salariées qui leur étaient les plus sensibles. Mais les dégâts sociaux des politiques néolibérales, la délégitimation des régimes représentatifs professionnalisés indûment appelés « démocraties », les déplacements idéologiques par rapport à un certain épuisement de la vivacité contestatrice des années 1970, les secousses connues par le capitalisme et les difficultés rencontrées par le mouvement altermondialiste et les gauches radicales ont contribué à la consolidation de l'aimantation politique par l'extrême droite.
Le social-libéralisme est devenu sécuritaire, en étant même poreux aux thèmes autoritaires et xénophobes comme à la nostalgie de la nation, du moins dans les discours, la mondialisation capitaliste demeurant l'axe dans les faits. Le projet de constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité comme les politiques restrictives vis-à-vis des migrants en sont les manifestations les plus visibles en France. La croyance politicienne s'est installée selon laquelle il faudrait faire des concessions à une demande sécuritaire d'ordre et à la diabolisation de l'islam pour reconquérir une légitimité « populaire ».
Au sein de la population, les attentats de janvier et de novembre 2015 ont certes créé un climat favorable au sécuritaire, mais quant à la xénophobie les choses apparaissent plus ambivalentes et contradictoires. Les grandes manifestations de janvier 2015 comme nombre de réactions spontanées aux attentats de novembre ont aussi exprimé des valeurs multiculturelles et plurireligieuses. L'extrême droitisation est alors, pour l'instant, un phénomène davantage politicien que quelque chose d'ancrée dans la société française. Les succès politiques et idéologiques de cette extrême droitisation sont en rapport avec la décomposition éthique, intellectuelle et politique des gauches.



