
Les sept mercenaires (The Magnificent Seven) d’Antoine Fuqua est sorti sur nos écrans le 28 septembre 2016. Les personnages joués par Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan Hawke sont ainsi dérivés de ceux interprétés en 1960 par Yul Brynner, Steve McQueen et Robert Vaughn. Une femme fait son apparition dans un rôle important : Haley Bennett. Nic Pizzolatto est un des coscénaristes de ce remake. C’est le showrunner de l’excellente série HBO True Detective (deux saisons pour l’instant, en 2014 et 2015). Fuqua est un cinéaste talentueux mais inégal. Il a notamment mis en scène deux polars intéressants : Training Day (2001), avec déjà Denzel Washington et Ethan Hawke, et surtout L’élite de Brooklyn (Brooklyn’s Finest, 2010), avec un Richard Gere étonnant en flic vieillissant, corrompu, alcoolique et amoureux d’une prostituée, qui se révèlera en quête de rédemption.
De la hiérarchie cultureuse de certains critiques : le caca Fuqua face au génial Kurosawa
Comme le film de John Sturges est déjà un remake de celui d’Akira Kurosawa, une certaine critique à la cinéphilie cultureuse (1) patauge sans s’en rendre compte dans des stéréotypes. En haut, il y a le classique cinéphilique, Les sept samouraïs, puis vient plus « populaire », mais à la côte remontée par la patine du temps, le western de Sturges, puis c’est la chute avec (la dragée !) Fuqua.
Thomas Sotinel est le plus caricatural dans Le Monde (2) :
« Opération à but mercantile, ce double remake d’Antoine Fuqua se distingue par son cynisme et son mauvais goût. »
Et d’ajouter pour inscrire la supposée nullité de la version 2016 au sein d’une hiérarchie partant du chef d’œuvre de 1954 :
« Une poignée d’hommes d’armes qui défendent une communauté d’honnêtes gens en butte à des prédateurs sans foi ni loi : impossible à rater. Des 7 Samouraïs (1954) aux 7 Mercenaires (John Sturges, Yul Brynner, Steve McQueen… 1960) sans parler de tous les films qui se sont inspirés de cette situation essentielle et élémentaire, le spectateur y a toujours trouvé son compte (et bien plus que ça dans le cas du film de Kurosawa). »
François Forestier prolonge dans L’Obs en braquant le projecteur sur les acteurs (3) :
« Dans la version de John Sturges (1960), le casting était génial : Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn, etc. Dans le western de 2016, c’est le contraire ».
Tout en installant Les sept samouraïs au sommet de la pyramide cinéphilique en tant que « classique de Kurosawa ».
Et si, à la différence de ces préjugés typiquement élitistes, de film en film de nouvelles possibilités étaient prospectées dans un autre cadre cinématographique et social, alors que d’autres étaient laissées de côté ? Le voile de la cinéphilie cultureuse trouble la vision de ce point de vue. Car c’est justement ce qui fait le charme de cette série de trois films : des repères nous installant en terrain connu tout en nous faisant découvrir des zones inconnues, un sentiment de familiarité débouchant sur de la créativité, la figure d’une vieille connaissance qui va révéler de nouvelles facettes. Bref Sturges et Fuqua, plutôt que deux niveaux dans la dégradation de l’originel de Kurosawa, incarneraient un cinéma populaire et explorateur. Comme un apprentissage éthique et politique à travers le temps et donc dans le choc de circonstances différentes !
Retour sur le Kurosawa (1954) et sur le Sturges (1960)
Les sept samouraïs a reçu Lion d’argent à la Mostra de Venise en 1954. Il a révélé au grand public international l’acteur Toshiro Mifune. Ce film en noir et blanc, qui se déroule dans le Japon du XVIe siècle, porte notamment sur la justice sociale - le cas de paysans pauvres rançonnés par des bandits - et sur l’honneur dans la société japonaise traditionnelle - via la figure des samouraïs. Cependant, loin de constituer une apologie de l’honneur samouraï, il se présente aussi comme une interrogation critique sur cet honneur au crible des rapports entre les classes. D’ailleurs, les samouraïs que sont venus chercher ces paysans pour les défendre contre les pillards finiront par se transformer au contact de gens modestes qu’ils regardent au départ de haut.
Admirateur de John Ford, Akira Kurosawa a déjà réalisé là une hybridation en incorporant certains traits du western dans un autre contexte social et historique.
John Sturges va se saisir de cette préadaptation de l’œuvre originelle au genre western pour la première version des Sept mercenaires. La justice sociale est toujours là : à la fin du XIXe siècle des paysans mexicains font appel à des gringos tireurs d’élite, menés par Yul Brynner, pour se protéger contre des bandits dirigés par Calvera (Eli Wallach). Un autre contexte socio-historique et un rattachement plus explicite au western rend possible d’autres questionnements.
C’est, entre autres, le rapport entre le dire et le montrer dans l’éthique que le film permet d’éclaircir sous un angle proprement cinématographique. Ce problème éthique peut être travaillé philosophiquement à partir du grand philosophe du XXe siècle Ludwig Wittgenstein, et plus particulièrement de son Tractatus logico-philosophicus (1e éd. : 1921-1922). Dans les dernières propositions de ce livre principalement consacré aux rapports du langage et du monde sous un angle logique, Wittgenstein aborde trois notions qu’il associe : « éthique », « esthétique » et « mystique ». Il écrit ainsi :
« Il est clair que l’éthique ne se laisse pas énoncer. » (4)
Et il précise un peu plus loin :
« Il y a assurément de l’indicible. Il se montre, c’est le Mystique. » (5)
On peut tirer de ces indications un lien fort entre l’éthique et le montrer, à distance du dire, au sens de ce qui est explicité dans un langage, voire théorisé (comme dans une philosophie morale à la manière d’Emmanuel Kant). D’ailleurs, Wittgenstein était un accroc du roman noir américain et ses films préférés étaient les westerns et les comédies musicales, bref des formes esthétiques où l’éthique se montre plus qu’elle ne se théorise. Or, quand entre eux ou face à d’autres, les sept mercenaires sont amenés à justifier pourquoi ils risquent leur vie pour presque rien, ils ne donnent jamais de réponse explicite. Le personnage joué par Steve McQueen tourne autour en racontant à plusieurs reprises de petits contes métaphoriques. Lee, rongé par la peur et les doutes sur lui-même, interprété magnifiquement par Robert Vaughn – sans doute la plus grande performance d’acteur du film – va à peine un plus loin quand la possibilité lui est donnée de quitter le groupe dans un moment particulièrement dangereux :
« - Vas-y Lee, tu sais bien que tu ne dois rien à personne.
- Excepté à moi. »
Il laisse ainsi entendre que l’éthique a aussi à voir avec un sens de sa propre intégrité personnelle.
Á la fin, quand Calvera demande au moment de mourir « pourquoi ? », aucune réponse ne sera énoncée du côté des mercenaires.
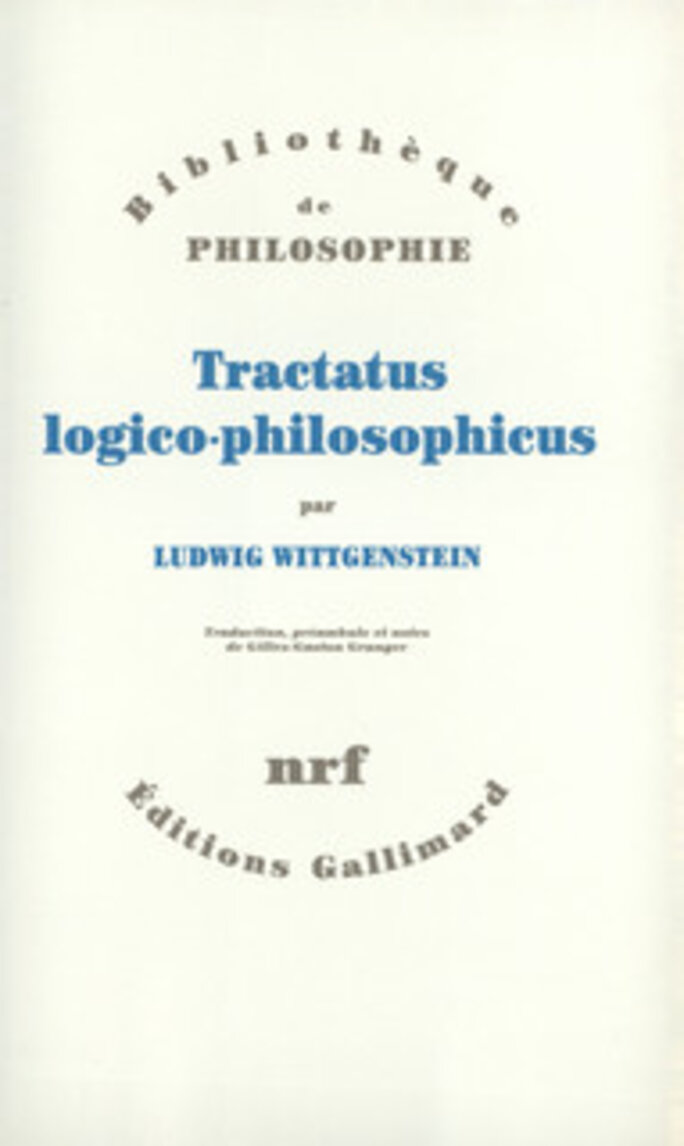
De l’éthique ordinaire de l’impur au multiculturel anticapitaliste
En 2016, Antoine Fuqua relance l’interrogation dans de nouvelles directions. Bien que toujours situé à la fin du XIXe siècle, son western apparaît beaucoup plus contemporain. En notre époque où « la déconstruction » des valeurs traditionnelles et modernes a fait largement son chemin dans la culture occidentale, l’éthique ne semble plus pouvoir avoir le même éclat de pureté. Cela ne veut pas dire qu’il faille abandonner des repères éthiques, à la manière des formes « postmodernes » extrêmes de relativisme. Il s’agit plutôt de reconnecter l’éthique aux fragilités humaines propres à la vie ordinaire en admettant ses impuretés indépassables. Le personnage féminin dont le mari a été assassiné dit ainsi au début du film :
« Je cherche la justice, mais je prendrai la vengeance. »
Elle ne sera pas la seule dans ce cas.
Se dessine alors dans nos sentiments moraux un encastrement pratique de l’horizon de justice et du désir de vengeance. Du coup, l’éthique pourra avec Fuqua davantage se dire du côté des mercenaires – la défense de la justice pour des habitants modestes d’une petite ville américaine menacés par un puissant financier, le millionnaire Bart Bogue (Peter Sarsgaard) et son armée de tueurs - que chez Sturges. Car c’est cette fois l’incomplétude du dire éthique vis-à-vis de sentiments plus troubles l’accompagnant qui compte davantage.
Fuqua suit également des sentiers plus directement politiques. La nouvelle version des Sept mercenaires peut ainsi être lue comme un film Occupy Wall Street, du nom de ce mouvement contestataire qui marqué New York et d’autres villes américaines en 2011. C’est un homme de la Finance qui est au cœur de l’injustice sociale, et pas un simple bandit. Dans une église, avant d’y mettre le feu et de faire massacrer des hommes qui protestent, il rappelle à propos de l’Amérique :
« Ce pays a assimilé la démocratie au capitalisme et le capitalisme à Dieu. »
Et, pour lui, « tout homme a un prix ».
Une coalition multiculturelle s’élance contre le despotisme du Capital financier : menée par un Noir (Denzel Washington), entouré d’un Mexicain, d’un Asiatique, d’un Indien et de trois Blancs marginaux. Il serait simpliste de le comprendre comme une concession au « politiquement correct » hollywoodien. Comme le note Guillemette Odicino dans Télérama :
« c'est bien cette union interraciale qui fait la force du tableau. Les visages des trois survivants de cette guerre contre le pouvoir de l'argent ? Un joli pied de nez à l'Amérique wasp... » (http://www.telerama.fr/cinema/films/les-sept-mercenaires,502698.php)
Si le film de Sturges n’avait pas éliminé tout trace de paternalisme gringo à l’égard des Mexicains, chez Fuqua des figures issues des minorités apparaissent motrices dans la sauvegarde d’une population blanche, et cela dans une logique pluriculturelle et non pas communautariste.
Il y a un autre pied de nez dans ce dernier film : quand on voit Denzel Washington entrer la première fois dans une ville, puis un saloon. Un homme noir muni d’un colt apparaît persona non grata : dans la ville, dans le saloon…et dans le western traditionnel, à quelques exceptions près.
Le cinéma populaire peut nous emmener plus loin que ne l’envisage l’imagination étriquée de la cinéphilie cultureuse…
Notes :
(1) Je préfère ici l’adjectif cultureux à intellectuel, car dans ce type de discours les jugements de goût et leur hiérarchie sociale implicite parasitent fortement l’argumentation proprement intellectuelle, tout en prétendant s’autoriser d’une intellectualité supérieure qui appartiendrait de droit aux détenteurs du capital culturel.
(2) T. Sotinel, « Les sept mercenaires : pour une poignée de tickets », Le Monde daté du 27 septembre 2016, http://www.lemonde.fr/cinema/article/2016/09/27/les-7-mercenaires-pour-une-poignee-de-tickets_5003906_3476.html [accès payant].
(3) F. Forestier, « C’est raté », L’Obs, 28 septembre 2016, http://tempsreel.nouvelobs.com/cinema/20160927.OBS8809/aquarius-la-danseuse-morgane-les-films-a-voir-ou-pas-cette-semaine.html .
(4) L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (1e éd. : 1921-1922), traduction de G.-G. Granger, Paris, Gallimard, 1993, proposition 6.421, p. 110.
(5) Ibid., proposition 6.522, p. 112.



