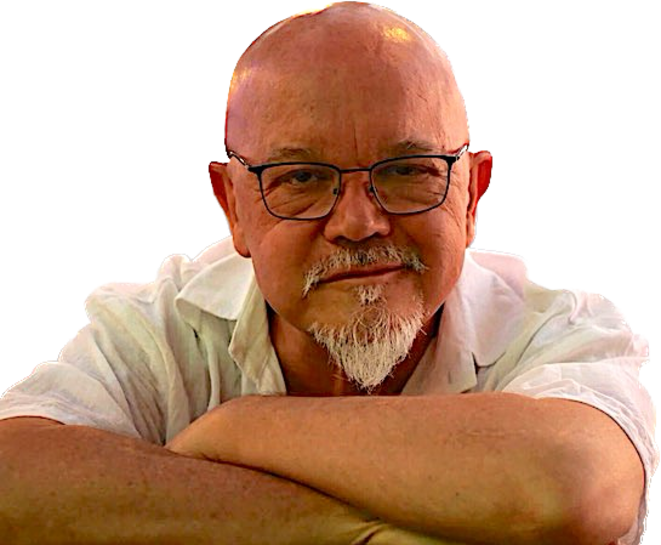Lors de son déplacement à Orange pour visiter un lycée professionnel le 01/09/2023, Emmanuel Macron a proposé un retour à une formation des enseignants après le bac pour « revenir à un système qu’on connaissait par le passé, qui fonctionnait, qui est un peu celui des Écoles Normales ».
Cette proposition ne sort pas seulement du cerveau en surchauffe de notre Proviseur de la République. Elle était déjà présente au détour d’une page dans le dossier de presse de la conférence de rentrée de Gabriel Attal quelques jours auparavant. Et il y a quelques mois, Pap Ndiaye proposait déjà d’en revenir à un recrutement en fin de L3. Une proposition à rebours de l'histoire
Rétroviseur

Agrandissement : Illustration 1

On ne va pas se lancer dans un historique détaillé. On peut juste rappeler que les Écoles Normales ont été créées au 19ème siècle avec la loi Guizot de 1833. Puis ensuite avec une dimension laïque elles ont été généralisées par les Lois Ferry (1879) pour former les instituteurs et institutrices. Ce sont les fameux « hussard noirs » dont on parle encore avec des trémolos dans la voix.
A l’époque, il y avait un recrutement possible dès la troisième qui a perduré jusque dans les années 70 (je m’en souviens !). Et puis , on pouvait y rentrer après le bac pour en sortir deux ans après tout en étant déjà rémunérés. .
Les enseignants de lycée et de collège, quant à eux suivaient une formation différente avec un concours au niveau de la licence (bac+3). Ils avaient très peu de formation pédagogique. Quand j’ai passé le concours en 1981, ça s’appelait le Centre Pédagogique Régional (CPR) : une formation assez sommaire, pilotée par l’inspection et qui s’adressait aux stagiaires c’est-à-dire les titulaires du concours avant validation par une inspection après une année de stage.
On peut rappeler aussi que dans les années 70, il y avait un système (les IPES) qui permettait de rémunérer les candidats à ces concours et qui a permis à des étudiants peu fortunés de devenir enseignant. C'était un moyen de pré-recruter.
La création en 1990 des IUFM (instituts universitaires de formation des maîtres) avait pour objectif de rassembler en un même lieu (à défaut de cours communs) les professeurs des écoles et les professeurs des lycées et collèges pour signifier que c’était bien un seul et même métier avec une formation en alternance.On se formait tout en ayant une partie de son temps en stage ou en responsabilité. Outre la pédagogie et la professionnalisation le « U » d’IUFM signifiait qu’il y avait une dimension universitaire. En 2005, ils sont mêmes intégrés aux universités.
En 2010, la réforme Darcos supprime pour des raisons d’économie, la formation des stagiaires (pensez donc, payer des gens pour se former !) et ceux ci se retrouvent directement devant des classes en responsabilité à temps plein, juste après le concours sans réelle formation. Elle introduit aussi la « masterisation » c’est à dire le passage à un concours en Master. J’étais formateur à l’époque et c’est un de mes pires souvenirs
En 2013, Vincent Peillon crée les ESPÉ. Le concours est alors en M1 et la formation est intégrée aux universités dont les ESPÉ sont une des composantes.
En 2019, les INSPÉ prennent le relais avec une intensification de l’universitarisation. En 2021-2022 se met en place une réforme qui place le concours en fin de M2 et modifie considérablement le statut de « stagiaire » puisque la formation se situe avant le concours et est payée beaucoup moins.
C’est donc JM Blanquer qui a mis le concours en fin de M2 et qui n’a pu que constater l’assèchement du « vivier » de candidats aux concours…
Vivier, attractivité, statut, niveau…
On sait tous que l’enseignement est confronté à une grave crise. Il y a une perte de prestige et un déclassement. Il y a aussi un problème de recrutement.
L’augmentation du niveau de recrutement a été une revendication syndicale. L’idée était que l’augmentation du niveau de diplôme devait aboutir à un ajustement correspondant de la rémunération.
On sait ce qu’il en a été. Le décrochage s’est poursuivi et il se manifeste à trois niveaux : par rapport au coût de la vie (pour un débutant on est passé d’un salaire de 2,3 Smic à 1,2 Smic) , par rapport aux diplômés de même niveau ( un professeur des écoles touche 75% du revenu moyen d’un détenteur d’un master) et enfin par rapport aux enseignants des autres pays.
Le recrutement en master 2 a conduit à assécher encore plus le vivier de candidats potentiels. Ceux-ci se comparent avec leurs camarades étudiants ayant le même niveau de diplôme mais pas les mêmes revenus. Un tel niveau d'entrée pénalise aussi fortement les étudiants les plus défavorisés qui ne peuvent se permettre de telles études. Le recrutement est inégal socialement.
Des tentatives de réformes ont eu lieu pour contrer cette désaffection. On a mis en place un pré-recrutement avec un Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE) au niveau L2 et même avec des classes préparatoires en lycée.
On notera que cela revient à défaire l’unité du corps enseignant et à dissocier de nouveau le premier degré et le second degré. On se souvient de Xavier Darcos se demandant s’il était bien nécessaire d’avoir un master pour changer les couches des enfants… La proposition actuelle se situe dans cette continuité. On remet de nouveau en question l'unité du corps enseignant (et donc aussi sa rémunération)
Macron et les écoles normales
En recrutant post-bac, « on limite l’un des phénomènes qu’on a aujourd’hui, qui parfois crée de la frustration et qui est à mon avis sous-efficace, c’est-à-dire d’avoir certains de nos enseignants qui rentrent après un cursus universitaire qui est totalement disproportionné et parfois décorrélé avec ce qu’ils vont faire ». C’est ce qu’a déclaré Emmanuel Macron à Orange. Xavier Darcos appréciera la référence...
On voit bien la logique qui est de trouver une solution au problème de la pénurie de candidats par la baisse du niveau de recrutement supposé élargir le « vivier ». On voit bien aussi se profiler la baisse de la rémunération. Dis que tu veux dévaloriser les enseignants et limiter leurs prétentions salariales sans le dire…
C’est évidemment une mauvaise solution à un vrai problème. La vraie solution : payez les mieux !
Cette proposition va aussi à rebours du cours de l’histoire. Alors que le niveau général d’éducation de la population augmente, baisser le niveau de recrutement de certains enseignants (ceux du primaire…) serait une aberration. C'est non seulement une question de rémunération mais aussi de "prestige" et donc d'autorité.
De plus, alors que le rapport au métier change pour les nouvelles générations, cela aboutit à enfermer très tôt dans une carrière et un type d'emploi.
Comme on l'a vu plus haut cela aboutit aussi à recréer ou plutôt à renforcer des inégalités entre les différents niveaux d’enseignement.
Cela laisse aussi entendre que ceux ci n’ont pas besoin d’autant de formation. Je ne peux m’empêcher de relier cela à l’attaque contre le « pédagogisme » développée dans l’interview au magazine Le Point (et qui peut même séduire certains enseignants). Les remises en question de la formation continue sous prétexte de l’«absentéisme» des enseignants vont dans le même sens.
***
J’ai pendant 16 ans été formateur en temps partagé, successivement à l’IUFM, puis l’ESPÉ et enfin l’INSPÉ. Je ne compte plus le nombre de réformes auxquelles j’ai du m’adapter. Comme tous mes collègues, j’ai aussi subi les attaques démagogiques de ceux qui estiment qu’il suffit de bien maîtriser sa discipline et les « fondamentaux » pour enseigner et qui raillent la pédagogie. Bien sûr, il faut que la formation soit requestionnée sans cesse mais pas dans ces conditions et cette urgence.
Ce que je retiens surtout de ces années où j’ai été à la fois enseignant et formateur, c’est qu’enseigner est un métier qui s’apprend, collectivement et tout le temps. Il faut du recul, du temps et une certaine sécurité pour apprendre. Ce métier s’accommode mal de la précarité, de la précipitation et de l’absence de considération.
Plutôt que de chercher des solutions dans un passé mythifié, il faut construire et investir dans un système éducatif d’avenir et à la hauteur des enjeux !