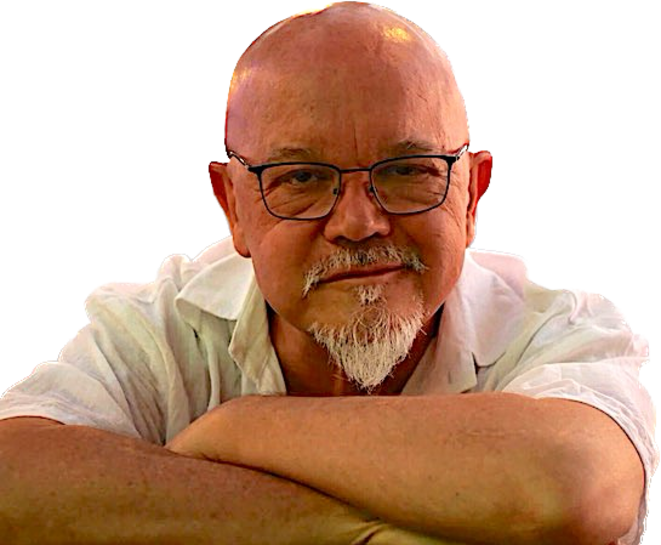Faut-il être enseignant pour devenir ministre de l’éducation ? Non. Et bien des exemples nous montrent qu’on pouvait être un ministre compétent sans cela. Mais alors, leur expérience de la vie politique et du fonctionnement d’un cabinet et d’une administration leur donnait des compétences pour arbitrer et diriger. Dans le cas de Mme Anne Genetet, il n’y a ni l’un ni l’autre. Le fait d’avoir eu des parents dans l’enseignement, comme elle l'évoquait dans son discours (très creux) lors de la passation de pouvoir, n’est pas un « joker » suffisant.
Si elle a été nommée, c’est, semble t’il, le résultat d’un subtil équilibre entre les « macronistes » et les Républicains. L’influence de Gabriel Attal se voit non seulement dans le choix de cette proche mais aussi dans la composition du cabinet d'une ministre débutante et inexpérimentée. Le choix pour compléter d’un ministre délégué issu des LR et plus compétent constitue un attelage précaire.
On a beaucoup évoqué le passé de la ministre qui s’est illustrée dans les conseils pour gérer du personnel de maison alors qu’elle était femme d’expat’ à Singapour. Mais plutôt que de gloser sur son passé et l’étiquette qu’on lui colle a priori, intéressons nous à ses premières déclarations.
« Élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau », cette formule un peu creuse fait écho à « Rétablir l’ordre, rétablir l’ordre, rétablir l’ordre » de son collège Retailleau. Elle illustre un des ressorts du discours réactionnaire et décliniste qui est à l’œuvre dans de nombreux domaines.

Agrandissement : Illustration 1

Pour qu’un narratif de « restauration » puisse fonctionner, il faut qu’il s’appuie sur un récit fondé sur une dramatisation préalable de la situation. C’est sur cette astuce rhétorique que s’est appuyé son mentor Gabriel Attal lorsqu’il était Ministre de l’Éducation. Le 5 décembre 2023, le jour même de la sortie des résultats de PISA 2022, il prend la parole pour annoncer son plan de « choc des savoirs ». Pour cela il s’appuie sur une lecture très catastrophiste de l’étude de l’OCDE
Lorsque, comme moi et d’autres, on lit le rapport dans le détail et qu’on écoute la présentation qui en est faite par les experts, on ne conclut pas à un tel déclin aussi dramatique.
J’ai été surpris, je dois l’avouer, par la tonalité générale de la presse (exceptées quelques expressions plus nuancées) et surtout des éditorialistes et du personnel politique qui ont repris sans nuances et sans recul, ce discours exagérément décliniste. Il faut dire que lire le détail de l’enquête quand on ne se contente pas du résumé, ça prend du temps. Il faut reconnaitre aussi que malgré les précautions de lecture, la présentation sous forme d’un palmarès, fait oublier que le classement repose sur des différences minimes de quelques décimales. Et puis, à l’ère des réseaux sociaux, du buzz, du clash et de la punchline, la nuance n’est pas de mise.
Il faut dire enfin que ce discours décliniste correspond bien à l’air du temps. L’opinion sur l’école est depuis très longtemps imprégnée du refrain du « c’était mieux avant » qui est à la frontière de la nostalgie et du conservatisme. La paresse des médias et particulièrement des éditorialistes fait le reste. On vous donne à entendre ce que vous voulez, sans nuances. Ce qui est le propre de la démagogie.
Ne succombons pas un discours binaire inverse. Il ne s’agit pas ici, de dire que tout va bien dans notre système éducatif. Mais d’apporter des nuances et de se méfier des discours (et des solutions) simplistes.
L’enjeu n’est pas celui de la comparaison avec les autres pays en voyant l’éducation sous l’angle de la compétition internationale. Si l’École va mal, ce n’est pas tant parce qu’il y aurait un problème de niveau que parce que notre système est profondément inégalitaire. D'ailleurs, le « niveau » du premier quart des élèves français est très élevé alors que celui du dernier quart est très faible. Par exemple, les enfants issus de milieux socio-économiques favorisés affichent des résultats en mathématiques supérieurs de 113 points à ceux des élèves défavorisés.
C’est la leçon de l’enquête Pisa et de toutes les études sérieuses que le gouvernement refuse de voir. C’est ce qui le conduit à bégayer et à répéter cette antienne sur le niveau comme seule orientation
Car Anne Genetet n’est pas la seule à utiliser des formules creuses. Dans son discours de politique générale, le 1er octobre 2024, Michel Barnier déclarait : « l’école, voilà qui reste la priorité ! ». Deux minutes dans un discours de 1h30 avec un enfilage de perles du plus bel effet : « une école qui permette d’apprendre, de forger le jugement et à force de travail de prendre leur avenir en main et de participer à celui du pays ». C’est digne des discours du Maire de Champignac dans Spirou.
La proposition de faire appel aux professeurs retraités pour pallier l’absence des enseignants (on a échappé de peu à l’«absentéisme»...) ne relève pas non plus le… niveau.
La seule phrase qu’il faut retenir de ce passage sur l’éducation est celle où il dit à propos des enseignants « ils ont moins besoin de grandes réformes et d’une énième refonte des programmes que du bon fonctionnement de leur établissement. ». On se prend à espérer que cela signifie un enterrement des réformes en cours. De même, lorsque la ministre lors d’un entretien avec des représentants syndicaux déclare : « le navire garde le cap, ce que je vais changer c'est la vitesse du navire » on espère que la vitesse va diminuer.
Doit-on interpréter ces déclarations comme une volonté d’apaisement et de ralentissement des réformes ? Cela semble logique dans la mesure où les contraintes budgétaires limitent considérablement la marge de manœuvre de la ministre. Avec les coups de rabot on n’a pas même assez pour payer les traitements des fonctionnaires.
Pourtant, dans son interview à RTL, la ministre Genetet se déclare pour le maintien des mesures du choc des savoirs et notamment les groupes de niveau malgré l’opposition des enseignants qui rejettent cette mesure de tri social. Elle affirme également vouloir mettre en œuvre la réforme de la formation initiale des enseignants, coûteuse (2 Mds) et pas assez préparée et concertée avec les universités et les INSPÉ. On ne lit pas non plus de remise en cause du SNU, cette lubie présidentielle dont un rapport de la cour des Comptes estimait le coût annuel à 5 milliards pour un résultat très discutable.
Pendant ce temps, on prévoit des fermetures de classes au lieu de profiter de la baisse démographique. Il manque des enseignants à tous les niveaux. Les conditions de travail des enseignants et donc de leurs élèves se détériorent. Des enseignants manquent (ils ne sont pas « absents ») parce que l’attractivité n’est pas…au niveau...
Et surtout, rien n’est fait pour affronter les inégalités scolaires et sociales. Aucune mesure n’est prise pour garantir la mixité sociale et l’enseignement privé n’est pas inquiété pour sa responsabilité dans la ségrégation sociale. Il faut dire qu’il a de forts soutiens dans le gouvernement.
***
Déclarer que l’École est une « priorité » ne veut rien dire. Il faut clarifier les finalités qu’on lui assigne. Vouloir « élever le niveau » n’est guère plus précis. Est-ce dans une logique de sélection ou d’émancipation ? Veut-on poursuivre le tri social dans une école de la ségrégation ou construire une école du vivre ensemble qui permette la réussite de tous ?
Ces questions devraient pouvoir être débattues et précisées dans une grande convention citoyenne sur l’Éducation. La cause de l’École est une affaire trop sérieuse pour être confisquée et instrumentalisée dans des jeux politiciens et démagogiques.
Faute de clarification, faute d’objectifs clairs, la politique éducative est condamnée à bégayer...
Ph. Watrelot