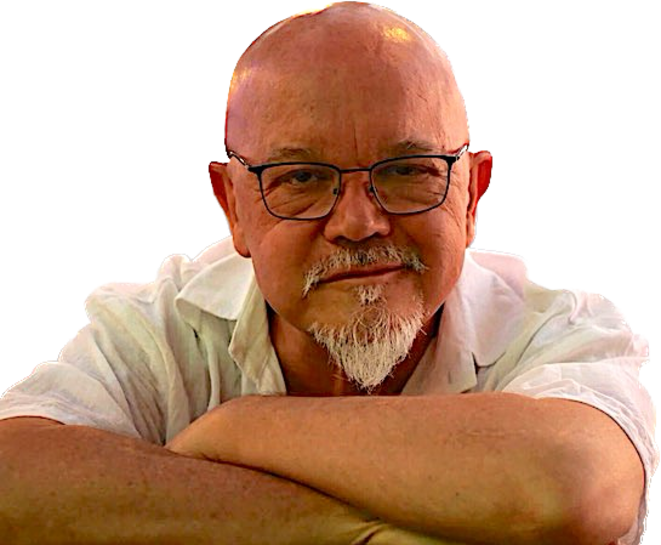Agrandissement : Illustration 1

« gogoleries infantilisantes » « dispositifs humiliants », « délires », « Je préfère démissionner immédiatement que subir ça », « Après il ne faudra pas se plaindre qu'on ne nous prenne pas au sérieux », « Passer un concours ultra difficile pour s’amuser avec des fils…» ; voici quelques unes des amabilités formulées en commentaires de cette image par des comptes le plus souvent « anonymes »...
Cela n’est pas nouveau. Cela fait de nombreuses années que les mouvements pédagogiques qui se risquent à publier des photos de leurs rencontres et autres stages s’exposent à la moquerie. Les auteurs de ces remarques ont beau évoquer l’ « humour », ce n’en est pas. Au mieux c’est du mépris et c’est en tout cas d’une grande violence face à des personnes qui, en l’occurrence font cela sur leur temps libre et bénévolement. Une forme de « prof bashing » mais entre soi...
Je ne sais pas si on peut trouver des excuses à tous ces haters mais on peut peut-être essayer de comprendre ce qui les amène à un tel ressentiment et essayer d’analyser ce que ça dit sur les conceptions du métier d’enseignant.
Crispations
L’heure n’est pas à la bienveillance et la nuance est morte et enterrée depuis longtemps sur les réseaux sociaux. A l’abri derrière leurs écrans, des enseignants se lâchent et expriment une violence qu’ils ou elles n’auraient pas face aux collègues en chair et en os. J’ai déjà écrit sur cela dans plusieurs billets de blog et même dans un livre. La violence verbale sur les réseaux n’est pas propre aux enseignants, c’est un phénomène global.
Le sentiment de déclassement et de perte de prestige n’arrange rien. Beaucoup d’enseignants se sentent déconsidérés et voient ces dispositifs comme des remises en cause de leurs statuts. Si le terme d’ «infantilisation » revient si souvent ce n’est pas par hasard tout comme le mot « mépris » arrive en tête du nuage de mots que je publie chaque année. Cela fait écho au ressenti à l’égard de l’institution à laquelle est assimilée la formation.
J’ai été pendant seize ans formateur en temps partagé et je connais bien aussi les critiques à l’égard de la formation initiale. « Passer un concours ultra difficile pour s’amuser avec des fils…» dit un des commentaires. J’ai pu entendre quelquefois cette même phrase presque mot pour mot (sauf que je n’ai pas utilisé de laine...). Cette méfiance de certains face à la formation est renforcée par ce que le chercheur Louis Marie Bossard appelle l’ «adolescence professionnelle » : les stagiaires se sentent à la fois enseignants lorsqu'ils sont en présence d'élèves quelques heures par semaine et élèves lorsqu'ils sont en formation à l’IUFM/ESPÉ/INSPÉ. Ce décalage est quelquefois difficile à vivre d’autant plus qu’on peut avoir le sentiment que ce qui importe ce sont les seules connaissances académiques plutôt que des dispositifs dont on ne voit pas le sens. Les formateurs ont une vraie réflexion à mener (je parle même d’aggiornamento) sur leurs pratiques et la manière de les présenter.
Enfin, la pensée conservatrice progresse dans tous les domaines et, là aussi, l’éducation ne fait pas exception à la règle. Si on a forgé le mot « pédagogiste » il y a quelques années c’est pour rassembler sous un même vocable plusieurs critiques (infondées) faites à la pédagogie : baisse du niveau, « ludique » qui oublie l’exigence, perte d’autorité, … La liste est longue et le pédagogiste constitue un épouvantail facile qu’on peut accabler de tous les maux. Il est toujours plus facile de combattre un ennemi qu’on se fabrique soi même et de se parer de vertus qu’on dénie aux autres. Certains enseignants sont sensibles à ces arguments conservateurs voire réactionnaires qu’on peut même masquer sous une posture en apparence "gauchiste".
Remue méninges
Mais revenons à nos ponts en spaghettis, nos pelotes de laines, nos post-it de toutes les couleurs, nos photos-langages, nos « pecha-kucha » et tous ces dispositifs qui peuvent être utilisés en formation.
Ce sont tous ces outils qui suscitent beaucoup de dédain chez certains enseignants. Essayons de voir quelles sont ces critiques et ce que ça dit sur leur conception du métier enseignant.
Pour certains cela « rappelle l’entreprise » même s’ils n’y ont jamais mis les pieds. Rien de tel que d’utiliser un terme anglais et de le rattacher au monde économique pour disqualifier une idée pour un bon nombre de profs. Parlez de « team building » ou de « brain storming », c’est le sarcasme assuré ! C’est vrai que ce sont des procédés utilisés dans le monde de l’entreprise mais on peut aussi se les réapproprier. Et ce n’est pas parce que le monde économique fait de la formation qu’on doit s’interdire d’en faire.
« C’est une perte de temps » est une autre critique souvent entendue. Derrière ces quelques mots se cache une certaine conception de la formation. Il faudrait tout de suite rentrer dans le vif du sujet et surtout dans une conception très magistrale et réductrice du dispositif. Une formation, ce serait un forcément un « savant » qui enseigne à des gens qui apprennent ? On laisse ainsi de côté toute idée d’auto-formation ou même d’échanges d’expériences. Et on oublie que dans toute situation d’apprentissage, il y a une phase de sensibilisation et de découverte des enjeux (qui doit précéder l'approfondissement et ne pas s'y substituer, évidemment). Se former c’est aussi une dynamique qui repose sur une expérience partagée et une relation au sein d’un groupe qui se crée.
La principale critique est donc celle de l’ « infantilisation » qui justifie le refus de s’impliquer de la part de ceux qui sont revenus de tout sans jamais y être allés. Mais se sent "infantilisé" qui veut bien l’être. À ce compte là, chanter en chœur à un concert ou taper en rythme dans ses mains peut être aussi ressenti ainsi. Tout est une question de contexte (et de bienveillance). L’esprit de sérieux de certains collègues est à la mesure de la haute estime qu’ils ont d’eux mêmes et leur fait oublier qu’on peut faire les choses sérieusement sans les faire tristement. Un stage, un moment de formation, c’est aussi l’occasion de faire un pas de côté.
Et d’ailleurs questionnons ce terme d’ « infantilisation »... Et si ce n’était pas si mal de se mettre dans la peau d’un enfant ou en tout cas de quelqu’un qui apprend ? Dans les stages des Cahiers Pédagogiques, depuis des années il y a des ateliers « activités » qui ne sont pas seulement là pour se détendre mais pour se mettre en situation d’apprentissage de quelque chose de nouveau et de comprendre les mécanismes qui sont à l’œuvre, les résistances et les échecs éventuels.
Les mises en situation servent à faire le pas de côté évoqué plus haut. Se mettre dans la peau d’un « apprenant » (vous l’attendiez, le voilà... !) suppose de mettre un peu de côté son égo et de lâcher prise.
Mais pour cela, il faut accepter de se frotter aux autres (et pas forcément se confronter), savoir écouter leurs paroles, prendre le temps. Or, nous les enseignants, nous sommes bien trop individualistes (et peut-être même narcissiques) et persuadés que nous savons des tas de choses et que nous n’avons pas forcément à en apprendre de nouvelles. C’est cette posture là qui nous dessert, bien plus que le fait de se retrouver entourés de bouts de laine... !
***
Plutôt que des sarcasmes et de l’ironie facile, on devrait s’emparer des réseaux et de tous les moyens de communication pour réclamer plus de formation initiale et continue !
Pas des pseudo-formations “verticales” où on vous lit et on vous explique la dernière circulaire dans un temps limité. Mais surtout des formations « horizontales » où on prend le temps de partager les expériences et les réflexions. Où le verbe « co-construire » n’est pas l’objet de moqueries mais une réalité pour reprendre en main son métier. Relier les gens (avec ou sans fils de laine) et construire des ponts (avec ou sans spaghettis)...