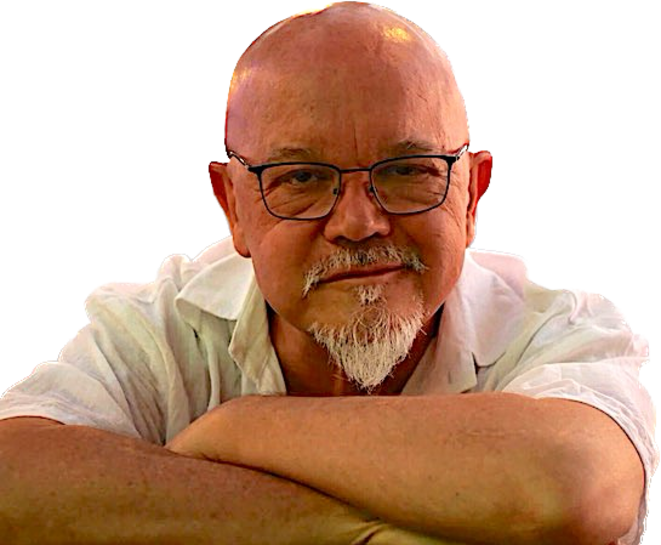Le jeudi 22 décembre, le Monde a publié une tribune signée Pap Ndiaye intitulée « Pourquoi nous devons réformer l’école ». Le Ministre de l’Éducation y développe trois exigences : rétablir le “niveau“, rétablir l’égalité des chances et améliorer le fonctionnement de l’École.
Si M. Ndiaye nous offre cette tribune de Noël aux allures de circulaire de rentrée, on notera qu’il pose la question du « Pourquoi » mais pas du « Comment ». Or, c’est là que le numéro d’équilibriste auquel il se livre trouve ses limites.
Un constat et un désaveu

Agrandissement : Illustration 1

Pourquoi écrire une telle tribune à la fin de l’année (civile, pas scolaire) ? Le début du texte part d’un constat qui n’est pas nouveau. L’état de l’École qui y est décrit est connu de tous, même si on peut discuter l’insistance sur la baisse du niveau. La structure bureaucratique, l’infantilisation des enseignants, le manque d’attractivité du métier… apparaissent comme des évidences. Tout comme le caractère inégalitaire de l’École peut l’être pour les observateurs attentifs même s’il est toujours utile de le rappeler tant l’opinion publique et les éditorialistes peuvent être dans le déni à ce sujet.
A la lecture du constat, un huron, naïf ou caustique, pourrait se demander pourquoi diable, n’a t-on rien fait dans les cinq années précédentes ? Car cette tribune ressemble bien à un désaveu ou du moins une critique implicite de l’action de Jean-Michel Blanquer. C’est aussi une tentative de prise d’indépendance à l’égard de l’omniprésence présidentielle dans le domaine de l’éducation. C’est là que l’exercice devient délicat : comment exister et se relancer sans tomber dans la contradiction ? Comment donner des gages aux uns et aux autres sans faire le grand écart ?
« Le niveau (d’ensemble) baisse ! »
La première exigence formulée par le Ministre historien reprend une antienne bien connue de tous les discours sur l’École. Car l’Histoire nous apprend pourtant que cela fait des siècles que le fameux « niveau » baisse !
On a l’impression que la mise en avant de cette affirmation est d’abord là pour complaire à toute une frange décliniste et conservatrice de l’opinion. C’est justement ce courant de pensée qui est à l’affut du moindre signe de “laxisme” du Ministre et l’accuse de tous les maux.

Agrandissement : Illustration 2

Il ne s’agit pas à notre tour de tomber dans le déni mais de nuancer cette affirmation. On notera d’ailleurs que le Ministre prend soin de préciser qu’il s’agit du niveau « d’ensemble ». Car, plutôt que d’utiliser les enquêtes internationales (PISA, PIRLS, TIMMS…) comme des palmarès où les classements se jouent à quelques dixièmes, il faudrait retenir que ce qui caractérise les résultats des élèves français c’est d’abord leur grande dispersion.
La France est le pays du grand écart, celui où l’origine sociale joue le plus dans les résultats scolaires. Si les « meilleurs » ont un très bon niveau ce sont les plus défavorisés qui subissent les inégalités.
Il serait bon de ne pas oublier que ce qu’on évalue ce ne sont pas les élèves ni même leurs enseignants (qui font de leur mieux), ce sont les performances et les lacunes du système éducatif. La publication par le MEN des Indices de Position Sociale (IPS) des écoles et collèges après une longue bataille juridique montre bien l’inégale répartition des moyens.
Mixité sociale et scolaire
La lutte contre les inégalités sociales à l’École devrait être la principale priorité. L’enjeu est clairement énoncé par le ministre lui même : « Une école qui, tout en la promettant, n’accorde pas l’égalité produit non seulement des injustices, mais aussi une défiance et un sentiment de colère dans les classes populaires.»

Le Ministre reste cependant très flou dans ce texte sur les mesures à prendre. Il évoque cependant à demi-mots la possibilité d’une obligation de mixité sociale dans l’enseignement privé. On a envie de dire « Chiche ! » à cette proposition. Mais on sait aussi que le contournement est toujours possible. Si seuls les élèves avec de "bons profils scolaires" sont retenus, la mesure ne sera pas pleinement efficace. Car au delà de la mixité sociale, c’est aussi l’hétérogénéité scolaire qu’il faut garantir. Si la mixité s’arrête à la grille du collège ou du lycée et que les classes trient les élèves, on n’aura pas vraiment progressé. On voit en tout cas que ces projets aussi limités soient-ils peuvent rentrer en collision avec une partie de l’électorat macroniste
Il n’est pas sûr que les projets de découverte du monde professionnel à partir de la 5ème évoqués dans les discours présidentiels aillent dans le sens de l’égalité des chances. On peut craindre que cela conduise à de l’orientation précoce des élèves des milieux populaires vers les filières professionnelles ou l’apprentissage. La vigilance s’impose.
Réformer sans moyens ?
La même vigilance s’impose aussi sur la troisième exigence formulée par le ministre. Quand celui-ci évoque l’amélioration du fonctionnement de l’École, il parle de l’absence de marge de manœuvre pour les remplacements, du manque d’attractivité pour les concours et de l’infantilisation du système. Mais ce qui est prévu ou connu jusque là est-il suffisant pour pallier à ces difficultés ?
La réponse est clairement : Non !
Les mesures de rattrapage (je préfère ce terme à celui de “revalorisation) se font attendre et ne concerneront que la moitié des enseignants.
Par ailleurs, la lecture du budget nous apprend qu’on prévoit 1100 postes supprimés dans le Primaire et 500 dans le Secondaire. L’argument de la démographie a bon dos alors qu’on aurait pu en profiter pour améliorer le taux d’encadrement et donner de la souplesse aux établissements. Malgré les efforts les moyens sont insuffisants.
On peut douter aussi de la capacité à évoluer de cette structure pyramidale et bureaucratique qu’est l’École. La force d’inertie y est considérable et contribue à la méfiance des enseignants à l’idée même de « réforme ».
Réformer malgré ou avec les enseignants ?
J’ai usé jusqu’à la corde ce jeu de mots : avant de penser l’École de demain, il faut déjà panser l’école d’aujourd’hui.
C’est un préalable. Pour le dire autrement, on ne peut pas réformer l’École avec des enseignants qui vont mal.
Restaurer la confiance, « fatiguer le doute », cela passe par des mesures concrètes. Et d’abord une triple mise à niveau du revenu de tous les enseignants : par rapport au pouvoir d’achat, par rapport aux diplômes équivalents et par rapport à leurs homologues étrangers.
Ce qui est proposé est insuffisant. Certaines mesures telles que le « nouveau pacte » reprennent la vieille rengaine sarkozyste du « travailler plus pour gagner plus ». Plutôt que de laisser entendre que les enseignants ne travaillent pas assez, il faudrait mieux reconnaitre qu’ils effectuent déjà de nombreuses tâches et raisonner « TTC » (Toutes Tâches Comprises). De même l’injonction à l’innovation risque de créer une mise en concurrence néfaste et une individualisation là où il faudrait créer du collectif et donner du temps plus que des primes.
La difficulté de l’usage du mot « réforme » doit aussi être prise en compte. Dans un métier où les enseignants mettent beaucoup d’eux-mêmes, le risque est grand que cela soit pris comme une critique implicite de leur propre travail.
Le monde enseignant est marqué aujourd’hui par une profonde lassitude et beaucoup d’amertume. Après cinq ans de blanquerisme technocratique, il y a beaucoup de méfiance face aux promesse et l’attente de signes forts qui ne viennent pas.
L’idée même de réforme en devient un repoussoir. Même si une bonne partie des enseignants se rendent compte que le système fonctionne mal, il y a une forme de cynisme qui peut conduire au conservatisme.
Si le Ministre nous explique « Pourquoi », il faut réformer l’école, on attend de lui qu’il sorte de l’ambiguité et du flou et nous dise aussi et surtout « Comment »…
Une partie de la réponse est en tout cas une exigence : « … avec les enseignants ».
Philippe Watrelot