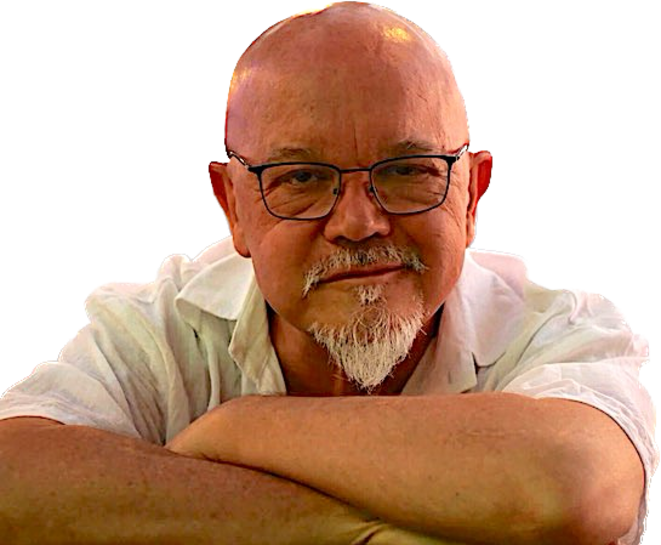En juin 2024, plusieurs responsables de l’éducation nationale avaient envoyé des courriers expliquant que les fonctionnaires étaient tenus de « s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique ». Dans l’académie de Rennes, le mail a été largement diffusé. Il est arrivé sur les boîtes électroniques de toutes les écoles. Dans d’autres académies, les courriers adressés aux personnels de direction des collèges et lycées ont été transférés sur les boites professionnelles de tous les professeurs.
Cela a suscité beaucoup d’émois chez les personnels même si les syndicats ont rapidement rappelé que ces consignes étaient abusives. Même en période électorale, les enseignants ont le droit de participer à des manifestations publiques et de s’engager dans les débats des élections municipales.
Période de réserve et devoir de réserve.
Précisons les termes. Il ne faut pas confondre « période de réserve » et un supposé « devoir de réserve ». Les élections municipales auront lieu le 15 mars pour le 1er tour et le 22 mars pour le 2èmetour. Dès le 1er septembre, on entre dans une période qui est encadrée par quelques règles limitant la parole publique et la propagande électorale. La campagne électorale proprement dite est bornée à une quinzaine de jours. Elle est ouverte à partir du deuxième lundi précédent le jour du scrutin (le 1ermars). Elle prend fin la veille du scrutin à minuit.
La "période de réserve" qui commence le 1er septembre s’applique surtout pour les membres du gouvernement, le corps préfectoral, et l’ensemble des fonctionnaires d’autorité. Cette règle coutumière, c'est-à-dire non inscrite dans une loi, vise à garantir la stricte neutralité de l'État dans cette période particulière.
Mais cette règle s’applique d’abord et surtout aux municipalités. Celles-ci doivent cesser toute campagne de promotion de leurs réalisations six mois avant le début des élections. Si le ou la maire de votre commune inaugure un équipement en faisant un beau discours, il ou elle est hors-la loi !
Pour préserver la neutralité et l’impartialité des agents, cela concerne aussi les membres du corps préfectoral, les chefs de service de l'État et autres fonctionnaires qui sont amenés à participer, dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations ou cérémonies publiques de ce type.
Ce cadre a également pour objectif de s'assurer qu'aucun fonctionnaire ou agent public ne fera usage de sa fonction à des fins de propagande électorale. Mais ça s’arrête là ! Les autres règles de neutralité et de réserve ne sont pas différentes en période électorale ou non. Et elles sont très réduites.
Notons au passage, que cette période de réserve doit, en principe, s’appliquer aussi aux membres du gouvernement… Il n’est pas interdit de sourire voire de se gausser devant la subtilité qui consiste à dire que le ou la ministre peut intervenir dans le débat dès lors qu’il ou elle s’exprime en tant que personnalité politique et non pas en tant que membre du gouvernement ! Mais on s’éloigne de notre sujet…
Revenons un an en arrière… Devant le tollé provoqué par les courriers que nous évoquions plus haut, les rectorats avait été amenés à préciser que l’abstention de participation à une manifestation ou une cérémonie publique susceptible de présenter un caractère pré-électoral ne concernait que "le haut encadrement".
Les chefs d’établissement et les inspecteurs n’en font pas partie. Et, tout comme les enseignants, ils peuvent participer à des élections et à des campagnes électorales à condition de ne pas se prévaloir de leur statut.
Mais les réflexes autoritaires ont la vie dure et on peut craindre que ce type d’intimidation ne se retrouvent encore cette année. Il n’est donc pas inutile de rappeler ce qu’est le devoir de réserve.
Devoir de neutralité, de discrétion et… de « réserve »
Même si je ne suis pas juriste, ma pratique d’enseignant, de syndicaliste et de responsable associatif m’a donné quelques repères que je partage avec vous.
La loi qui régit le droit d’expression des fonctionnaires (et donc des enseignants) est la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce texte est souvent présenté comme la « loi Le Pors » (du nom du ministre de la Fonction Publique de l’époque).Il a été en partie modifié par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique,
L’article 26 de la Loi Le Port précise que « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Par ailleurs, la même loi garantit la liberté d'opinion aux fonctionnaires et ils bénéficient comme tous les citoyens des droits et libertés reconnus à tous.
Simplement, être fonctionnaire n'autorise pas à engager l'État dans ses choix personnels. J'ai tout à fait le droit de me présenter à des élections, mais pas de dire que c'est dans le cadre de mes fonctions.
De même, je peux parler de mon métier mais pas "révéler" des informations professionnelles (par exemple, publier les résultats des élèves). Cette obligation de discrétion se retrouve d''ailleurs aussi dans les entreprises où existent souvent des clauses de confidentialité.
Enfin, je dois me garder de faire état de mes opinions dans le cadre de mon enseignement, c’est le devoir de neutralité (qui s’articule aussi avec la laïcité). Par exemple, je me garderai bien d’arborer un tee-shirt ou même un badge avec des références partisanes.
Mais en dehors de cela, un fonctionnaire garde toute liberté de critiquer l'action du gouvernement et la politique de son académie, à condition que sa critique ne porte que sur des éléments connus du public, comme les articles de presse, les émissions de télévision et même les documents administratifs (circulaires, notes de service...). La liberté d’opinion et la liberté d’expression sont donc garanties aux fonctionnaires par cette même loi Le Pors (loi n° 83-634, 13 juillet 1983, art. 6) et par le code général de la fonction publique.
« excès de zèle » ou abus de pouvoir ?
Le devoir de réserve signifie donc simplement que tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles. Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics), mais leur mode d'expression et le lieu où il les exprime. L'ambigüité de cette notion est que son appréciation relève de la jurisprudence et ne figure pas en tant que telle dans la loi. Elle se définit donc dans les tribunaux et est le produit d’un rapport de forces.
Cette construction jurisprudentielle (voilà que je parle comme un juriste…) varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et forme de cette expression).
En clair, plus on a de responsabilités (chef d’établissement, IEN, Dasen…), plus ce devoir existe.
De même, la forme de l’expression est déterminante. Si des enseignants brûlent une effigie du président de la République ou tiennent des propos orduriers, il est possible qu'on leur reproche un manquement à leur obligation de réserve et qu'ils fassent l'objet de sanctions disciplinaires. On a vu aussi que le jet de crème Chantilly à destination d’un candidat ministre pouvait conduire devant les tribunaux. En revanche, on ne devrait pas leur reprocher d'avoir simplement participé à une manifestation en dehors de leurs fonctions.
On évitera aussi de s’exprimer sur son temps de travail. Par exemple, recevoir un journaliste sur le temps scolaire est soumis à autorisation (IEN, chef d’établissement). Mais un enseignant peut très bien manifester devant l’école, dans la commune où a lieu la fermeture d’une classe. De même, si vous devez éviter de parler "en tant qu’enseignant…" (et en même temps vous n'allez pas cacher votre profession...), vous avez toute latitude pour vous exprimer comme citoyen, d’être interviewé ou de participer à une réunion électorale. Et, bien sûr, d’être candidat !
***
Les limites sont quelquefois floues mais être fonctionnaire ne signifie pas abolir toute pensée critique et être dans la soumission, malgré ce que certains membres de la hiérarchie voudraient croire. Derrière l’invocation excessive du “devoir de réserve”, il y a bien souvent des enjeux de pouvoir et du marquage de territoire...
C’est un épouvantail qui ne doit pas empêcher la vie démocratique, dans les urnes ou dans la rue.
(et bon courage à ceux qui se présentent aux municipales…)
Philippe Watrelot, le 24 aout 2025

PS : je n’ai pas traité dans ce billet de l’expression sur les réseaux sociaux qui mérite un billet spécifique. On pourra se reporter à un vieux billet de blog de 2017 intitulé « Faut-il avoir un pseudonyme pour s’exprimer sur l’éducation ?»