
Agrandissement : Illustration 1

Tous les vestiges enfouis sous les différentes couches des artefacts des civilisations postérieures sont souvent les non dits de l'histoire officielle écrite par les vainqueurs.
Ces non-dits prêtent le flanc à des mythologisations et à des refoulés.
Les archéologues français du XIXème siècle, en pointe pour la création de leur discipline se sont intéressés prioritairement aux cultures qui avaient été glorifiées par les historiens et les philosophes comme les fondements de la civilisation occidentale et européenne. L'école française d'Athènes a été créée en 1846 et les recherches archéologiques françaises ont d'abord été effectuées en Grèce. Parallèlement l'intérêt s'est porté sur toutes les grandes civilisations répertoriées par les historiens : Rome, Etrurie, Egypte, Assyrie, Mesopotamie.
Toutes ces découvertes sont venues enrichir progressivement les collections du Musée du Louvre. Les lettrés français ne reconnaissaient que la culture gréco latine comme fondement de la civilisation et ils reprenaient le terme d'indigènes pour les populations celtes décrites par les Phocéens venus créer un comptoir marchand à l'emplacement de l'actuelle ville de Marseille.
Longtemps, l'archéologie sur le territoire français a été négligée. Les populations l'ayant occupé dans l'antiquité avaient été qualifiées de « barbares » par les Grecs comme tous ceux qui ne parlaient pas leur langue et Jules César, lors de sa conquête, imposa son découpage du continent européen et sa qualification des peuples en fonction de ses objectifs militaires. Les Gaulois étaient à l'Ouest du Rhin et les Germains à l'Est. En vainqueur, il ignora l'occupation celte de la moitié de l'Allemagne actuelle puis organisa la destruction de la culture celte de ses vaincus.
A partir de la défaite de Vercingétorix à la tête d'une coalition de peuples celtes, les différents régimes qui se sont succédé sur le territoire de l'actuelle France ont cherché des ancêtres conformes à la gloire de leur pays. Ce fut d'abord des Troyens dont Francion échappés de la ville assiégée par les Grecs (encore une défaite) puis Napoléon III reprit la version de César. Il voulait stimuler le sentiment nationaliste des Français en exhibant un héros et en glorifiant des guerriers plus farouches que les Germains. Il ordonna les premières fouilles systématiques des sites des batailles contre les Romains. Les archéologues trouvèrent des vestiges qui furent présentés dans le musée des Antiquités nationales à Saint Germain en Laye créé à cet effet. Il imposa la formule reprise par les historiens et diffusée dans les manuels et les classes de tout l'empire français : « Nos ancêtres les Gaulois ».
Sa construction de l'histoire et sa volonté de mettre ses pas dans ceux de son oncle entraîna la France dans la défaite contre la Prusse aux conséquences désastreuses dans le siècle suivant.
Au de là des victoires militaires, comme celle de Brennus, le chef celte des Sénons, le peuple ayant occupé le Loiret et l'Yonne dans l'antiquité, qui a vaincu les Romains et occupé leur capitale en 387 avant Jésus Christ et celle de Gergovie aussi contre les Romains en 57 avant Jésus Christ, et des nombreuses défaites des peuples ayant occupé l'actuelle France, il s'agit aujourd'hui de s'intéresser au palimpseste de toutes leurs cultures.

C'est nécessaire pour honorer la mémoire de ces peuples qui malgré la longue occupation romaine, durant cinq siècles ont su maintenir leur culture, comme en témoigne leur volonté au quatrième siècle après Jésus Christ d'abandonner le nom de Lutetia imposé par les occupants romains au profit de Paris, issu de l'appellation du peuple celte des Parisii ayant vécu, sans doute plus de mille ans dans cette région et la volonté de la confrérie des Nautes, les bateliers de la Seine de revendiquer leurs dieux celtes qu'ils ont sculpté sur la moitié du pilier des Nautes, trouvé en 1711 lors de la construction de la crypte de Notre Dame sur l'île de la Cité (aujourd'hui visible au musée de Cluny).
Il n'est plus possible que Paris reste une des rares capitales à tourner le dos à son archéologie locale.
Grâce au travail effectué depuis une trentaine d'années par les archéologues qui ont exploré le sous sol français, la plupart du temps dans le cadre de l'archéologie préventive imposée par la loi de 2001 lors des opérations immobilières et d'infrastructures, TGV et autoroutes, une multitude de vestiges ont été trouvés et des analyses ont été effectuées permettant de renouveler complètement l'histoire de l'antiquité locale et de montrer la richesse des productions et de l'art de ces peuples. Ces découvertes sont présentées dans les musées régionaux sur les lieux des fouilles, mais faute de place pour des expositions temporaires au musée de Saint Germain en Laye n'ont pour la plupart jamais été visibles en région parisienne. Ce nouveau centre devrait aussi accueillir des pièces venant des autres pays européens pour illustrer les proximités culturelles qui existaient dans l'antiquité.
Sur le modèle de la science construite à partir des lois universelles de la nature, l'Occident, l'Europe et en particulier la France ont cherché à imposer des principes universels au détriment parfois des singularités culturelles. François Jullien, philosophe helléniste et sinologue nous invite pourtant à respecter les différentes cultures et d'exploiter ces ressources pour être capable de construire un commun adapté à nos défis contemporains.
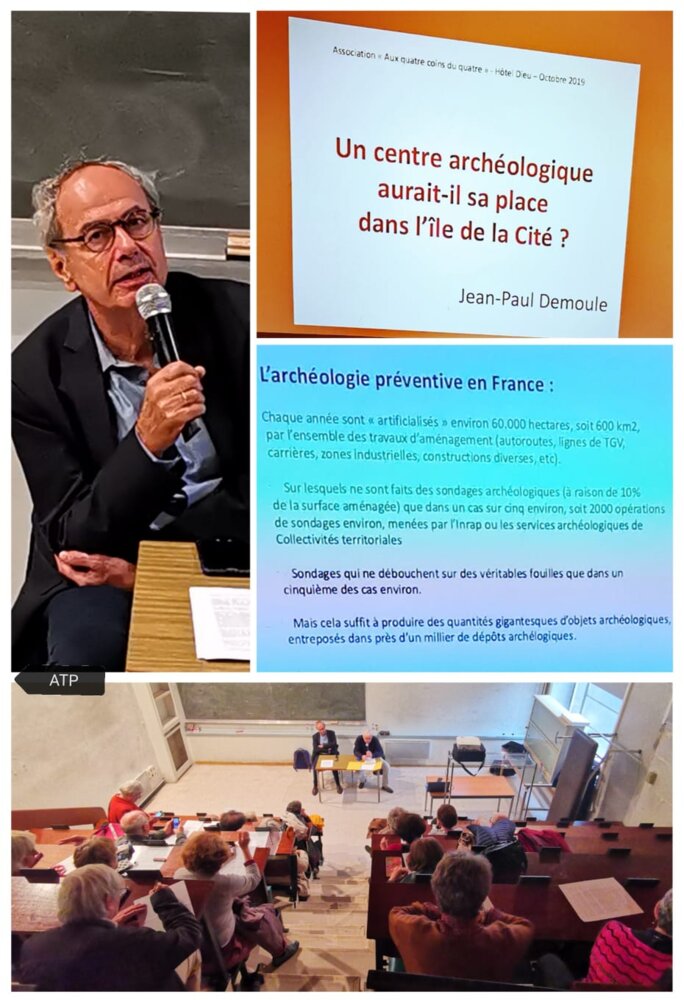
Agrandissement : Illustration 3
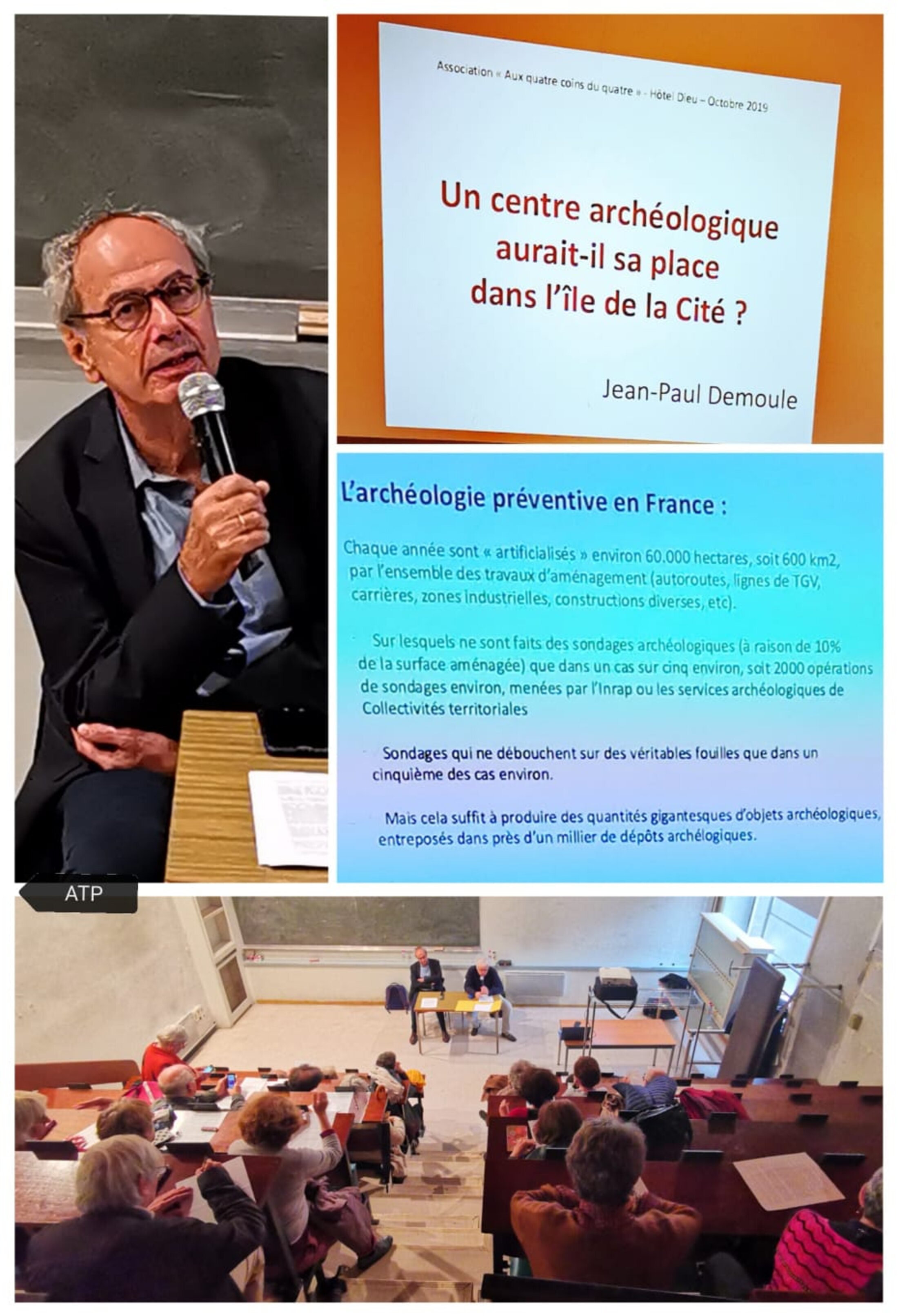
Une réunion organisée avec l'association "4 coins du 4" s'est tenue à l'Hôtel-Dieu le 8 Octobre 2019.
Intégralité de la Tribune parue dans le Monde du 16 Octobre
« La création d’un centre d’interprétation archéologique s’impose dans l’île de la Cité »
Puisque des espaces administratifs considérables se libèrent dans le cœur historique de Paris, il faut saisir cette opportunité pour y créer un musée archéologique d’ampleur, déclare, dans une tribune au « Monde », un collectif de scientifiques et d’intellectuels.
A l’heure où s’expriment de diverses façons des angoisses identitaires quant à la France comme nation, mais aussi quant à l’Europe comme destin collectif, il est temps de remettre au centre la réalité de nos connaissances scientifiques, historiques et archéologiques sur notre passé commun. Il est temps de penser ce passé dans toutes ses composantes, dans ses constantes interactions avec les autres cultures et avec l’environnement. Non plus la recherche d’« ancêtres » génétiques, mais la mise en évidence d’une histoire globale, complexe, et en constante transformation.
En effet, les découvertes archéologiques de ces trente dernières années sur notre territoire ont totalement transformé nos perspectives sur les sociétés qui s’y sont succédé, depuis la préhistoire la plus lointaine jusqu’au Moyen Age et au-delà.
Des besoins criants
Pourtant, aucun espace à la mesure de cette perspective n’est aujourd’hui disponible dans le centre de Paris pour rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. Malgré un nouveau projet de restructuration qui met en évidence ses besoins criants, le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ne peut ni tenir compte de la masse d’informations et d’objets nouveaux issus de l’essor de l’archéologie préventive de ces trente dernières années, ni organiser des expositions d’ampleur internationale, à la fois par manque de place et d’équipement performant, et pour des raisons budgétaires. Comme l’a encore réaffirmé un récent rapport de la Cour des comptes, son niveau de fréquentation particulièrement faible, malgré la qualité des collections et les efforts de ses personnels, montre que la localisation est un facteur déterminant. Il accueille autour de 100 000 visiteurs par an, dont 6,5 % d’étrangers, moins que le Musée de La Poste à Paris, trois fois moins que le Musée archéologique d’Arles – tandis que le Musée du Louvre accueille 10,2 millions de visiteurs, dont 71 % d’étrangers, et celui du quai Branly 1 million, dont 20 % d’étrangers.
Sans remettre en question l’existence de ce musée tel qu’il est situé et organisé, la localisation, au centre de la capitale, d’un espace muséographique d’interprétation et de mise en valeur des acquis continus de la recherche archéologique semble d’autant plus s’imposer que des espaces considérables se libèrent actuellement dans l’île de la Cité, par transferts d’administrations sur de nouveaux sites. Dans ce cœur historique de la ville gallo-romaine puis médiévale, les études en cours sur l’utilisation de ces espaces libérés offrent une opportunité exceptionnelle pour intégrer un tel projet archéologique d’ampleur.
Une configuration présente dans maintes capitales, à commencer par Berlin
Ainsi serait créé, dans une proximité topographique, le cadre d’une réflexion historique triangulaire entre le passé des cultures méditerranéennes exposé au Louvre, celui des cultures extra-européennes du Musée du quai Branly et, sur ce nouveau site, le passé des cultures qui se sont succédé sur l’actuel territoire français, des origines à nos jours, dans leurs relations avec les autres sociétés, proches ou lointaines. C’est la configuration que présentent maintes capitales dans le monde, à commencer par Berlin.
Ce nouveau lieu pourrait ainsi offrir, comme une sorte d’ambassade du Musée d’archéologie nationale, à la fois une rétrospective permanente de ces cultures, à l’instar du pavillon des Sessions au Louvre pour les cultures extra-européennes ; mais aussi des expositions thématiques temporaires ambitieuses de niveau international, notamment sur le passé européen ; et enfin une vitrine tournante des fouilles archéologiques préventives, qui ne cessent de se succéder sur notre territoire sans pouvoir être exposées auprès de nos concitoyens dans des conditions qui soient à la mesure de l’importance des découvertes et des financements.
Exigences d’une approche citoyenne du passé
Ce lieu présenterait des objets réels dans leur contexte, tout en recourant à la variété muséographique et scénographique que permettent désormais les reconstitutions en 3D et en réalité virtuelle, ainsi que les ressources des outils pédagogiques modernes. Il offrirait aussi des espaces d’enseignement pour les différents types de visiteurs, tout comme des conférences et des colloques. Il n’en déposséderait pas pour autant les musées régionaux, avec lesquels des réseaux permanents devraient être tissés, mais il en valoriserait au contraire les collections, en organisant ces expositions tournantes. Ainsi serait pallié en partie le décalage entre l’explosion des découvertes et des connaissances, et leur très faible répercussion dans les musées français actuels, source d’une vision dépassée des acquis de la discipline et, plus grave, d’interprétations historiques obsolètes.
Ainsi pourrait être présenté de manière spectaculaire et lisible l’état de nos connaissances sur la longue histoire de notre territoire, ce lieu d’accueil permanent et continu de populations fort diverses sans cesse refondues en un même ensemble. Il s’agit là d’un projet culturel et pédagogique qui répondrait aux exigences d’une approche citoyenne du passé.
Premiers signataires : Yves Coppens, professeur honoraire au Collège de France, Académie des sciences ; Jean-Paul Demoule, professeur émérite à Paris-I, ancien président de l’Inrap ; François Gèze, éditeur ; Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France, Académie des inscriptions et belles-lettres ; Olivier Mongin, écrivain ; Nicole Pot, ancienne directrice générale de l’Inrap, inspectrice générale honoraire au ministère de la culture ; John Scheid, historien, professeur au Collège de France, Académie des inscriptions et belles-lettres ; Alain Schnapp, professeur émérite à Paris-I, ancien directeur général de l’INHA ; Bernard Stiegler, philosophe, directeur du développement culturel au Centre Pompidou.



