
La pêche pourra-t-elle compenser dans nos assiettes les pertes de production du secteur agricole ou faut-il s'attendre à la même évolution des ressources alimentaires octroyées par la mer ? Tel est le sens de la question posée par Audrey Boehly à l'océanologue Philippe Cury, son invité d'aujourd'hui.
Les données fournies par celui-ci ne sont guère encourageantes : la consommation mondiale de poisson est en augmentation constante, de 6 à 9 kilos par habitant et par an en 1950 pour 3 milliards de terriens à 21 kilos aujourd'hui pour une population qui avoisine les 10 milliards. Pour satisfaire cette demande, la pêche industrielle, pratiquée par de très grosses unités, maintient une pression croissante sur la ressource, à grand
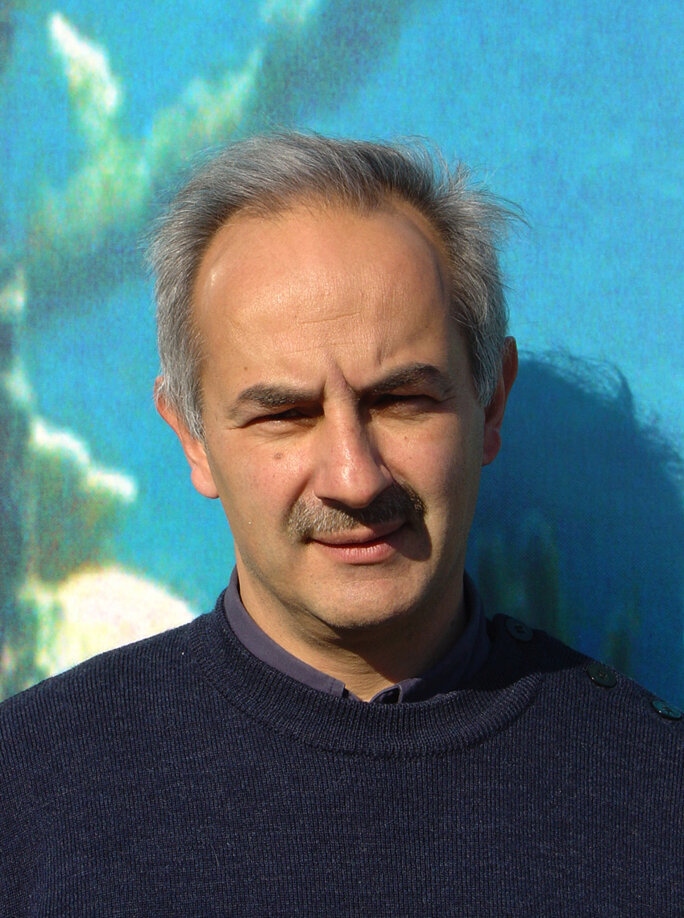
Agrandissement : Illustration 2

renfort de moyens technologiques (GPS, radars ou sonars, filets plus résistants), qui permettent de ramener dans les filets toujours plus de poisson, toujours plus vite, toujours plus profond, avec des outils de pêche qui détruisent les habitats marins, comme les chaluts qui raclent les fonds. Entre les années 50 et les années 90, la quantité de poisson pêché à progressé de 25 millions de tonnes par an dans les années 50, à 100 millions de tonnes, dans les années 90, avant de connaître aujourd'hui une perte de un million de tonnes par an. La Méditerranée abrite environ 500 espèces de poissons et 10% de ces espèces sont menacées d'extinction. Ces données doivent être interprétées comme les symptômes d'une diminution de la ressource liée à la surpêche.
Un autre signal de la surexploitation de nos côtes est la provenance du poisson que l'on retrouve sur nos étals : 90% proviennent d'autres pays qui, à leur tour, sont surexploités. Philippe Cury fait état de son expérience africaine : au Sénégal et en Guinée, la pêche, totalement artisanale, est assurée par une flottille de pirogues, dont les principales prises étaient constituées de thiof, une variété de mérou blanc. Dans les années 80, 3000 pirogues ramenaient annuellement 3000 à 5000 tonnes de thiof. Aujourd'hui, le nombre de pirogues a décuplé, mais n'en ramène plus que 50 tonnes. La surexploitation a donc, là aussi, fait ses ravages. Et ces 50 tonnes partent sur les marchés extérieurs, de même que la production de sardinelles qui a remplacé le mérou, sous forme de farine de poisson destinée à l'alimentation animale. La surpèche a aussi un effet direct sur l'équilibre entre les espèces : ainsi en Namibie où dix millions de tonnes de sardines ont été retirées de la mer, entrainant non seulement le déclin des populations d'oiseaux et de mammifères marins qui s'en nourrissaient, mais aussi l'explosion de deux espèces de méduses. La prolifération incontrôlée de certaines espèces (sur les côtes françaises les poulpes) est donc le signe d'un chamboulement de l'écosystème.
Mais la surpêche n'est pas seule en cause : sous l'effet du changement climatique, les océans se réchauffent, provoquant une migration des poissons en direction des latitudes plus élevées. Si on reprend l'exemple du Sénégal, ce phénomène contribue aussi à la raréfaction des espèces et aux problèmes colossaux de sécurité alimentaire qu'il entraine. Ce réchauffement de l'eau, ainsi qu'une augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique, contribuent respectivement à une diminution de la teneur en oxygène des eaux et à une acidification des océans. Les déséquilibres écologiques provoqués par ces modifications chimiques sont considérables : La taille des poissons diminue, comme cela a été observé sur la population de sardines en Méditerranée, qui souffrent d'une sous-alimentation chronique due à la modification qualitative et quantitative des mollusques et des planctons dont elles se nourrissent ; Sous l'effet des pics de chaleur subis par les coraux, 15 à 20% d'entre eux ont déjà disparu et les autres sont en voie d'extinction. Cette surmortalité des coraux entraine une disparition de l'habitat de nombreuses espèces.
Il y a aussi la pollution : l'espace marin est une véritable poubelle, dans laquelle arrivent tôt ou tard toutes sortes de polluants répandus à terre (hydrocarbures, produits chimiques, déchets plastiques). A côté du "continent plastique" du pacifique, plusieurs fois grand comme la France, il y a le problème des microplastiques - insidieux parce que moins visible - qui affecte le plancton et les populations de tortues et de mammifères marins. Et il faudra bien se décider un jour - et le plus tôt sera le mieux, à proscrire l'usage des emballages et contenants plastiques.
Ce sont donc ces trois facteurs - surpêche, réchauffement climatique, pollution - qui se synchronisent pour créer une détérioration profonde des écosystèmes marins, cumulant leurs effets et créant des boucles de rétroaction positive. Réversible ou non ? questionne la journaliste. Faiblement réversible, répond l'océanologue et sur des temps extrêmement longs. On a pourtant l'exemple du thon rouge en Méditerranée, où la mise en place et le respect des quotas de pêche ont permis la reconstitution des stocks en l'espace de trois ans. Une bonne gestion, basée sur une estimation exacte des stocks marins et une adaptation réactive des quantités autorisées à la pêche permet donc de reconstituer rapidement la ressource. Il est essentiel de préserver les stocks marins, car l'élevage piscicole ne peut en aucun cas se substituer à la pêche en mer : sur le marché européen, contrairement à l'Asie, la part des poissons d'élevage reste très faible. Mais, surtout, cette activité piscicole vient en concurrence avec la pêche plutôt qu'elle ne compense ses manques : les élevages sont nourris à base de farine d'anchois, de sardines, de maquereaux, de harengs et leur transformation, plutôt que leur utilisation directe pour l'alimentation, constitue une grosse perte énergétique.
La conclusion de l'entretien porte sur la solution formulée par Philippe Cury : "Une pèche durable qui respecte les écosystèmes". En définition de ce concept, l'océanologue livre quelques pistes concrètes : revenir à une pêche artisanale en proscrivant les grosses unités qui se livrent à la pêche industrielle et réorienter les 35 milliards d'euros de subventions au niveau mondial pour créer une vraie dynamique locale ; revenir à des outils de pêche qui ne soient pas destructeurs des habitats marins ; gérer la ressource marine à l'exemple de ce qui a été décrit plus haut concernant le succès dans la préservation du thon rouge. On pourrait s'inspirer de "l'approche écosystémique" mise en place en Afrique du Sud : considérer la ressource comme commune à tout l'écosystème et la gérer en conséquence, c'est-à-dire renoncer au productivisme au profit de la préservation de l'environnement. Un exemple concret cité par Philippe Cury est la gestion de la pêche sardinière, qui doit laisser dans la mer la quantité nécessaire pour que tous ses prédateurs (oiseaux, mammifères marins) puissent se nourrir. Nous avons tous les outils et les données scientifiques pour pouvoir gérer cette ressource de façon à préserver l'écosystème.
Le podcast se termine donc sur une note optimiste, qu'il convient pourtant, à titre personnel, de tempérer : l'exploitation minière des océans, qui n'est mentionnée que furtivement dans le podcast lorsque la question de l'utilité des réserves marines est évoquée, n'a pas été écartée par le "One Ocean Summit", cette mascarade écoblanchissante qui s'est tenue à Brest il y a quelques semaines. Il n'y a pas besoin d'être océanologue pour comprendre les dégâts environnementaux que pourrait provoquer le raclage du fond des océans. Et cette pratique anéantirait tous les efforts de gestion des océans que peuvent proposer les experts.
Lien vers le podcast : https://podcasts-francais.fr/podcast/dernieres-limites
Pour en savoir plus :




