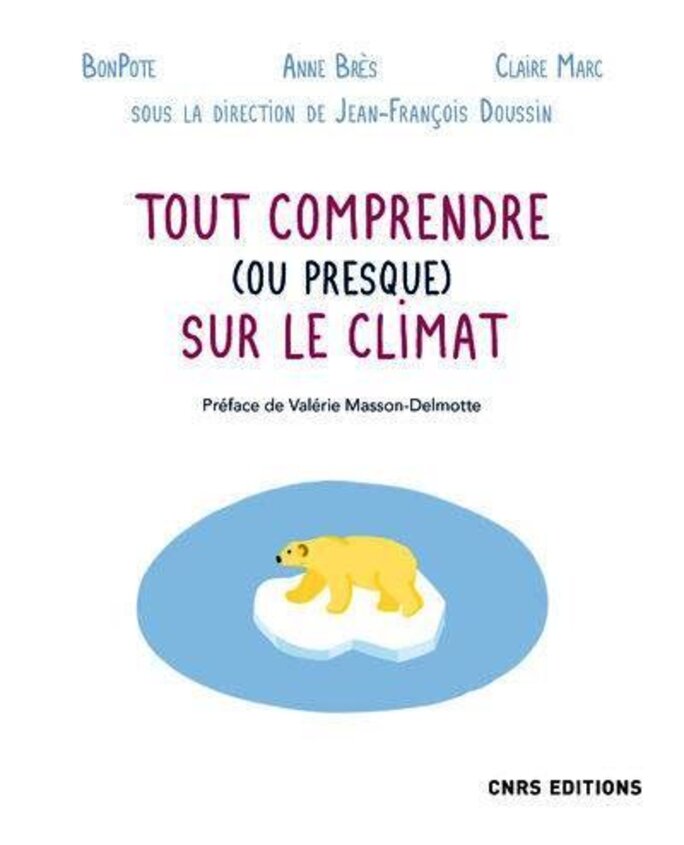C'est à ce moment qu'Audrey dit avoir pris conscience que le corps humain n'est pas adapté à de telles températures et pourtant, dit-elle, nous nous dirigeons en France dans les décennies à venir vers des chaleurs record avec des pics dépassant les 50°C. Ces températures extrêmes sévissent déjà dans certains pays d'Asie, rendant peu à peu ces contrées inhabitables. Pendant le dernier été austral, les records de température se sont succédés en Argentine, Afrique du Sud et en Australie , alors qu'à la même époque, il faisait plus chaud au Groënland qu'à Paris. L'enjeu climatique est une question de survie : d'abord de survie de l'espèce sur une terre qui doit demeurer habitable, mais également, comme il est mentionné plus loin dans le Podcast, de survie des civilisations, dont le développement sur une période extrêmement courte de l'histoire humaine n'a été rendu possible qu'en raison d'une stabilité climatique exceptionnelle, qui a favorisé, entre autres, le développement des activités agricoles.

C'est cet état des lieux que dresse Audrey Boehly en préliminaire de son entretien avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherches au CEA et coprésidente du GIEC, pour laquelle il faut voir dans cette succession de vagues de chaleur terrestres aussi bien que maritimes, chaque année plus intenses, plus fréquentes et plus généralisées, le signe d'une augmentation générale de la température à la surface du globe : par rapport à la période de référence (1850-1900), l'augmentation moyenne de température sur les 10 dernières années est de 1,1°C et chacune des quatre dernières décennies a été plus chaude que la précédente. Après une fin d'année 2020 marquée par la tempête Alex, les épisodes climatiques se sont succédés à un rythme accru en 2021 : inondations en Chine, en Inde et en Allemagne, ouragan aux États-Unis, dôme de chaleur sur l'ouest canadien, incendies de forêt, etc.
Il faut remonter cent vingt mille ans en arrière pour trouver une période aussi chaude que l'actuelle. Selon les rapports du GIEC (voir encadré), il ne fait aucun doute que c'est exclusivement l'activité humaine qui est à l'origine du réchauffement actuel par émission des gaz à effet de serre (GES) qui séquestrent la chaleur dans l'atmosphère terrestre. Parmi les GES définis par le protocole de Kyoto, la climatologue en distingue trois : le dioxyde de carbone (CO2) est le plus gros contributeur au réchauffement climatique. Son accumulation est d'origine exclusivement humaine, liée à la combustion d'énergies fossiles et à la destruction des "poumons" forestiers et marins qui ont pour fonction de le capter. Les 40 milliards de tonnes rejetées chaque année dans l'atmosphère dépassent pour moitié les capacités d'absorption des forêts et des océans, le CO2 résiduel aura un effet sur le climat pendant plus de 1000 ans. Le protoxyde d'azote est également un puissant facteur du réchauffement climatique, avec une durée de vie supérieure à celle du CO2. Le méthane (CH4) a une durée de vie beaucoup plus courte (12 ans), mais un effet d'accumulation de chaleur très important. Ces deux GES sont respectivement liés à des fuites dans les exploitations pétrolières ainsi qu'à l'élevage de ruminants pour le CH4 et à la dégradation de substances azotées (engrais, lisier) d'origine agricole pour le N2O.
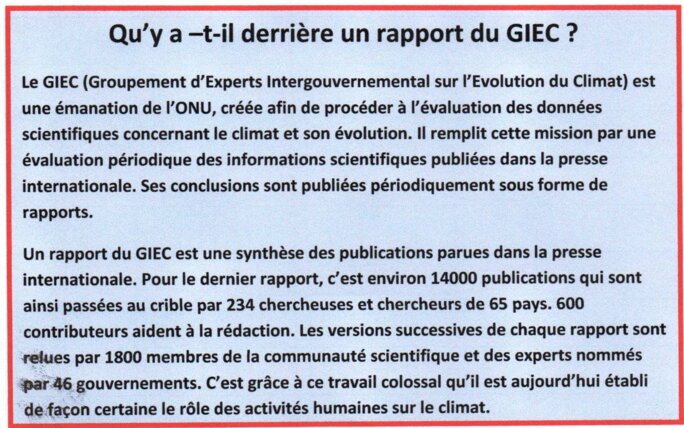
Agrandissement : Illustration 3
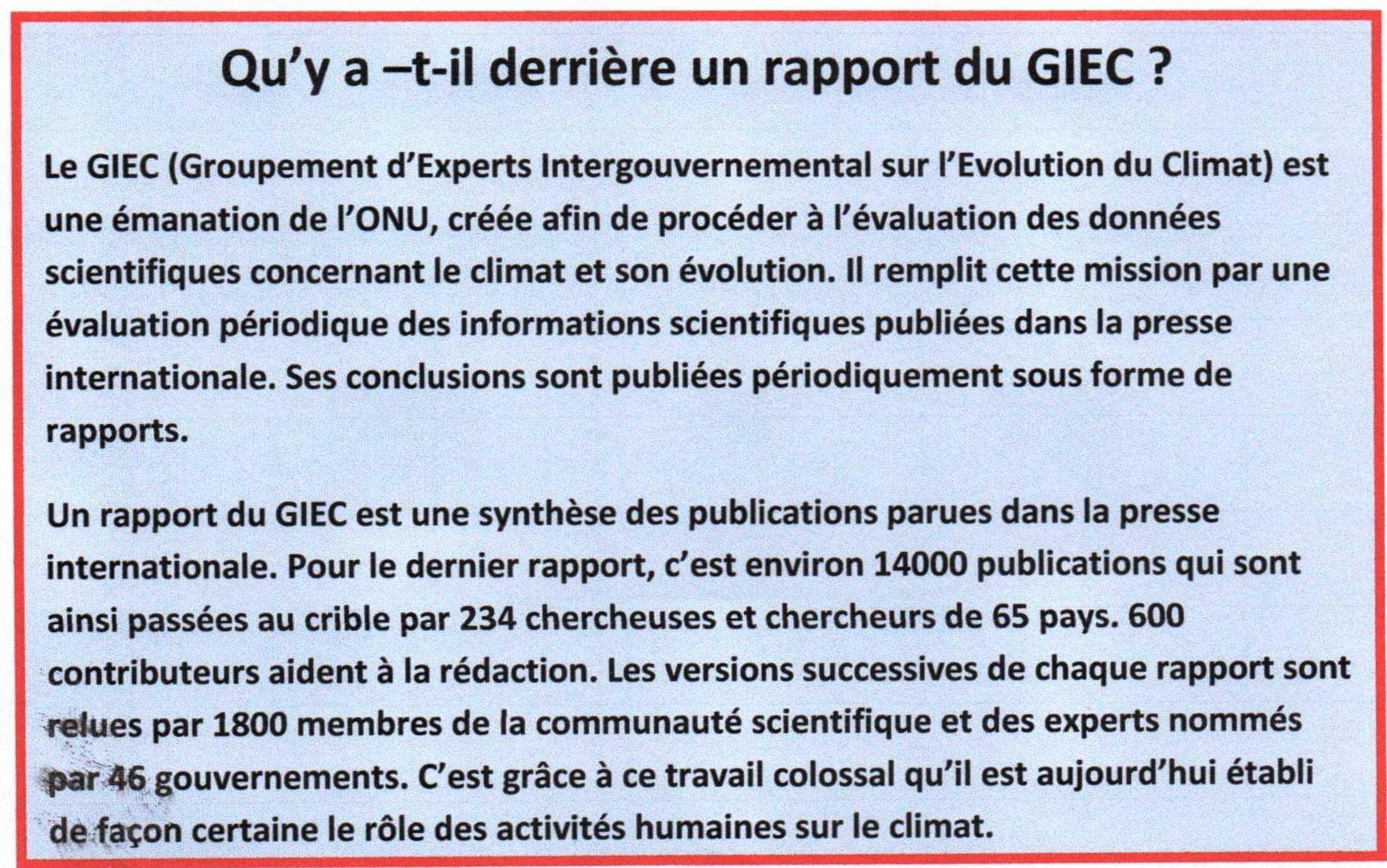
L'accord de Paris a fixé à 1,5°C l'augmentation de température vers laquelle il faut tendre, avec l'objectif de ne pas dépasser les deux degrés. Cette différence de 0,5°C est-elle si importante pour le climat ? questionne Audrey. Oui, répond Valérie Masson-Delmotte, car il ne faut pas confondre un aléa météorologique de peu de conséquences avec une tendance de fond : au cours du réchauffement climatique qui a succédé à la dernière ère glaciaire, la terre s'est réchauffée de 5°C, mais l'augmentation des températures a été graduelle, d'un degré par millénaire. Le réchauffement actuel est beaucoup plus accéléré et affecte de façon beaucoup plus prononcé les continents, provoquant les vagues de chaleurs très intenses et très humides qui, comme Audrey l'a elle-même expérimenté, approchent les limites de la résilience humaine et même la dépassent dans certains pays. Et les engagements de la COP26 qui a eu lieu récemment sont en décalage complet avec ceux de la COP21, car ils devraient conduire à un dépassement approchant les 3°C. Aussi la journaliste demande-t-elle à quoi ressemblera un monde plus chaud de 3°C. Ce sera, répond la scientifique, un monde de crises démultipliées par rapport à la situation actuelle :
- Les sécheresses prolongées, atteindront simultanément plusieurs régions agricoles, rendant ingérables les pénuries alimentaires. En France, il ne sera plus possible de produire du vin dans le sud et de faire pousser du blé au dessous de la Loire. La baisse de la production agricole est évaluée à -25%.
- La montée des océans, aujourd'hui évaluée à 3,7 mm par an, s'est accélérée depuis 1990 du fait de la fonte accrue des glaces du Groënland et des glissements plus rapides dans l'Antarctique. Une montée des niveaux maritimes d'au moins un mètre est aujourd'hui considérée par les scientifiques comme inévitable, engloutissant de grandes villes portuaires, des deltas agricoles (Mékong cité par Audrey, mais aussi Camargue et delta du Nil) et des états insulaires. Au total ce sera 65 millions de personnes qui seront concernées, dont deux millions en France (un des pays d'Europe les plus menacés en raison de son importante façade maritime) d'ici la fin du siècle.
D'autres facteurs d'aggravation pourraient provoquer un basculement irréversible du climat : ce sont les "points de bascule" mentionnés par la journaliste, qui demande à la climatologue de les détailler.
- A côté des glissements de l'Antarctique déjà mentionnés, il y a les altérations des courants marins, le "tapis roulant" des courants chauds de l'Atlantique qui réchauffe les eaux du Nord avant de revenir par une "boucle de retour" en profondeur. D'après les scientifiques, le ralentissement du Gulf Stream est déjà amorcé.
- Les sols gelés de l'Arctique canadien et de Sibérie subissent actuellement une fonte accélérée avec un important danger potentiel : la libération des gaz à effet de serre séquestrés dans les sols. Cette éventualité est d'autant plus dangereuse que, n'entrant pas dans les prévisions actuelles, sa prise en compte aggraverait les perspectives.
- Déjà évoquée dans un épisode précédent, la bascule de l'écosystème amazonien qui pourrait devenir une savane.
Après avoir brossé un rapide tableau de ce qu'était la terre au moment de la précédente glaciation (voir encadré), la conversation s'oriente vers
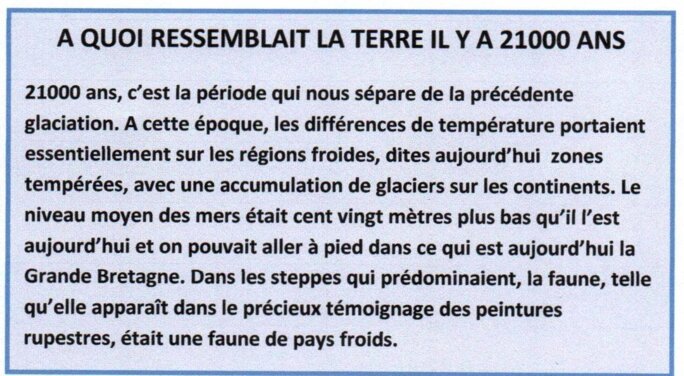
Agrandissement : Illustration 4
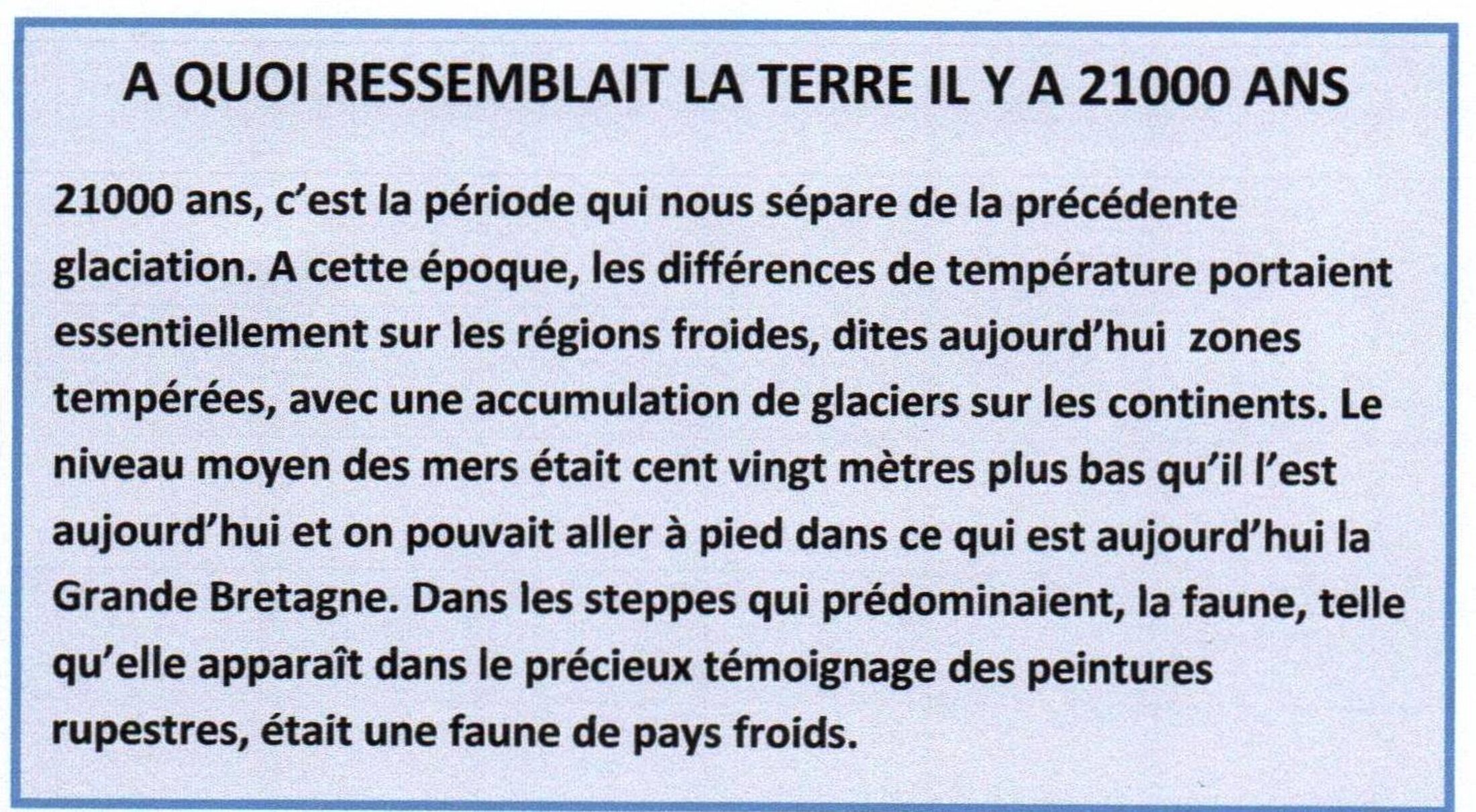
les conséquences économiques et sociales des bouleversements en cours, avec en préambule une déclaration de Georges Bush Jr ("notre mode de vie n'est pas négociable") qui, à elle seule, montre la surdité totale des dirigeants politiques aux avertissements des scientifiques et le déni de l'incapacité à maintenir notre mode de vie à +3, +4 ou +5°C. Mais on ne préserve pas l'american way of life en refusant de discuter sur ses conséquences, car ce sont les fondations même de nos sociétés démocratiques qui sont menacées : que vaudront les libertés dont nous aimons à nous prévaloir en face d'un coût croissant des pertes et des dommages, d'un mode de vie contraint par la baisse de production agricole et la disparition rapide des ressources renouvelables ou non ? Il en est de même pour le patrimoine culturel, sans lequel un homme n'est plus rien et c'est ce qui arrivera le jour ou la forêt de Brocéliande brûlera, où la Mer de Glace, déjà très mal en point, aura complètement fondu et où on parlera de La Rochelle et Saint-Jean-de-Luz comme aujourd'hui de la ville d'Ys. Aussi la neutralité carbone doit-elle être considérée comme un impératif incontournable, mais encore faut-il s'entendre sur la signification de ce terme : elle doit inclure tous les gaz à effet de serre et ne pas se limiter à un statu quo atteint en 2050. Pour préserver le climat, il faut aussi pouvoir éliminer de façon durable les GES qui se sont accumulés dans l'atmosphère pendant les décennies qui auront précédé, et aussi se souvenir que les plus faciles à neutraliser sont ceux qui n'ont pas été émis.
En une phrase, cette course de vitesse contre le réchauffement climatique passe d'abord par une réduction maximale des émissions bien avant 2050 tout en compensant par une captation par les puits de carbone celles qu'on ne pourra pas empêcher. Ce sont ces deux types d'action, réduction et compensation, qui sont les piliers de la lutte contre le réchauffement climatique.
Le premier de ces piliers concerne la limitation des émissions. Pour éviter d'obtenir ce résultat par une diminution de l'activité, les entreprises privilégieront les moyens technologiques permettant de réduire les émissions à la source, comme, dans le domaine des transports, l'amélioration des performances énergétiques des moteurs d'avion et de voitures. Mais la mise en avant de ces moyens technologiques deviennent trop souvent des raisons pour temporiser alors que la situation réclame des mesures d'urgence. Mais la logique productiviste du modèle économique a effacé les bénéfices environnementaux qu'on pouvait en attendre, par une augmentation de la demande de voyages pour le secteur aérien et par l'explosion des ventes de SUV pour l'automobile. Et la mise en avant de ces solutions techniques deviennent trop souvent des prétextes pour temporiser alors que la situation réclame des mesures d'urgence.
Il en est ainsi pour la captation du carbone en sortie d'usine, à des fins de stockage dans des roches poreuses. Cela ne peut concerner que des sources d'émission massives et concentrées comme les centrales à charbon, les cimenteries ou les industries lourdes, car il est impossible de capter le carbone à la sortie de chaque pot d'échappement. Si de telles procédés sont actuellement en cours d'expérimentation en Islande, il semble impossible de construire suffisamment de ces équipements dans le but d'une extraction massive. Selon la spécialiste, cette technologie n'aura donc qu'une application extrêmement limitée et ne doit pas être considérée comme une solution d'avenir qui permettrait aux industries les plus polluantes de reporter à demain l'effort qu'elles pourraient faire aujourd'hui.
La compensation est également une approche qu'il ne faut pas négliger, mais il faut se rappeler qu'elle passe d'abord par la préservation des puits de carbone naturels, comme les forêts et les zones humides. Sans ce préalable, les tentatives de reconstitution forestières prônées par Total ou Air France sont dérisoires : on ne remplace pas une forêt native par des plantations dont on ne sait si elles ne seront pas soumises à une mortalité précoce en raison des sécheresses ou des incendies répétitifs de forêts. Ces tentatives de donner bonne conscience aux utilisateurs par l'achat de quelques arbres relève de l'écoblanchiment et non d'une politique structurée pour lutter contre le réchauffement.
Dans tout le bruit de fond des "solutions" évoquées, il y a la géo-ingénieurie qu'Audrey n'évoque que pour la qualifier de "méthodes d'apprentis sorciers". Il est en effet insensé de préconiser l'envoi de particules dans la haute atmosphère pour masquer les rayons solaires ou l'augmentation de la teneur en fer des océans pour stimuler le phytoplancton sans une connaissance précise des conséquences environnementales de ces bricolages. La spécialiste confirme que ces propositions ne reçoivent aucunement la caution de la communauté scientifique et ne servent qu'à détourner l'attention de l'urgence des mesures à prendre.
Car il y a urgence : les objectifs de la COP21 ne sont atteignables que si la réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 est de 45% par rapport au niveau de 2010. Il serait inexact de penser que l'objectif de neutralité carbone pour 2050 nous laisse encore 28 ans : les options prises maintenant sur l'acquisition d'équipements figent les émissions de CO2 correspondantes pour la durée de vie de ces équipements. C'est donc dès maintenant que les politiques publiques doivent se projeter dans l'avenir et s'orienter en pensant au long terme. En premier lieu, le dernier rapport du GIEC dit très clairement que pour atteindre les objectifs, il faut, dès maintenant, arrêter l'exploitation des énergies fossiles, mais les banques françaises sont un gros investisseur dans ce secteur, ce qui leur donne une empreinte carbone globale de huit fois celle de notre pays. Ce n'est donc pas parce que la France est un petit pays en termes de population qu'il faut se dire que nos efforts ne seraient qu'une goutte d'eau dans l'océan et refuser la responsabilité qui est la nôtre : les français, avec leurs 1000 tonnes de CO2 émis par habitant et par an, sont parmi les plus gros contributeurs de ces émissions qui menacent en premier lieu les populations les moins émettrices, auxquelles la COP26 a pourtant refusé l'aide des pays les plus riches.
C'est une révision complète de nos modes de pensée qu'il faut mettre en œuvre : les solutions technologiques doivent être examinées à l'aune de leur faisabilité : à titre d'exemple, il serait tentant de miser sur le fait que le véhicule électrique réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Mais le rapport Meadows est là pour nous rappeler que la ressource en matières premières entrant dans la composition des batteries est limitée et que l'option d'un parc automobile 100% électrique aboutirait à une impasse, ce qui la fait qualifier d'irréaliste par Audrey. La limitation des ressources impose une "mobilité active" limitant les déplacements énergivores au profit du vélo et des transports en commun. L’État, les collectivités locales et les particuliers doivent construire une alternative qui aboutisse à une diminution effective du coût énergétique des transports.
C'est une société au fonctionnement tout à fait différent qu'il s'agit de construire et les changements à envisager donnent le vertige : tourner le dos aux lobbies qui, trop souvent dictent les lois à l'encontre des recommandations citoyennes, comme cela a été le cas en ce qui concerne l'occasion manquée de la loi "climat et résilience". Soumettre les grands projets pharaoniques à une évaluation indépendante des bénéfices environnementaux et sociaux et les abandonner s'ils ne répondent pas à une grille incluant la nécessité de contenir les gaz à effet de serre et de préserver les écosystèmes. Prendre en considération les impératifs sociaux : car les troubles récents ont été trop souvent provoqués par un oubli des implications sociales des mesures ordonnées au sommet de l'état : il est trop facile d'instaurer une taxation du carburant visant principalement les populations en état de mobilité contrainte, rejetées à la périphérie des agglomérations urbaines et devant prendre leur voiture pour aller travailler, alors que les plus fortunés en majorité utilisateurs de l'aérien, bénéficient de l'absence de taxation sur le kérosène.
LIEN VERS LE PODCAST : https://podcasts-francais.fr/podcast/dernieres-limites
POUR ALLER PLUS LOIN