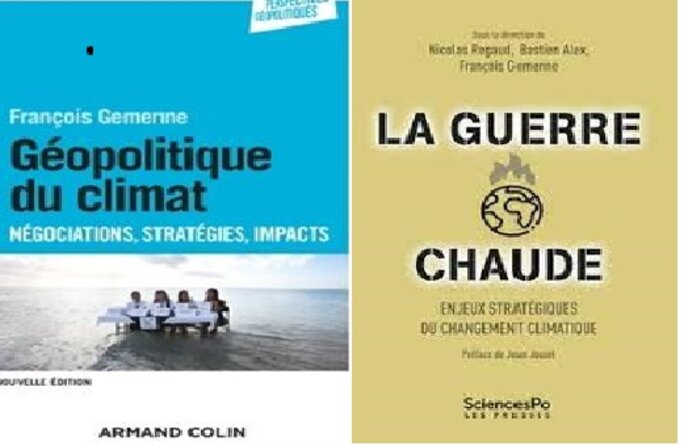La guerre en Ukraine, commente Audrey Boehly, est un signe avant-coureur de l'effet domino qu'engendrerait la multiplication des conflits. Si cette guerre est plutôt le fait d'un dictateur qui se prend pour Pierre le Grand, ses conséquences observées sur les approvisionnements en blé et en gaz n'en illustrent pas moins celles d'une multiplication de conflits ayant pour enjeu l'accès à une un plusieurs ressources naturelles. Le risque de guerre, déjà évoqué dans un épisode précédent par Mathieu Auzanneau, n'était pas pris en compte par le rapport Meadows de 1972 et sans cet épisode consacré aux implications géopolitiques de cette menace de pénuries grandissantes, il manquerait à ce podcast un élément essentiel. La journaliste a donc choisi pour interlocuteur François Gemenne, un spécialiste de géopolitique de l'environnement, collaborateur du GIEC et professeur dans plusieurs universités françaises et belge.

Le premier aspect de la question concerne les humains dont le pays deviendra invivable du fait de la montée des mers, de la chute des rendements agricoles, du manque d'accès à l'eau, de températures invivables pendant les mois chauds de l'année. Selon l'ONU, C'est un milliard de personnes qui auront été condamnées à une migration forcée en 2050 et il est douteux que les pays asiles, eux-même impactés par les changements climatiques, soient en mesure de gérer efficacement ces flux migratoires massifs.
Les migrations climatiques sont aussi vieilles que le monde et ont modelé la répartition mondiale des populations. Homo Sapiens a peuplé l'Europe en raison de son climat tempéré. Le spécialiste cite aussi l'exemple de la grande civilisation égyptienne, qui résulte d'une migration depuis un Sahara en voie de désertification vers la vallée fertile du Nil. L'Histoire révèle ainsi un grand nombre de cas de populations déplacées à la suite de catastrophes naturelles. Mais le droit international issu de la seconde guerre mondiale ne distingue que deux causes de migration : les réfugiés politiques qui fuient les violences et les persécutions bénéficient d'une reconnaissance définie par les conventions internationales alors que le statut des réfugiés économiques à la recherche d'une vie meilleure est laissé à la discrétion de chaque état. De nombreux cas, parmi ces derniers, justifieraient un classement en réfugiés climatiques, car ce sont les famines dues au réchauffement qui pousse les autochtones d'Afrique subsaharienne, vivant avec moins de un dollar par jour et dépendant entièrement de l'agriculture pour leur survie, à venir frapper à la porte de l'Europe. Mais s'il est possible d'évaluer le nombre de migrants lorsque le déplacement est du à des évènements brutaux, nous manquons de statistiques pour les migrations liées à des évènements progressifs, comme la montée des eaux ou la dégradation des sols. Il y a aussi les migrations internes qui constituent les 3/4 de l'ensemble, mais n'entrent pas dans les statistiques : ainsi, beaucoup d'habitants de la Roya ont quitté définitivement la vallée et un tiers des habitants de la Nouvelle Orléans ne sont jamais revenus après le passage de l'ouragan Katerina. Cette évaluation incomplète fait pourtant état de 30 millions de personnes déplacées pour évènements climatiques en 2020, soit trois fois plus que le nombre de réfugiés politiques. Le statut de réfugié climatique reste donc à inventer mais il est à craindre que cela ne se fasse pas sans des débats houleux et des oppositions tenaces, qui seront une menace pour la démocratie, sous forme d'alliance entre les survivalistes et les idéologies d'extrême droite.
Audrey rappelle les propos de Gaël Giraud dans le premier épisode de ce podcast : en Asie du Sud-Est et sur la côte indienne, de nombreux territoires deviennent, dès maintenant, inhabitables en raison des conditions de chaleur et d'humidité incompatibles avec la vie humaine. Cela signifie, selon François Gemenne, de très importantes migrations à venir et aussi une explosion de la mortalité des personnes n'ayant ni les moyens de s'informer, ni de ceux d'organiser leur propre migration. La vie de ces personnes est suspendue aux décisions très incertaines prises par les gouvernements, qui peuvent décider de les abandonner à leur sort ou d'appliquer une politique de déplacements, comme le fait le Vietnam dans le delta du Mékong menacé par les inondations et la montée du niveau de la mer.
Cette dernière menace pose une question primordiale : où allons-nous pouvoir habiter ? La montée des eaux marines sera, en effet, une question majeure, comme l'illustre l'exemple des côtes de la mer du Nord, incluant les Pays-Bas dont un bon tiers du territoire se trouve sous la menace de submersion. Selon les prévisions, les cartes de géographie vont être complètement redessinées et le territoire de certains pays insulaires (Maldives, Comorres, Tuvalu...) va complètement disparaître. Ce qui, au delà du drame humain que représente pour ces populations la perte de leurs racines territoriales et culturelles, pose la question de l'accueil par des états qui auront aussi à s'occuper de leurs propres réfugiés. Le problème des réfugiés de ces états qui auront perdu leur pays pose aussi des questions de droit international : alors que jusque là, la notion d'état avait toujours été associée à un territoire, faudra-t-il considérer des états immatériels avec une diaspora de réfugiés conservant leur nationalité d'origine ? Ou bien seront-ils considérés comme des apatrides, avec tout ce que cela représente pour les humains concernés ? Ou enfin, faudra-t-il leur attribuer la nationalités des pays-refuges ? Quelle que soit la réponse à ces questions, elle sera dérisoire en face de la tragédie qu'auront à subir ces réfugiés. C'est pourquoi certains de ces états refusent même l'idée d'un plan d'évacuation, considérant qu'il s'agirait d'un renoncement et préférant s'en remettre à d'hypothétiques solutions qui conjureraient la malédiction dont ils sont victimes et dont les pays industrialisés refusent la responsabilité.
Les effets du réchauffement climatique sont porteurs de forces centrifuges à l'intérieur même des états : d'abord sous forme de conflits fonciers entre le nomadisme pastoral et la sédentarité agricole, à propos d'une transhumance qui dévaste les récoltes au Tchad, au Burkina Faso, au Nigeria. La faim est aussi un puissant moteur de révolutions : c'est le renchérissement des denrées alimentaires qui est à l'origine des soulèvements du printemps arabe et du Soudan et, pour le géopolitologue, ces mouvements ne sont qu'un prélude annonciateur de crises sociales qui ont déjà débuté en Europe. L'insatisfaction des besoins de base est aussi un terreau fertile pour le recrutement des guerres de religion, tel le mouvement islamiste au Mali.
Des guerres entre états pour la maîtrise de l'énergie, des matières premières et de l'eau douce ne feraient qu'aggraver la situation climatique, mais ne sont pas du tout inconcevables. En ce qui concerne la ressource hydrique, Audrey cite la Chine, l'Inde et le Pakistan qui se partagent deux tiers des bassins hydriques de l'Himalaya. Le partage entre ces trois pays est soumis à l'accord de l'Indus, signé en 1960 sous l'égide de la banque mondiale, mais rendu caduque par les modifications de débit. Une guerre froide de l'eau, déjà commencée entre ces états, sous forme de retenues d'eau contraires à l'accord, pourrait un jour déboucher sur un conflit armé, et cette éventualité est aggravée par une donnée supplémentaire : la maîtrise technologique de la Chine lui permet de déclencher des pluies à la demande par ensemencement des nuages sur certaines de ses régions, au détriment de l'hydrologie des régions voisines. Le danger est d'autant plus prégnant qu'il n'existe aucun cadre juridique pour encadrer ces pratiques de géo-ingénierie et que des états ou même des particuliers suffisamment riches peuvent jouer aux apprentis sorciers sans aucune contrainte.
Un autre liquide a été l'enjeu de nombreuses guerres au vingtième siècle dont les pénuries à venir engendrent encore les tensions autour de cette ressource : François Gemenne parle d'une dépendance au pétrole et au gaz russes, qui met l'Europe dans la situation de financer une guerre qu'elle voudrait pourtant arrêter. C'est à ses yeux une leçon pour l'avenir et la démonstration que, pour des raisons autant climatiques que géopolitiques, il va falloir laisser dans le sol les réserves encore existantes et s'habituer à la sobriété. Les défenseurs de l'environnement et les experts en géopolitique sont d'abord sur ce point, mais il parait quasiment impossible de convaincre les pays producteurs de renoncer à la ressource qui a fait leur richesse.
Pour prévenir les tensions géopolitiques, la condition nécessaire, mais non suffisante, est la réduction des gaz à effet de serre. Non suffisante car il ne faut pas attendre qu'une crise survienne pour réagir, comme on a eu tendance à le faire dans le passé. Une stratégie d'adaptation, c'est d'abord la mise en place d'infrastructures permettant de répondre aux aléas climatiques. C'est aussi les enjeux d'aménagement du territoire, les choix politiques de modèle agricole et de modèle économique dans les secteurs qu'il va falloir adapter à un climat changeant, s'il le faut jusqu'à la refonte du modèle. C'est aussi la prise en charge des sinistrés, insuffisante aujourd'hui : même dans des pays avancés comme l'Allemagne et la Belgique, les inondations de l'été dernier ont fait des morts par manque d'information des habitants, manque de moyens d'évacuation, permis de construire en zone inondable, etc. Enfin les opinions publiques doivent être préparées à surmonter les préventions contre les migrants originaires de contrées lointaines, pour qu'il n'y en ait plus qui se noient au cours d'une tentative de passage de la Méditerranée ou de la Manche, qu'ils soient accueillis dans des conditions plus dignes que les camps de réfugiés qui se multiplient sur la planète.
Malgré la responsabilité historique qui est la leur, les pays du Nord ne sont pas prêts à assumer la solidarité financière envers les pays du Sud, promise en 2009, mais qui ne se concrétisera au mieux qu'en 2025. On sait, avant même qu'ils soient mis sur la table, que ces montants seront insuffisants et qu'ils seront délivrés soit sous forme d'aides qui existait déjà soit sous forme de prêts ce qui, selon le géopolitologue, n'a aucun sens. Ces dépenses de solidarité, explique-t-il, ont un coût dont il ne faut espérer aucun retour sur investissement. C'est donc, selon la pensée capitaliste, une hérésie d'investir dans ces stratégies d'adaptation plutôt que dans des stratégies de réduction des gaz à effet de serre dont on peut espérer tirer bénéfice.
A la fin de cet épisode, une conclusion s'impose : il ne sera pas possible de conjurer l'ensemble des menaces qui pèsent sur les générations futures sans un changement complet de paradigme, incluant le plus large consensus social sur les mesures à prendre, une synergie de toutes les composantes sociétales, une volonté de maintenir à tout prix une paix plus que jamais nécessaire, une entente internationale sans faille. C'est la remise en cause de la logique capitaliste non pas par dogmatisme idéologique, mais parce que, selon le mot prêté à Jean Jaurès, il porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Ce qui arrivera si cet énorme défi n'est pas relevé, les champs de bataille de Verdun et leur désertification en donnent, cent ans après, une idée précise.
LIEN VERS LE PODCAST : https://podcasts-francais.fr/podcast/dernieres-limites
POUR EN SAVOIR PLUS :