Les idées que le sujet du bac français réveillent en moi sont grandes. Tout s’anéantit, tout périt, tout passe. Je paraphrase le début de l’extrait du Salon de 1767 soumis à la lecture de quelques centaines de milliers de bacheliers généraux en cette session 2023. Ils auront remarqué l’énumération, l’anaphore, l’hyperbole, le présent de vérité générale, et quantité de bricoles stylistiques dans l’ensemble du texte, qui, mises bout à bout, n’auront absolument aucun intérêt si elles ne complètent pas une nécessaire enquête sur les intentions de l’auteur, sa vision du monde, et encore ses partis-pris théoriques et esthétiques. — Oui, je connais la réputation de coupeurs de cheveux en quatre des profs de français qui scrutent les textes à l’affût des épanadiploses, homéotéleutes et autres catachrèses en donnant trop souvent l’impression que la valeur des textes tient principalement aux ornements du style.
Vingt-trois lignes, quatre paragraphes extraits d’un commentaire que Diderot consacre à une peinture d’Hubert Robert intitulée Grande Galerie antique, éclairée du fond. « Durée : 4 heures. Coefficient : 5. L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. » Heureusement, il y a le paratexte. Le paratexte, ce sont les informations parcimonieuses fournies dans le sujet en complément du texte à commenter, et que les professeurs demandent aux élèves de lire attentivement pour se faire une idée du contexte, comprendre les enjeux de l’extrait, et à tout le moins éviter les contresens le jour de l’épreuve. Or, c’est là que le bât blesse.
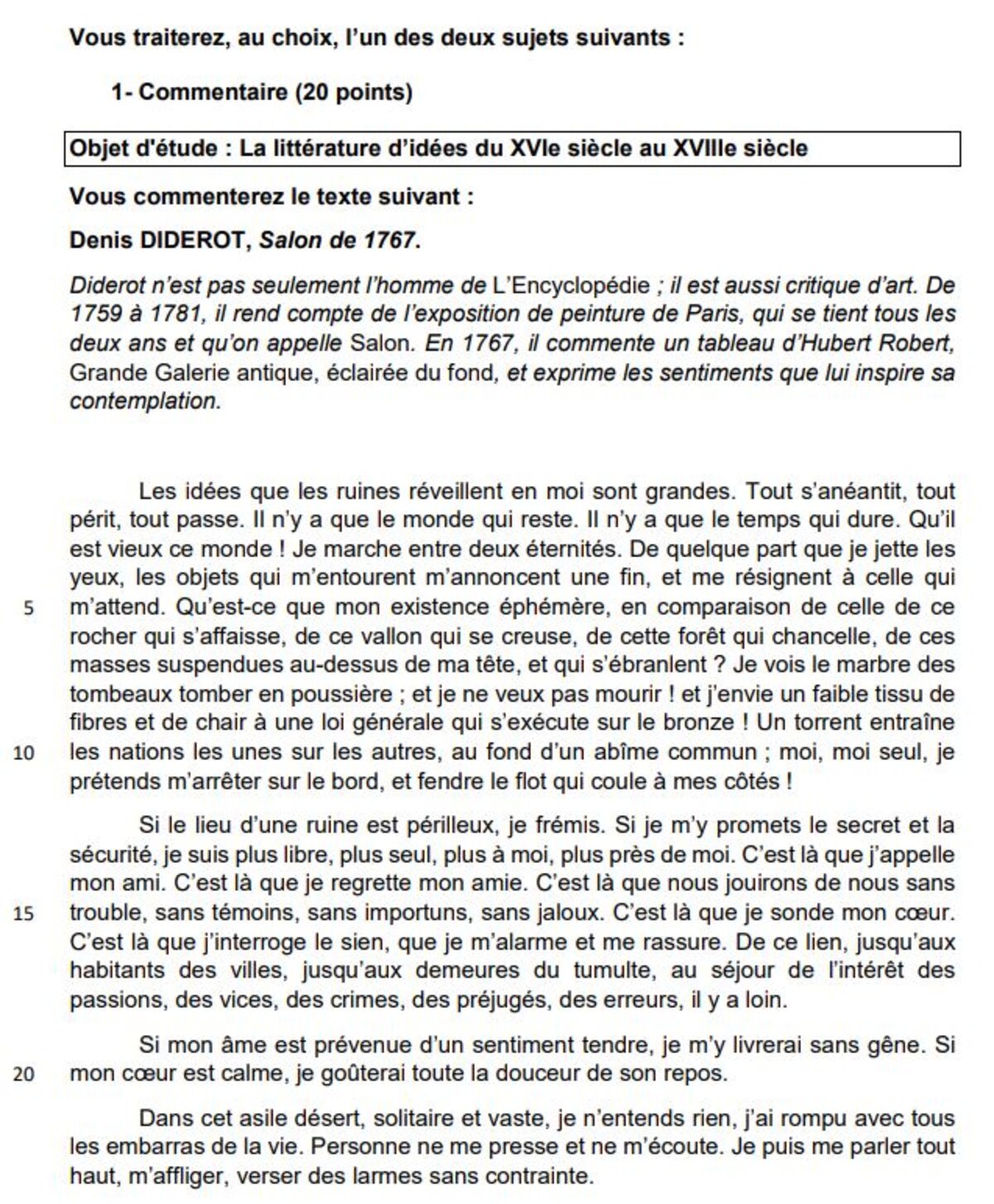
Agrandissement : Illustration 1
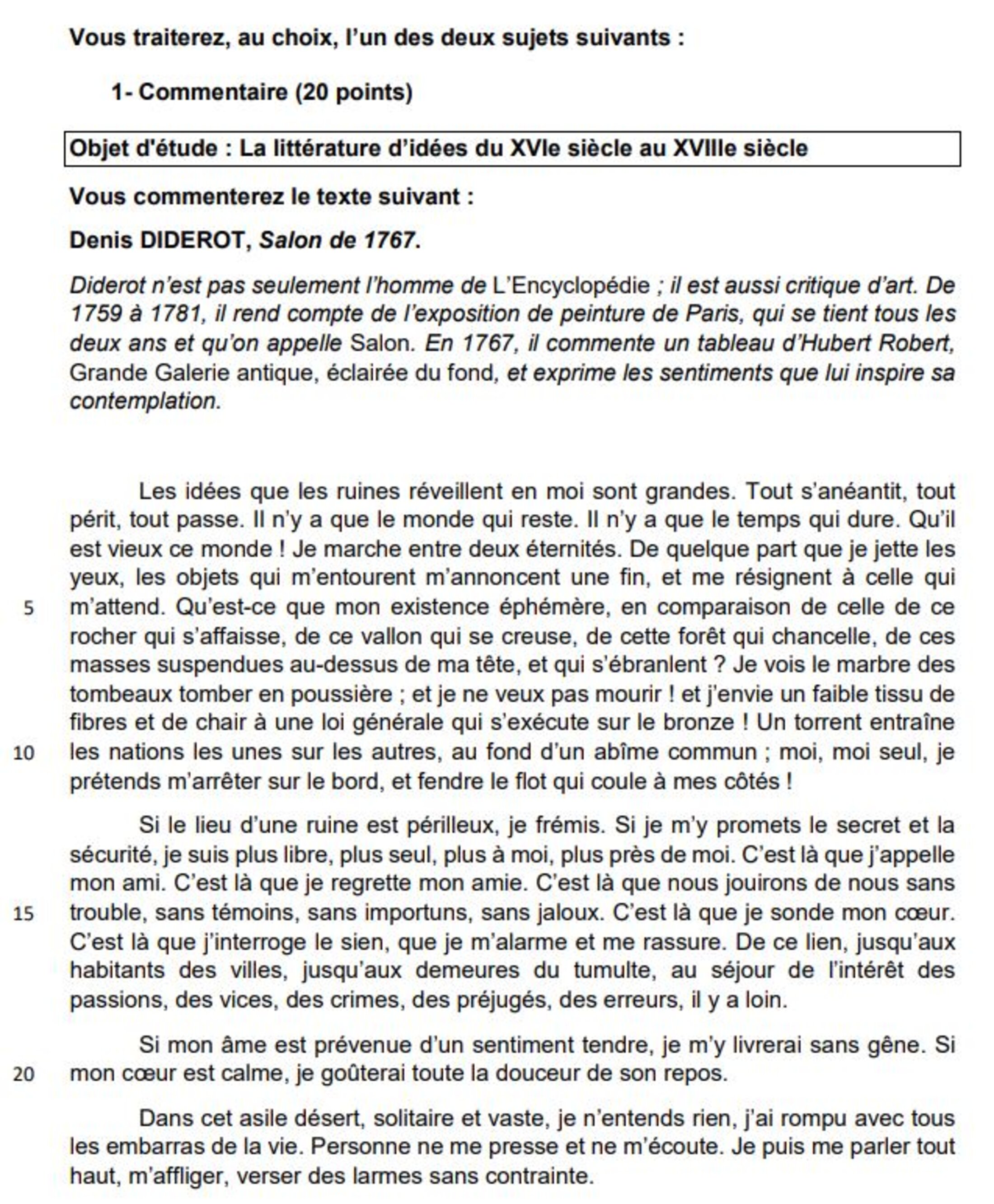
Dans le paragraphe en italique qui le précède, l’extrait est présenté comme le commentaire d’un tableau d’Hubert Robert, avec un Diderot qui « n’est pas seulement l’homme de L’Encyclopédie », mais « aussi critique d’art », plongé dans la « contemplation » d’une ruine peinte qui lui « inspire » les « sentiments » qu’il « exprime » dans l’extrait. — Ma phrase est lourde, j’en conviens, mais les guillemets sont nécessaires pour expliquer les erreurs d’appréciation des concepteurs du sujet et le mauvais aiguillage des candidats. Par définition candides, ces derniers auront compris que l’auteur est tout à fait abîmé dans la contemplation d’une ruine préromantique qui lui inspire une réflexion métaphysique sur la finitude de toute chose, le temps qui passe inexorablement, etc. Tout cela est fort bien, mais à côté de la plaque. En effet, quelques lignes avant l’extrait proposé (dans ce qu’on appelle techniquement l’avant-texte, que les candidats ne pouvaient connaître), Diderot, après avoir trouvé quelque qualité à l’art d’Hubert Robert et l’avoir qualifié d’ « habile homme », lui enjoint d’ « imite[r] Vernet », un concurrent ! « Apprenez de lui à dessiner, à peindre, à rendre vos figures intéressantes ; et puisque vous vous êtes voué à la peinture des ruines, sachez que ce genre a sa poétique. Vous l’ignorez absolument. Cherchez-la. Vous avez le faire, mais l’idéal vous manque. » Tu parles d’un éloge… Car, n’en doutons pas, orientés par le paragraphe d’introduction, les bacheliers auront cherché à montrer à quel point Diderot admire la peinture d’Hubert Robert. N’était-il donc pas possible, dans ce fichu paragraphe d’introduction, de préciser que… Allez, je propose ceci :
« Diderot n’est pas seulement l’homme de L’Encyclopédie ; il est aussi critique d’art. De 1759 à 1781, il rend compte de l’exposition de peinture de Paris, qui se tient tous les deux ans et qu’on appelle Salon. En 1767, il commente un tableau d’Hubert Robert, Grande Galerie antique, éclairée du fond, et, après avoir admiré la technique du peintre, il lui reproche cependant de méconnaître l’esthétique propre à la représentation des ruines : en somme, le peintre est habile, mais il devrait être aussi un penseur. Pour le conseiller, il développe alors les idées que devraient inspirer la vision des ruines en évoquant son expérience personnelle. » C’est un peu plus long que sur le sujet. Je proposerais volontiers de supprimer la première phrase. Signe des temps : en 2023, il vaut mieux préciser, tout en faisant comme si c’était connu de tous, que Diderot est « l’homme de L’Encyclopédie », parce que, en vrai (comme disent les bacheliers), peu le savent.
Et alors ? WTF ? Après tout, si la copie atteste d’un savoir-faire technique, d’un effort de compréhension, d’une démarche authentique de mise en lumière du sens, etc., pourquoi se perdre dans des considérations pointilleuses ? Le candidat conclut que Diderot fait l’éloge de Robert, mais si, en mettant de côté l’erreur du paratexte, sa démonstration est cohérente, où est le problème ? Bah, qu’est-ce qu’on apprend à nos élèves ? Lire avec les bonnes lunettes, comprendre, décrypter avec précision, sens critique, pondération, capacité à comparer... Si on les élève jusqu’au niveau du bac en les évaluant sur des sujets mal ficelés : quelles connaissances, quelles compétences, quelle culture évaluons-nous ? Et comment répondre d’une telle erreur ? Ou alors est-ce intentionnel ? Serait-ce une façon de simplifier le sujet ? — Je n’y crois pas : tel quel, ce sujet rend le commentaire difficile. En effet, le candidat est orienté vers une description d’un tableau, mais à aucun moment Diderot ne fait référence à ce tableau, qui est le sujet principal du texte, mais le grand absent de l’extrait choisi pour le bac. À la place d’un candidat, avec des connaissances pas tout à fait digérées, l’angoisse de l’épreuve, l’esprit encore occupé par les réseaux sociaux consultés avant d’entrer dans la salle d’examen, j’aurais sans doute trouvé ce texte très bizarre… et n’aurais pas pensé que l’erreur était dans l'introduction ! Ainsi nous corrigerons des copies nécessairement mauvaises parce que le sujet était mauvais. Copies mauvaises : pas tout à fait. Ce seront plutôt des erreurs de perspective. Mais enfin, c’est essentiel dans un texte, la perspective, le point de vue, le POV comme on dit maintenant (Point Of View : ramassis d’idées, de sentiments et d’expression spontanée sur les réseaux sociaux).
Un professeur de français est une personne, majoritairement de sexe féminin, dotée d’un véhicule personnel (plutôt une vieille occase ; plus rarement une location longue durée onéreuse mais socialement valorisante) et éventuellement d’un diplôme certifiant ses compétences pédagogiques (et accessoirement ses connaissances littéraires et linguistiques). Perso, j’ai vendu ma voiture il y a un an. Je circule à vélo et en train, et, quand je n’ai pas le choix, je loue une Twingo ou une Clio chez Leclerc. Lundi prochain, à 9 heures, j’ai rendez-vous pour faire l’état des lieux de l’un de ces bolides qui m’emmènera ensuite à Millau (trois heures sur les départementales du Lot et de l’Aveyron) pour interroger, à partir de 13h15, des candidats de terminale qui passeront leur Grand Oral de théâtre (et aussi d’Occitan, mais là je ne suis pas du tout spécialiste). Pas de bol, du coup je ne pourrai pas participer à la visio de concertation avec tous mes collègues de français de l’académie de Toulouse et mes inspecteurices, à 9 heures justement, le même jour. Zut, c’est le préalable à la prise en charge et à la correction des copies. Mais ça va, je me suis fait une petite idée du sujet, je me sens prêt à corriger avec bienveillance — art de fermer les yeux sur la ruine de notre système éducatif. Aïe, je voulais éviter une telle sentence. Mais je pense avoir montré que le diable est dans les détails. Je n’ai pas tenu un discours défaitiste et déprimé sur le tout-fout-le-camp-à-l’éducation-nationale. Ce sont quelques mots, dans un paragraphe anodin, qui ont suffisamment montré, je l’espère, qu’il y a chez nous un énorme malaise : qui a encore des compétences de lecture ?



