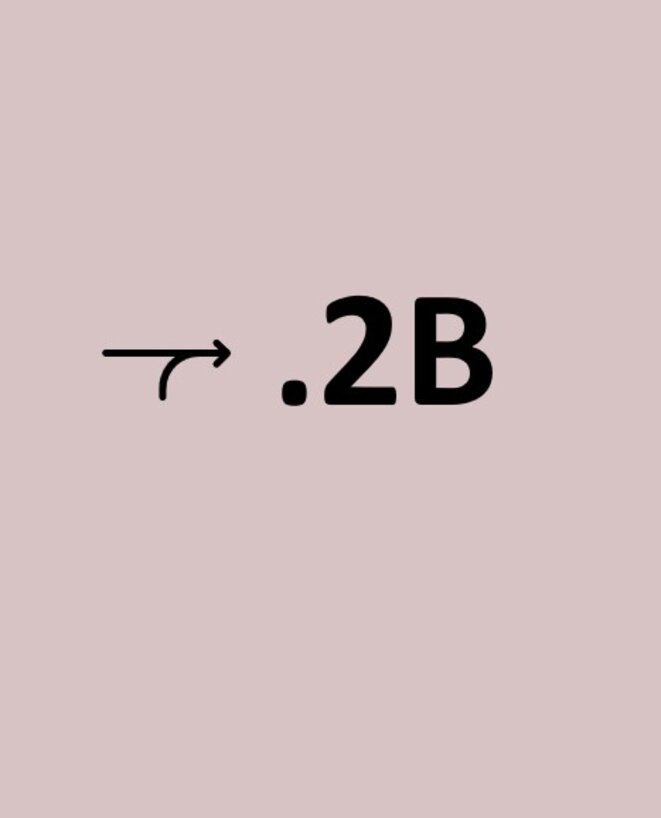Tout le monde en a convenu : la mobilisation contre la réforme des retraites a connu un tournant après l’emploi du 49.3 par le gouvernement. Les jeunes notamment, peu mobilisés jusque-là, ont massivement rejoint les cortèges et organisé des actions spécifiques, car le problème n’apparaissait plus seulement comme un conflit social dans lequel ils pouvaient avoir du mal à se projeter, mais plus profondément comme un problème de fonctionnement démocratique : la réforme critiquable en elle-même devenait insupportable par la manière dont elle était imposée à la nation. Sur ce point qui fait consensus, il est de nouveau utile de rappeler ce que l’autoritarisme de la Ve république doit à notre histoire coloniale. Rappeler qu’elle est la fille de la guerre d’Algérie ne revient pas à enfoncer une porte ouverte mais à raviver un débat constitutionnel qui n’a jamais été clos. Un Etat ne soumet pas des peuples allogènes à ses lois sans que ces dernières n’en soient profondément altérées et pire encore l’esprit des gouvernants. A cet égard, comment ne pas voir que la morgue recuite de l’Elysée se nourrit, entre mille sources, de l’habitus autoritaire d’une république qui depuis 1870 est consubstantielle d’une politique de puissance qui s’est incarnée dans des formes impériales ?
Cet autoritarisme infusé dans l’histoire coloniale et néocoloniale est d’autant plus insupportable qu’il émane de dirigeants qui courent aujourd’hui après une chimère. La France n’a plus les moyens d’être une grande puissance, ce qu’elle fut à une autre époque ; elle n’a plus la capacité que d’occuper une position marginale dans le concert des nations qui dirigent le monde, sans rapport avec le faux semblant que constitue sa place acquise en d’autres temps au conseil de sécurité de l’ONU. C’est un fait entendu partout, sauf en France où seules nos élites semblent sourdes à la marche du monde. En conséquence, des dirigeants désireux d’incarner cette ambition multiséculaire de jouer un rôle de premier plan mais qui se voient rabroués en permanence dans les instances internationales et ramenés à leur réelle consistance, ne peuvent que nourrir un sentiment d’impuissance et d’humiliation, qui se retourne contre leur peuple sous la forme d’un surplomb méprisant (ces « gaulois réfractaires » incapables d’accepter les réformes qui selon eux permettraient de maintenir le statut de puissance) et d’une tendance au sadisme social (la politique de classe érigée en art de gouverner confine aujourd’hui au plaisir mal dissimulé d’humilier et faire souffrir « ceux qui ne sont rien »).
Dans la liste interminable des scandales qui secouent notre république à un rythme accéléré depuis six ans, revenons sur l’affaire du fond Marianne. On peut déjà sentir – même si on a l’odorat peu performant, les relents d’une dépense comptable mal maîtrisée et peu ragoutante. Et, si on a le flair un peu plus aiguisé, les vapeurs malodorantes d’une corruption bien française dont la tradition a trouvé des racines très vigoureuses dans ce monde parallèle qu’a toujours constitué notre domaine ultra-marin. Le laxisme avec lequel l’argent public est distribué contraste avec les cris d’alarme de nos élites néolibérales, jamais en reste pour dire au bas peuple qu’il coûte trop cher mais qui soutient par ses actes que jamais rien n’est trop beau pour elles. Ce laxisme, cette impunité, cette comptabilité à double colonnes selon que l’argent est destiné aux dépenses solidaires ou à l’enrichissement d’une caste, doivent beaucoup aux possibilités infinies de corruption que l’empire colonial et postcolonial françafricain a octroyées à nos élites, comme l’a montré le procès ELF en son temps ou l’action judiciaire en cours sur l’affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, entre mille exemples. Ainsi, les fonds censés lutter contre les séparatismes religieux semblent avoir en réalité alimenté celui des affidés du pouvoir. Comment ne pas voir là une énième expression de cette perversion de la république française, toujours donneuse de leçons et sans cesse prise la main dans le pot de la corruption ? De la mission civilisatrice jadis promue par Jules Ferry à la dilapidation du fond Marianne destiné à lutter contre l’obscurantisme religieux, par les services d’un secrétariat d’Etat qui ne brille que par les frasques de sa tenancière, la république semble irrémédiablement vouée à l’oubli de ses principes et à la reviviscence de ses réseaux de clients.
Enfin, est-il possible de comprendre l’impasse environnementale dans laquelle nous nous trouvons sans réfléchir à la mise en place d’une économie mondialisée hors-sol, engrenée dès le XVIe siècle à l’histoire des empires coloniaux ? L’exploitation capitaliste des êtres et des ressources a habitué l’Occident à vivre constamment au-dessus de ses moyens dans un système qui a mis sa foi dans une croissance infinie parce qu’il vivait dans l’illusion qu’il pourrait toujours prédater au loin les ressources qu’il ne possédait pas localement. Les déficits commerciaux abyssaux de notre pays ne trouvent-ils pas en partie une origine structurelle de long terme dans la tentation constante de l’externalisation de notre économie depuis le XVIe siècle ? Ce « Gaulois réfractaire » que tance le pouvoir, n’est-il pas ce citoyen qui rechigne à se casser le dos pour des chimères quand toutes les enquêtes internationales montrent que les pays du Nord de l’Europe, dispensés du fardeau postcolonial, apparaissent comme les plus heureux de la planète ?
De cette histoire, il faudrait tirer les leçons, reconnaître la faute coloniale (non pas dans un esprit de repentance mais de reset global), renoncer à la puissance mais pas à notre faculté de bâtir un système qui pourrait susciter le désir d’être suivi ; réinventer une économie ancrée dans le sol et dans l’échange équilibré ; repenser nos relations, nos dépendances, notre liberté et notre fraternité ; accompagner la décolonisation de nos dernières possessions dans un esprit libéré de toute ambition de puissance informelle. Mais le spectacle offert par les médias mainstream accaparés rappelle malheureusement une réaction non sans lien, encore et toujours, avec l’univers colonial, celui du « petit blanc » mu par ses émotions négatives : peur du déclassement, haines sociales, xénophobie, paniques morales, désir sans cesse renouvelé de domination sur les êtres et la nature.
Concluons : ce que l’actualité nous rappelle sans cesse et singulièrement depuis trois mois, c’est que le macronisme est, entre mille autres choses, la continuité aujourd’hui absurde, d’un désir de puissance mortifère dont il faut encore et toujours interroger le fondement colonial. Et qu’il ne peut donc être un rempart contre une extrême droite dont il partage – la réforme des retraites, son arbitrage de classe et sa litanie de violences policières en donne la démonstration définitive – l’habitus politique autoritaire.