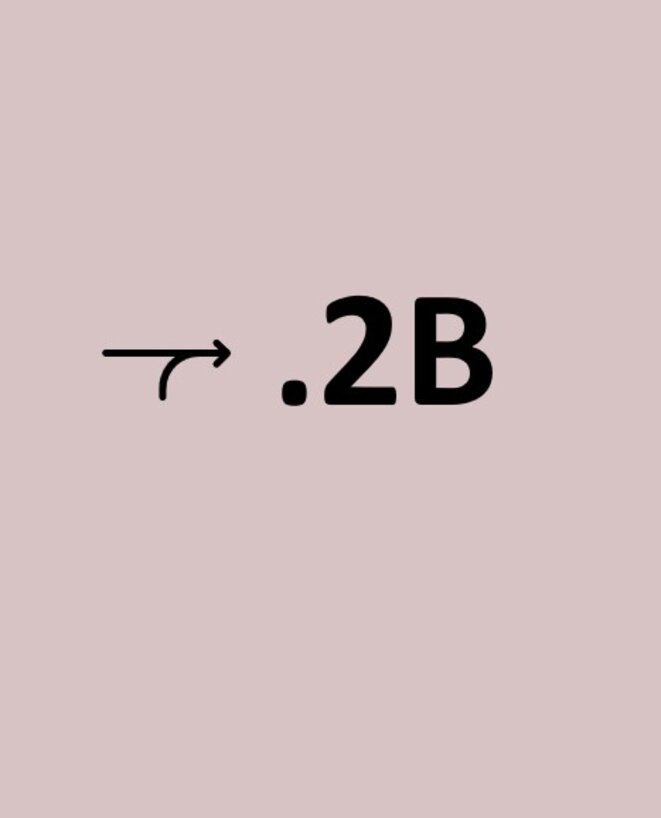Un sentiment diffus envahit les observateurs de bonne volonté, comme une reviviscence de la peur de la fin du monde étudiée par Jean Delumeau[i]. La crise écologique et l’angoisse d’un effondrement généralisé des structures collectives qui nous permettent de vivre ; la bifurcation anthropologique latente dans l’IA ; l’affranchissement de toute norme internationale, dont la destruction du peuple palestinien paraît le paroxysme ; l’épée de Damoclès nucléaire... Le fond de l’air est apocalyptique, chargé d’une angoisse multiforme, comparable à nulle autre.
Comment penser notre époque, comment ordonner ce qui se présente à nos yeux comme un chaos sans fin ? L’historien calme ses inquiétudes en faisant défiler le temps. Il prend du recul, cherche des points de départ, relativise les nouveautés, ne s’en émeut que lorsqu’elles ne font plus de doute après un long examen.
C’est une observation quelque peu cavalière des temporalités de l’histoire que je propose dans cette série de billets. Pour savoir « où nous en sommes », il est utile de réfléchir sur les différents types de temporalité dont nous sommes la pointe avancée[ii]. Mettre un peu d’ordre dans l’écoulement infini du temps peut rassurer et peut aussi aider à faire de la prospective, et donc à éclairer des choix.
En introduction de cette série je voudrais souligner les différents types de temporalités qui émergent à me yeux après plusieurs décennies d’étude de la littérature en sciences humaines. L’humanité connaît des tendances lourdes qui, par-delà des oscillations complexes et des variations inter groupes nombreuses, dessinent une trajectoire claire. Par exemple, la croissance démographique : si chaque société a sa propre histoire, le nombre d’humains sur Terre connaît une tendance nette à la hausse, des petits effectifs de chasseurs cueilleurs du paléolithique aux 8 milliards d’individus qui peuplent aujourd’hui notre planète[iii]. Le plafond qui devrait être atteint d’ici la fin du siècle offre un exemple majeur de point de bascule, parmi ceux qui nous attendent dans les prochaines années. Ces tendances lourdes -croissance démographique, accumulation de savoirs scientifiques, technologiques, d’artefacts, empreinte écologique croissante, etc.- trouvent une logique – formulons l’idée ainsi pour ne pas verser dans une forme de téléologie – dans les caractéristiques sociobiologiques de notre espèce telles qu’elles ont pu être synthétisées par Bernard Lahire[iv].
A contrario, l’humanité connaît des évolutions pour lesquelles on peine à discerner un sens. Le monde des arts, des idées philosophiques et des organisations politique en font partie. Aujourd’hui encore, nul ne saurait démontrer de manière définitive qu’il vaille mieux donner raison à Platon ou à Aristote, à Descartes ou à Kant[v]. La forme optimale de gouvernement des sociétés est l’objet d’une science politique qui ne cesse de produire une glose s’autoalimentant d’autant que la réalité n’aime rien tant que brouiller les concepts.
Certains phénomènes paraissent cycliques. L’étude des cycles en économie est passée de mode mais Peter Turchin offre un élément clé de compréhension de l’histoire humaine avec la cliodynamique qui permet de mettre en évidence, et d’expliquer, les cycles d’intégration et de désintégration des sociétés humaines[vi].
Tendances de très longue durée, fluctuations chaotiques et cycles affectent l’humanité prise dans son ensemble et dans un vaste mouvement. Mais les sociétés connaissent souvent une chronologie décalée, faite de moments de divergence et de convergence. C’est une autre forme de temporalités à prendre en compte. Un exemple parlant est la tendance lourde de l’humanité à l’alphabétisation, incontestable (autour de 90 % de la population mondiale aujourd’hui sait lire), presque achevée aurait-on envie de dire si des inégalités régionales et genrées ne montraient une forte persistance[vii]. On peut la rattacher à la spécificité biologique d’homo sapiens qui possède un cerveau d’un volume et d’un nombre de connexions cérébrales hors-normes dans la biosphère. On peut la rattacher également à l’altricialité secondaire que Bernard Lahire considère comme la contrainte biologique la plus structurante pour les sociétés humaines[viii]. Cela désigne le fait que les petits humains naissent particulièrement immatures, à cause notamment de la taille de leur cerveau, et connaissent une très longue période de dépendance durant laquelle leur survie est conditionnée par les soins prodigués par les parents et la société ; et au cours de laquelle va s’opérer une minutieuse reprogrammation des savoirs[ix]. Mais si cette tendance lourde à l’alphabétisation semble dessiner un quasi universel humain, l’histoire a pu mettre en évidence des chronologies très différenciées entre sociétés, Etats ou civilisations. Emmanuel Todd a pu démontrer les liens qui unissent les structures familiales et les tendances lourdes comme l’alphabétisation[x]. Un exemple fort est la relation qui unit la famille souche, autoritaire, et l’alphabétisation précoce de l’Europe du Nord sur notre continent[xi]. Pour comprendre la géochronologie des temporalités, il est indispensable de se référer à son modèle et à sa cartographie des systèmes anthropologiques.
Dans cette série de billets, nous proposons donc une approche de notre temps et de la crise multifactorielle qui la caractérise en déclinant puis en combinant les différentes temporalités qui les ont constituées, dans l’ordre suivant :
1- L’entrelacs de temporalités dans lequel nous sommes piégés
2- Les tendances de très longue durée
3- Le Moment anthropocène
4- Au pied du mur de l’IA
5- Désintégration cyclique
6- Lignes de failles géo anthropologiques
7-Turbulences chaotiques de la noosphère et de la géopolitique
8- Prospective
Ces différentes figures de la fuite du temps - linéaire, spiralaire, éclatée voire gazeuse, forment comme un repère temporel à trois dimensions. Si bien que tout événement historique peut être positionné dans son espace mais aussi dans sa temporalité tridimensionnelle. Pour prendre un exemple connu, la Révolution française ne peut être comprise si on ne la place pas à la fois sur des tendances de longue et très longue durée comme l’alphabétisation de la population, le mouvement de déchristianisation, etc. ; sur une phase cyclique de décomposition combinant inégalités croissantes et prolifération d’élites concurrentes (l’opposition de la noblesse et de la bourgeoisie pour faire très rapide et très simple) , et sur des fluctuations chaotiques agitant la noosphère (profusion des idées nouvelles de la philosophie des Lumières, large ouverture du champ des possibles) et la géopolitique, provoquant une instabilité incarnée par une multitude d’acteurs rattrapée par les passions d’un moment critique de l’Histoire. Ces trois dimensions entretiennent des interactions complexes : l’alphabétisation nourrit un lectorat croissant qui crée un marché pour les philosophes des Lumières, qui développent un discours critique à l’égard des différentes institutions, qui alimente une réaction nobiliaire, qui..., etc.[xii]
Le positionnement des événements historiques sur ce repère multiaxial permet de cerner l’unicité de chaque crise du passé. L’observation des différentes temporalités permettra de cerner le caractère critique du moment humain actuel, constitué à la fois de problèmes cycliques, de points de bascule de tendances de très longue durée et de perturbations chaotiques, dans une combinaison inédite et particulièrement périlleuse.
[i] Jean Delumeau, La Peur en Occident : XIVe-XVIIIe siècles. Une cité assiégée Fayard, 1978.
[ii] Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand Colin, 1966.
[iii] Dynamiques du peuplement mondial : Comment la population habite le monde, dirigé par Yoann Doignon et Sébastien Oliveau, ISTE Éditions, 2025.
[iv] Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, La Découverte, 2023.
[v] France Inter offre un vulgarisation passionnante de la pensée des grands philosophes dans le podscat Philosophes : podcast et émission en replay | France Inter
[vi] Peter Turchin, Le Chaos qui vient. Elites, contre-élites et la voie de la désintégration politique, le Cherche Midi, 2024. Premier ouvrage de P. Turchin traduit en français, une introduction indispensable à la cliodynamique en même temps qu’une analyse profonde du trumpisme.
[vii] Il n’existe pas à ma connaissance de synthèse sur l’histoire de l’alphabétisation à l’échelle mondiale.
[viii] Bernard Lahire, op. cit.
[ix] Bernard Lahire, « Le rapport parent-enfant est la matrice de tous nos rapports de domination » - Élucid
[x] Emmanuel Todd, La diversité du monde. Famille et modernité, Seuil, 1999, réédition en un seul volume de La troisième Planète. Structures familiales et systèmes idéologiques, Seuil, 1983 et L’Enfance du monde. Structures familiales et développement, Seuil, 1984.
[xi] L’influence du protestantisme sur l’alphabétisation ne serait qu’un effet de la famille souche, voir Emmanuel Todd, La diversité du monde, op. cit, p. 168.
[xii] Voir Jacques Solé, La Révolution en questions, Seuil, 1988.