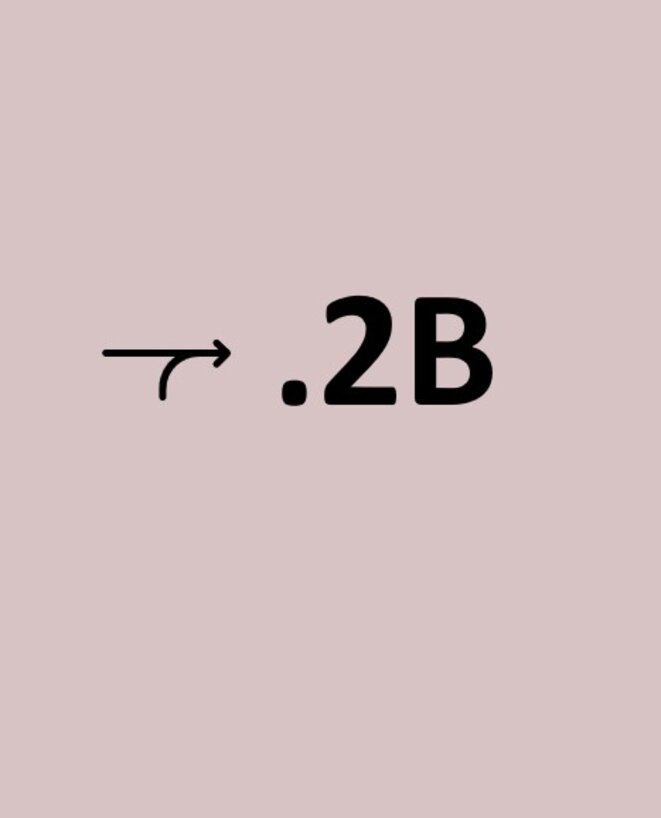La collapsologie a profondément ancré en nous la crainte d’un effondrement global des sociétés humaines, unies dans une interdépendance généralisée[1]. La définition par la communauté scientifique de limites planétaires, dont plusieurs ont déjà été franchies, alimente notre angoisse d’un monde en fin de vie.
Un seuil est âprement discuté entre tous, celui du réchauffement maximum à ne pas dépasser si l’on veut éviter le basculement dans un monde invivable. Le climat n’est pas le seul paramètre environnemental à prendre en compte mais sa place dans le système terrestre lui confère une capacité d’entraînement décisive.On se souvient des négociations sans fin lors de la COP 21 : « 1.5° » plaidaient les Etats insulaires les plus fragiles, « 1.8° » répondaient les puissances industrielles accros aux énergies fossiles.
Depuis, l’évolution de l’économie mondiale étant ce qu’elle est, le consensus scientifique actuel reconnaît largement que ces objectifs ne seront pas tenus : « Le niveau de réchauffement global de 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle sera atteint dès le début des années 2030, quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2.
Les politiques actuellement en place conduiraient à un réchauffement global de 2,4 °C à 3,5 °C d'ici la fin du siècle, avec une valeur médiane de 3,2 °C.[2] » Autant dire des scénarii que plus personne ne pourra maîtriser.
C’est dans ce contexte que la glaciologue Heidi Sevestre, récemment en tournée de promotion pour son dernier ouvrage[3] sur tous les plateaux climato-friendly[4], a rappelé que pour les spécialistes de sa discipline, le point de bascule semblait se situer à ce fameux chiffre de 1.5°. Pour la cryosphère, si déterminante pour les équilibres climatiques planétaires, les modèles montrent qu’il y a un grand danger à ne plus considérer ce seuil de ° comme la limite à ne pas dépasser.
Il y a donc quelque chose de surréaliste à voir cette scientifique pleine d’énergie déployer des trésors de bonne volonté et de pédagogie afin d’alerter encore et toujours sur cette limite planétaire alors même qu’il semble impossible - si l’on examine les données disponibles – d’empêcher les +2° d’ici peu. Il est vrai que chaque dixième de degré compte pour limiter l’ampleur de la catastrophe, mais il est non moins vrai que la catastrophe aura bien lieu.
En tant que citoyen, cette réflexion ne peut que renforcer l’éco-anxiété et faire se désespérer de l’incapacité de nos systèmes socio-politiques à engager la bifurcation nécessaire pour éviter que la fin programmée de notre ère thermo-industrielle ne se fasse dans un effroyable chaos. En tant qu’historien, la pente intellectuelle disciplinaire fait s’interroger sur la chronologie de ce désastre annoncé.
A partir de quand l’humanité a-t-elle dépassé le point de non-retour ? A partir de quand, précisément, a-t-elle épuisé toutes ses chances de préserver un environnement terrestre stable et propice à son épanouissement ?
Je serais tenté de proposer une réponse : 1972.
Le rapport Meadows a alors fixé avec une acuité troublante les scenarii possibles. Il en ressort qu’il eut fallu engager dès cette date une politique extrêmement volontariste et actionner tous les leviers en même temps pour éviter que l’humanité ne s’engage sur une trajectoire dont elle ne pourrait bientôt plus dévier.
Or, on le sait : rien n’a été fait, ou si peu. Non pas que ce rapport n’ait pas eu l’écoute ni le retentissement qu’il méritait. Il est aujourd’hui enseigné au lycée dans le cadre, entre autres, de la spécialité HGGSP[5] et je me souviens avoir été frappé par son évocation lors de mes cours de SES quand j’étais moi-même élève, il y une quarantaine d’années. On peut affirmer qu’il fait partie de la culture générale du citoyen lambda disposant du bagage académique moyen de notre temps. Mais il n’a pas eu d’effet concret, la bifurcation à laquelle il appelait n’a pas été opérée.
Si les générations futures ont encore le loisir de se pencher sur leur histoire, elles ne pourront que maudire les lobbys et les décideurs qui en toute connaissance de cause[6] ont fait perdre les années précieuses qui auraient pu permettre d’opérer la bifurcation nécessaire, au lieu de quoi ils ont sciemment fait franchir à l’humanité le point de non-retour environnemental pour préserver leurs bénéfices à court terme.
Pour l’historien qui guette de manière méthodique les ruptures dans l’histoire humaine, aucune autre observation - la concurrence est pourtant rude - ne peut générer une telle sidération.
[1] Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Seuil, 2015. Je ne rentre pas dans le débat de savoir si ce type d’approche est démobilisateur ou pas. L’information reste de toute façon indispensable.
[2] Réchauffement climatique : un nouveau rapport alarmant du GIEC | vie-publique.fr
[3] Heidi Sevestre, Sentinelle du climat, Harper et Collins, 2023.
[4] Il est facile de revoir ses entretiens sur YouTube, pour Blast et Greenletter Club notamment.
[5] Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences politiques.
[6] Les pétroliers connaissaient les risques pour le climat depuis 45 ans | Mediapart