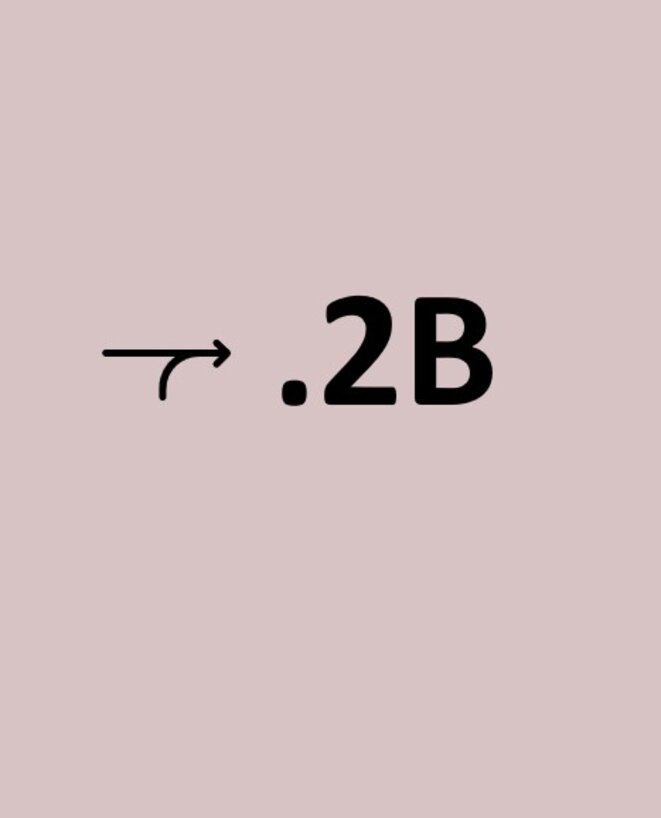Ce blog n’est pas un lieu propice pour refaire l’histoire du génocide tutsi au Rwanda en 1994, ni celle de l’implication des autorités françaises de l’époque. Sur ce dernier point, le rapport de la commission Duclert a démontré leur part de responsabilité « lourde » et « accablante »[i]. La commission s’est refusée cependant à trancher la question de la complicité en se réfugiant derrière une définition morale et restrictive de la notion, alors même que tous les éléments d’information accumulés l’étayent si on lui applique les critères du droit pénal[ii]. Néanmoins, les faits établis depuis 1994 par les rescapés, les militants associatifs, les journalistes et historiens épris de vérité, sont désormais reconnus en partie dans un rapport commandé par l’Elysée, qui vaut pour mémoire d’Etat, après une période que l’on pourrait qualifier de « déni de rigueur » d’un quart de siècle.
Ce que rappelle Jean Varret[iii] et ce dont la commission Duclert a pu se faire l’écho, archives à l’appui, c’est que les signaux d’alerte qui auraient dû permettre aux autorités françaises de changer de politique n’ont pas été pris en compte. Systématiquement, les rapports étayant la dérive génocidaire des autorités rwandaises aux mains du « hutu power », ont été étouffés et leurs auteurs réprimandés. Rien n’a pu faire dévier la trajectoire qui a mené les dirigeants de l’époque à impliquer notre pays dans le dernier génocide du XXe siècle. Pour l’historien qui traque les points de bascule de l’histoire et les mutations des systèmes, l’incapacité de l’appareil d’Etat à remettre en cause le paradigme françafricain avant, pendant et même après le génocide de 1994, est un triste cas d’école. Mais quel est donc ce système néocolonial si profondément enkysté que même le risque de le voir impliqué dans le « crime des crimes » n’a pu remettre en cause ?
La surdité des autorités de l’époque ne peut pas se comprendre si elle n’est pas reliée à la politique impérialiste pluri séculaire qui s’incarne dans nos élites dirigeantes, génération après génération[iv]. Du premier empire colonial américain au XVIe siècle à la participation du président Macron aux obsèques du dictateur Idriss Déby en 2021, un long fil colonial relie la politique étrangère de la France depuis cinq siècles. Impérialisme formel et territorialisé lors de nos deux grands cycles d’expansion, plus informel durant la période intermédiaire comme l’a montré récemment David Todd[v]. En effet, la perte de l’essentiel de nos colonies entre la guerre de 7 ans et la défaite finale de Napoléon 1er en 1815 a donné naissance à un « empire de velours » au XIXe siècle, selon son expression, avant que les « choses sérieuses » ne reprennent sous la IIIe république. Enfin, la perte de notre deuxième empire colonial après 1945 a lui aussi donné naissance à un nouvel impérialisme informel, fondé sur l’ingérence permanente, la dépendance par la dette et la monnaie, les accords de coopération militaire et la mainmise des FTN sur les ressources, que le regretté F.-X. Verschave a contribué à faire connaître sous le vocable de Françafrique[vi].
Il faut donc souligner que lorsque F. Mitterrand et l’Etat profond de notre pays refusent de voir les signaux d’alerte qui informaient de la dérive génocidaire de « nos » alliés hutus, c’est sous l’effet d’un aveuglement qui trouve sa source dans un paradigme bien connu. Ce paradigme françafricain imbrique étroitement la raison d’Etat à toute la palette de ses moyens, des plus officiels aux plus occultes : 1- la France doit tenir son rang de puissance 2- elle doit pour cela étendre sa sphère d’influence à partir de son ancien domaine colonial 3- pour maintenir son influence, le plus simple est de favoriser l’accession au pouvoir de dictateurs alliés, corrompus et complaisants 4- ces dictateurs corrompus et complaisants seront des serviteurs d’autant plus zélés que des accords de coopération militaire assureront leur défense extérieure et leur stabilité intérieure 5- ces accords doivent être rigoureusement respectés afin d’assoir la crédibilité de la France en tant que puissance.
Les derniers points nous amènent directement au Rwanda. Lorsque le FPR, organisation politique et militaire dirigée par des Tutsis exilés en Ouganda après les massacres qui ont suivi l’indépendance, menace d’envahir leur pays d’origine et d’y prendre le pouvoir en 1990, c’est l’opération Noroît qui permet aux militaires français de sauver la mise à la dictature hutue, dans une application plus qu’extensive des accords de coopération qui liaient les deux Etats. Tout en faisant semblant de promouvoir ensuite une solution négociée, la France ne cesse de donner des gages au « hutu power » en privilégiant une grille de lecture non dénuée de racisme[vii] . Durant toute la période 1990-1994 comprenant le génocide[viii], cette grille de lecture assimile en effet le FPR à une agression extérieure, en provenance qui plus d’une ex-colonie britannique réactivant le complexe de Fachoda.
Depuis, la France traine cette faute comme un boulet sans pour autant remettre fondamentalement en question son logiciel de politique étrangère. Et même s’il faut mettre au crédit du président Macron d’avoir favorisé la reconnaissance de la responsabilité des autorités françaises de l’époque, rien n’est moins sûr qu’il l’ait fait pour de bonnes raisons, tant son action se met par ailleurs dans les pas de ses prédécesseurs qui ont tous depuis une vingtaine d’années renié la Françafrique dans leurs paroles pour mieux la faire perdurer dans leurs actes[ix].
Si même l’implication dans un génocide n’a pu servir de point de bascule pour une bifurcation salutaire de notre politique étrangère, on ne peut alors que ressentir du soulagement à voir ce système s’étioler sous le poids des ans et de la reconfiguration géopolitique mondiale ; sans être sûr, malheureusement, qu’il en sortira quelque chose de meilleur pour les peuples éprouvés par la Françafrique.
[i] Rwanda : la commission Duclert conclut à une faillite militaire et politique de la France de 1990 à 1994 (lemonde.fr)
[ii] François Graner: «On aimerait que le rapport de la Commission Rwanda aille plus loin» (rfi.fr)
[iii] Général Jean Varret, Souviens-toi. Mémoires à l’usage des générations futures, Les Arènes, 2023.
[iv] « Les faits sont têtus » : vingt ans de déni sur le rôle de la France au Rwanda (1994-2014) (openedition.org)
[v] David Todd, Un empire de velours. L’impérialisme informel français au XIXe siècle, La Découverte, 2022.
[vi][vi] Voir le livre pionnier de F.-X. Verschave, La Françafrique. Le plus long scandale de la république, Stock, 1998 et plus récemment la somme dirigée par Thomas Borrel, Amzat Boukari Yabara, Benoît Collombat et Thomas Deltombe, L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Seuil, 2021.
[vii] Voir l’ouvrage de François Graner, Le sabre et la machette. Officiers français et génocide tutsi, Mons, Editions Tribord, 2014.
[viii] Pour une synthèse des faits : Benoît Collombat et David Servenay, « Au nom de la France ». Guerres secrètes au Rwanda, La Découverte, 2014.
[ix] Françafrique : Macron ne fait même plus semblant | Mediapart