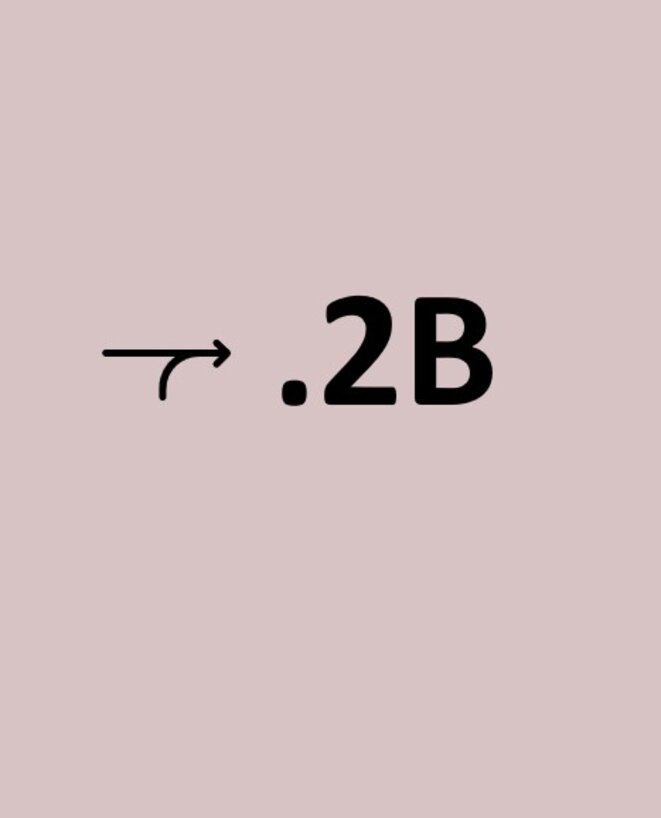La guerre en Ukraine, événement inouï, à la fois prévisible et objet d’un aveuglement collectif[i], est propice à tous les emballements médiatiques. Les « jamais vu depuis... » fleurissent dans les colonnes et donnent du grain à moudre pour ce blog qui se donne pour problématique de mesurer justement ce qui, dans le flot de l’actualité, relève des mutations et points de bascule ou au contraire des permanences. Deux événements récents interrogent sur leur nature de tournant ou péripétie.
Le premier est la destruction du barrage de Kakhovka qui a donné lieu à une surenchère dans les commentaires. Or, Pierre Rimbert dans un petit texte inséré dans la dernière livraison du Monde diplomatique[ii] a ramené cet événement à de plus justes proportions au regard de l’histoire, ce qui ne veut pas dire minimiser l’horreur de l’acte ni ses conséquences délétères tant pour les populations que pour l’environnement. Mais contrairement à ce qu’a pu écrire F. Galland dans le Monde[iii], une telle attaque n’est pas sans précédent depuis la deuxième guerre mondiale, puisque les installations hydrauliques du Nord Vietnam avaient été systématiquement visées pendant le conflit de la guerre froide[iv] et qu’encore récemment l’armée américaine a attaqué un barrage sur l’Euphrate contrôlé par DAESH en Syrie[v].
Selon Pierre Rimbert, les Ukrainiens eux-mêmes avaient des plans pour une submersion partielle des lignes de front par le barrage de Kakhovka avant que les troupes russes n’en prennent le contrôle, et de conclure « Détruire des barrages en temps de guerre est hélas si courant que le général ukrainien Andriy Kovaltchouk l’avait lui-même envisagé ». La nouveauté réside sans doute plus dans la présence d’une centrale nucléaire, celle de Zaporijjia, sur la ligne de front et dont le système de refroidissement dépend en partie de la retenue d’eau dudit barrage[vi]. Situation qui me paraît, elle, sans précédent.
Les différence d‘appréciation renvoient, on le comprend aisément, à un campisme exacerbé par la guerre qui tend soit à diaboliser, soit à dédouaner le pouvoir russe. Du côté pro-occidental, on observe un déni généralisé de ses propres responsabilités dans la dérive géopolitique mondiale (néocolonialismes, guerre contre le terrorisme et fiascos en Afghanistan et en Irak, déstabilisation de la Libye, etc.) alors que chez les contempteurs de l’impérialisme américain, on ne veut pas voir combien l’agression de la Russie sur l’Ukraine fait peser une menace sur la paix et la sécurité mondiales hors de proportion avec les enjeux objectifs du conflit.
En essayant de ne céder à aucun a priori, il est difficile également de mesurer les conséquences à moyen et long terme du deuxième événement, le putsch avorté - appelons cela comme ça même si le but de la manœuvre reste incertain - de Prigojine[vii].
Passé le moment de sidération, encore dû à un événement tout autant prévisible que dénié, le recul pris sur l’événement souligne le mécanisme d’emballement des commentaires à chaud. Ici, c’est l’air du « plus jamais rien ne sera comme avant » qui a primé. Or, la probabilité d’un statu quo est sans doute aussi forte que celle d’un basculement[viii]. D’ici six mois on analysera peut-être cette péripétie comme le début de la fin de Poutine[ix] ou comme la simple crevaison d’un abcès[x].
Que nous apprend en effet la marche sur Moscou ?
Rien de fondamentalement nouveau : l’armée russe n’était pas prête pour envahir l’Ukraine, les milices privées ont donc joué un rôle important dans la stabilisation du front, notamment à Bakhmout Ces milices sont alors entrées de plus en plus frontalement en concurrence avec l’état-major régulier. La stabilisation du front rendant moins décisive l’usage de ces forces offensives[xi] et plus urgent le renforcement de l’armée régulière, le pouvoir arbitre alors en faveur de l’état-major d’où la décision d’intégrer les milices dans l’armée régulière, au grand dam de Prigogine, en situation d’être personnellement menacé.
D’où la manœuvre des 23 et 24 juin mettant la pression sur Moscou et lui permettant de dealer une porte de sortie vers Minsk. Ce dernier développement doit être lu comme une tentative de mise en récit après coup, selon une logique qui a peut-être échappé aux acteurs eux-mêmes et qui devra être confirmée par les historiens quand ils auront accès aux sources de cet événement[xii].
L’Etat russe est vermoulu, soit, mais il tient encore, et l’épisode montre que personne – dans les deux camps[xiii] - n’a réellement envie de voir Poutine être remplacé par encore pire que lui, pas même parmi les soutiens qui étaient prêtés à Prigojine au sein de l’armée. L’attentisme affiché de tous les acteurs peut alors être analysé comme un manque d’empressement pour protéger le chef d’Etat en place ou comme le manque de motivation de ses opposants pour le remplacer.
La menace pour l’Etat russe poutinien vient bien des ultra nationalistes et va-t’en-guerre extrémistes, mais elle vient de montrer ses limites. Le peuple russe, quant à lui, ne pourra plus que difficilement croire la propagande de guerre de Poutine, démontée par un de ses rouages les plus engagés[xiv], mais on ne le voit guère se révolter pour autant[xv]. L’incertitude demeure cependant sur le redéploiement partiel des troupes Wagner en Biélorussie et leur potentiel déstabilisateur pour les Etats baltes et la Pologne[xvi]. Jusqu’ici l’axe Washington-Londres-Varsovie a donné le la de la réaction occidentale à l’agression russe en Ukraine et il est difficile de voir comment il va réagir à ce que les Européens de l’Est vivent comme un rapprochement du danger.
Si l’on se penche enfin sur les fondamentaux, dans l’année 2023-2024 qui vient, la capacité, d’abord industrielle[xvii], des deux camps à maintenir un haut niveau d’engagement va être décisive pour le dénouement ou l’enlisement du conflit en Ukraine. Mais la prochaine échéance politique prévue, qui risque de rebattre toute les cartes et d’être un tournant, c’est l’élection présidentielle américaine[xviii]. D’ici-là, le « brouillard de la guerre » risque de nous faire confondre à maintes reprises encore péripéties et points de bascule... et inversement.
[i] Sur les causes structurelles du conflit, voir le billet de blog amplement commenté : Le "Comment" de l’impérialisme occidental et l'Ukraine... | Le Club (mediapart.fr) Sur les jours qui ont précédé l’attaque, tout le monde se souvient sans doute de cette ambiance où la logique disait « c’est possible » en même temps que les mécanismes de défense psychologiques mettaient un bandeau sur les yeux.
[ii] Les digues de l’indignation, par Pierre Rimbert (Le Monde diplomatique, juillet 2023) (monde-diplomatique.fr)
[iii] Guerre en Ukraine : « La destruction du barrage de Kakhovka marque un tournant dans les guerres du XXIᵉ siècle » (lemonde.fr)
[iv] Daniel Hubé souligne également le point de bascule de la guerre du Vietnam et l’invention du terme écocide qui lui est associé : Guerres du XXᵉ siècle : une histoire de rupture entre l’humain et son environnement (theconversation.com)
[v] Pierre Rimbert cite le New York Times comme source. En français, j’ai trouvé cette référence : Crainte d'une grande inondation après le bombardement du plus grand barrage de Syrie (europe1.fr)
[vi] Ukraine : conséquences de l’endommagement du barrage de Kakhovka sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhya | IRSN
[vii] La Une de Mediapart du 24/06/2023
[viii] Voir l’article tout en nuances de Justine Brabant : Après son putsch raté, le sort incertain du groupe Wagner | Mediapart
[ix] Michel Eltchaninoff : « Tout le régime de Poutine est menacé » | Mediapart
[x] (1203) Emmanuel Todd : Wagner et Prigojine, le début de la guerre en Russie ? - YouTube
[xi] L’hypothèse d’un retrait total du Groupe Wagner d’Ukraine, un risque mesuré pour Moscou (lemonde.fr)
[xii] Natacha Polony : "Sur la Russie, ceux qui prétendent savoir sont des baltringues" (marianne.net)
[xiii] Les Européens s’inquiètent des fragilités russes révélées par la rébellion avortée d’Evgueni Prigojine (lemonde.fr)
[xiv] (1209) MUTINERIE DE WAGNER, LE DÉBUT DE LA FIN POUR POUTINE ? - YouTube
[xv] (1209) Que pensent les Russes de la guerre en Ukraine ? - Ksenia Bolchakova | ARTE - YouTube
Dans le coeur de la Russie secoué par la mutinerie de Wagner (msn.com)
[xvi] L’arrivée des mercenaires de Wagner en Biélorussie inquiète les pays baltes et la Pologne (lemonde.fr)
[xvii] (1203) Emmanuel Todd : Wagner et Prigojine, le début de la guerre en Russie ? - YouTube
[xviii] La tragédie et la farce : l’hypothèque Trump sur les États-Unis et le monde | Mediapart