Il s'agit de ma thèse doctorale soutenue au CERI, Sciences Po Paris en 2020. Lors du dépôt de thèse, j'ai choisi l'option de ne pas publier en ligne la version digitale. Donc les deux volumes de thèse ont resté silencieusement dans la bibliothèque de Sciences Po depuis la date de dépôt.
Récemment j'ai fait une visite d'expositions avec deux anciens amis du milieu de l'art contemporain chinois au quartier 798, le fameux district d'art contemporain à Beijing. Ce passage rapide dans un milieu qui m'avait été familier me fait réfléchir sur certains débats virulents dans le monde de l'art en France à la fin des années 1990. J'ai ressenti quelque besoin de m'exprimer, en retournant d'abord à mes recherches doctorales, pour poser ma propre question sur la modernité chinoise : une conviction de plus en plus confirmée sur les modernités en pluriel.

Agrandissement : Illustration 1

Dans le consensus occidental, la revendication de la liberté d’expression par l’action constitue un élément crucial pour déterminer la valeur de l’avant-garde chinoise. C’est ainsi que le groupe des Étoiles (星星画会) – qui manifesta publiquement sur l’avenue Chang’an en octobre 1979 pour revendiquer la liberté d’expression – est considéré comme les premiers artistes d’avant-garde chinois, même s’il s’agissait d’amateurs d’art dont les œuvres présentaient une forte hétérogénéité : certaines créations furent audacieuses tandis que d’autres se révélèrent plutôt conventionnelles, voire traditionnelles.
Cette perception militante sur l’avant-garde chinoise hantait encore le milieu de l’art en Chine pendant les années 1980. Les jeunes artistes au sein du système de l’art officiel déclenchèrent donc les mouvements de 85 pour établir leur propre légitimité en tant qu’artistes d’avant-garde. Or, les critiques de l’imitation de l’art moderne occidental placèrent ces artistes dans une situation délicate : la question de l’originalité mise en cause, les artistes issus des écoles des beaux-arts se confrontèrent au dilemme moral que les artistes des Étoiles avaient vécu, c’est-à-dire la prise de position entre l’autonomie de l’art et l’engagement politique.
D’un côté, l’originalité artistique des mouvements de 85 fut contestée, mais de l’autre côté, le désir de conciliation avec le système de l’art officiel était toujours présent, les artistes d’avant-garde issus du système de l’art officiel se trouvaient donc dans une difficulté permanente pour établir leurs propres critères d’évaluation.
C’est finalement à l’occasion de l’exposition China/Avant-garde en février 1989, et précisément à travers une série de circonstances et d’incidents simultanés, que l’avant-garde chinoise reprit sa position militante et établit sa reconnaissance internationale, grâce à l’environnement politique international spécifique de la fin des années 1980.
Dans la première partie consacrée aux transformations du champ artistique chinois dans les années 1980, nous allons retracer la piste que nous venons de présenter, pour décrypter les logiques d’action et les mentalités des artistes d’avant-garde chinois dans les conditions sociopolitiques changeantes de cette décennie. L’intérêt consiste à mettre en scène un dilemme moral auquel les artistes chinois durent se confronter tout au long de la décennie, c’est-à-dire un choix éthique entre l’enfermement dans l’univers spirituel d’un côté et l’expression publique de l’engagement politique de l’autre côté. La position militante de la notion d’avant-garde, incarnée dans le groupe des Étoiles, incitait le milieu de l’art chinois à revendiquer l’esprit critique. Cependant, les rapports étroits entre le champ artistique et le champ politique obligèrent les artistes chinois à renoncer à toute possibilité de provocation politique. Ils se trouvèrent donc dans ce que le groupe des Étoiles avait vécu comme une condamnation de la personnalité « schizophrénique ».
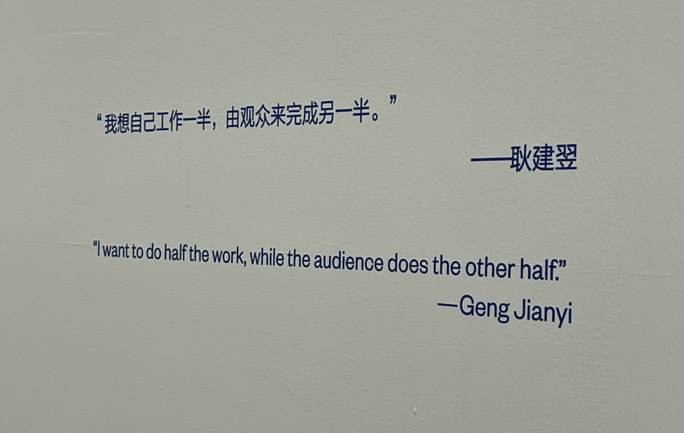
Agrandissement : Illustration 2
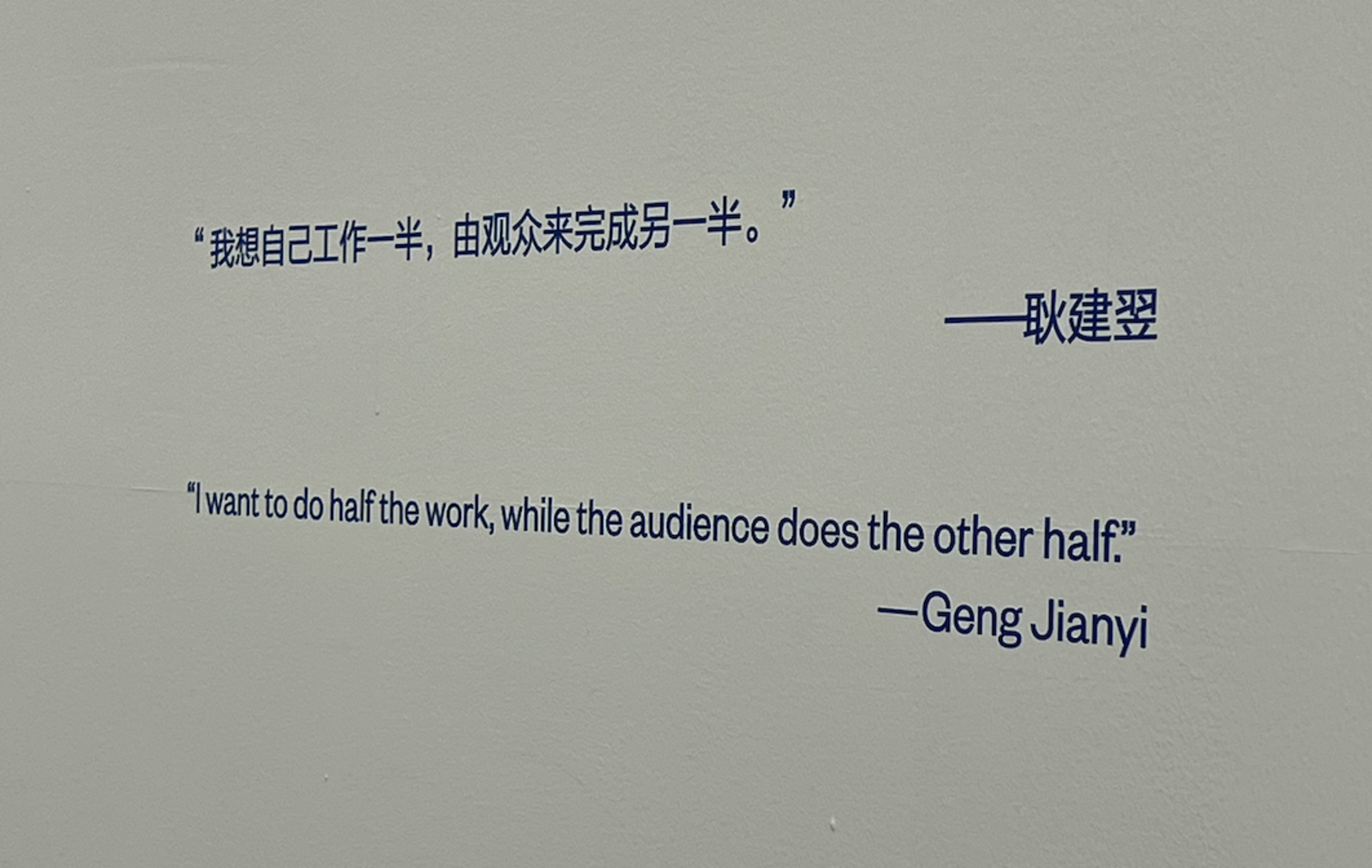
Dans cette première partie, nous allons également démontrer certaines caractéristiques géographiques dans les transformations du champ artistique en Chine. Les principales écoles des beaux-arts situées dans plusieurs provinces jouèrent alors un rôle déterminant dans les mutations du système de l’art officiel. Pendant les années 1980, les ressources pédagogiques, les conditions socioculturelles et politiques, ainsi que le degré de l’ouverture des régions pouvaient tous avoir un impact considérable sur l’enseignement artistique, jusqu’à pouvoir laisser une empreinte durable sur la démarche des artistes. C’est ainsi que nous constatons que les premiers germes de l’émancipation du système de l’art officiel eurent lieu dans la province reculée du Sichuan (dans le centre du pays), tandis que la province du Zhejiang (dans l’est du pays) devint le foyer des mouvements de 85 grâce à son ouverture et à sa richesse documentaire. Les villes principales comme Beijing, Chengdu et Hangzhou, qui possédaient une école des beaux-arts, établirent ainsi la structure géographique du champ artistique de la Chine des années 1980.
Enfin, nous allons aussi étudier les rapports de force au sein des artistes d’avant-garde des années 1980, pour démontrer la spécificité du contexte socioculturel chinois dans lequel les valeurs individualistes – régime de singularité – semblaient s’intégrer et se reconnaître difficilement. Du rejet de l’expression de soi du groupe des Étoiles au rôle destructeur de la performance dans l’exposition China/Avant-garde en 1989, nous voulons donner un éclairage sur le fondement moral sous-jacent du champ artistique à cette période, pour mettre en scène la confrontation entre les différentes lois morales qui régissaient non seulement les comportements, mais aussi les jugements des artistes d’avant-garde chinois envers leurs pairs d’un côté, et de l’autre côté, les situations complexes où ils se trouvaient.
(Tous droits réservés)



