Comparés aux artistes indépendants qui devaient se débattre pour obtenir les soutiens institutionnels et accéder aux canaux de diffusion, les jeunes artistes au sein du système officiel de l’art semblent se trouver dans un statut beaucoup plus privilégié. L’entrée dans les écoles des beaux-arts par concours nationaux signifie une reconnaissance sociale importante. C’est pourquoi ces jeunes artistes, appuyés par leur virtuosité technique, n’aspiraient pas à un renouvellement radical du langage artistique, ni à une quête de l’originalité. Ils s’attachaient volontairement aux sentiers battus de la représentation réaliste, mais en y apportant des modifications stylistiques pour ramener les expressions émotionnelles et sentimentales dans le système de l’art officiel.
À part la jeune génération d’artistes, certaines personnalités du milieu de l’art jouèrent également un rôle déterminant en réintroduisant l’art abstrait dans le champ artistique. Ces émancipateurs au sein du système de l’art officiel étaient aussi plus « habiles » à négocier avec les acteurs administratifs et les représentants du pouvoir pour insérer les nouvelles expressions dans l’administration artistique, comme les concours nationaux et l’enseignement des beaux-arts, permettant ainsi aux anciens critères d’évaluation de se renouveler et à la notion d’art de s’étendre.
Enfin, il est également intéressant de constater que les premières tentatives de l’émancipation au sein du système de l’art officiel - le retour aux émotions - ne provenaient pas de grandes villes ou d’écoles des beaux-arts prestigieuses. Au contraire, c’est dans certaines régions reculées où les ressources artistiques pédagogiques étaient moins compétentes qu’on trouva le désir le plus ardent pour se libérer des carcans idéologiques de l’art officiel.
Certains acteurs officiels innovants qui, étant à la fois artistes et fonctionnaires de l’administration artistique, réussirent à jouer avec des ressources limitées pour compenser l’impéritie de la pédagogie locale. La disposition géographique des ressources artistiques est un élément récurrent dans nos études sur les transformations du champ artistique en Chine. Nous allons encore l’observer dans les décennies suivantes.

Le relâchement dans les académies des beaux-arts : Le Sichuan, un contexte prêt pour la « nouveauté »
Ne ressemblant pas aux artistes indépendants qui devaient constamment défendre leur créativité, les artistes issus du système de l’art officiel semblaient ne pas souffrir autant d’obligations morales pour se justifier : ils n’avaient pas besoin de légitimer leur statut d’artiste pour établir des liens avec les institutions artistiques ; l’autonomie de l’art ne constituait pas davantage un problème pour eux, puisque leur accès aux écoles des beaux-arts par le concours national semblait déjà garantir préalablement leur « autonomie », c’est-à-dire une sorte d’autonomie au niveau du langage plastique. Leurs rapports aux contraintes institutionnelles et idéologiques se révélèrent de manière plus discrète, comme dans un jeu du chat et de la souris.
Les artistes entrés dans le système de l’art officiel se concentrèrent davantage sur le renouvellement du langage plastique pour modifier doucement les standards de l’art officiel. Loin de revendiquer une totale liberté d’expression comme dans le cas des artistes indépendants, ils comprirent l’émancipation comme un processus de transformation progressive pour instaurer un certain degré de liberté – certes limitée –, tout en sachant qu’il faudrait du temps pour le réaliser. Le cas de l’Académie des beaux-arts du Sichuan (centre de la Chine) constitue un excellent exemple des premières tentatives de jeunes artistes pour briser la rigidité des standards de l’art officiel.

Agrandissement : Illustration 2

Dans le système de l’art officiel, participer aux concours nationaux organisés par l’Association des artistes est, pour un artiste, le seul chemin pour acquérir la reconnaissance artistique et sociale. En dehors de ce système, il n’existait quasiment pas de canaux pour se faire légitimer au début des années 1980. Dans une volonté de se faire remarquer, quelques étudiants de l’Académie des beaux-arts du Sichuan lancèrent leurs premières tentatives. Il s’agit donc de l’émergence de deux nouveaux courants de peinture qui ébranlèrent pour la première fois l’immobilisme de l’art officiel : la peinture des cicatrices (伤痕美术)[1] et la peinture naturaliste (乡土绘画)[2]. Certaines modifications de styles ou de manières de représentation, toujours aux confins du réalisme, suffirent à être considérées comme des gestes d’« innovation ».
Pour l’historien d’art , les raisons pour lesquelles les premières tentatives d’émancipation eurent lieu dans une école d’art située dans une région reculée comme le Sichuan, plutôt que dans des écoles d’art prestigieuses comme l’Académie centrale des beaux-arts de Beijing ou l’Académie nationale des beaux-arts de Hangzhou, s’expliqueraient par l’environnement local spécifique de l’école d’un côté, et de l’autre côté, par l’histoire propre de l’établissement. L’environnement particulier de la région, comme la géographie et la culture ethnique locale, favorisa la mise en contact de l’intimité des artistes avec la nature et de l’imagination. L’école avait aussi conservé une forte tradition de l’enseignement de la peinture à l’huile, principalement réaliste. Dans les années 1980, nombre d’artistes actifs – essentiellement des peintres – sur la scène artistique en Chine étaient diplômés de l’Académie des beaux-arts du Sichuan, de sorte qu’on les appelle souvent le « camp du Sichuan » (川军).
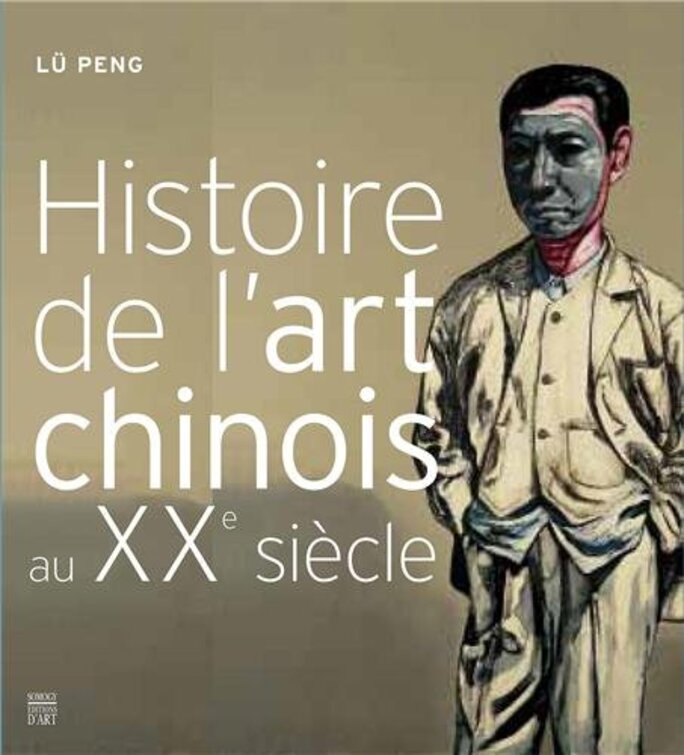
Cependant, Wang Lin (王林), critique d’art et professeur de cette école, donna une explication complémentaire sur l’émergence des peintres du Sichuan dans les années 1980. Selon lui, ce phénomène a eu pour origine l’absence de grands maîtres dans l’histoire de l’enseignement de l’établissement. Alors que les élèves des beaux-arts de Beijing ou de Hangzhou pouvaient s’enfermer dans des ateliers pour pratiquer les techniques de base avec l’aide de leurs enseignants qui étaient eux-mêmes des artistes connus, l’Académie des beaux-arts du Sichuan ne pouvait qu’encourager ses étudiants à sortir des salles de classe pour puiser leur inspiration dans la nature. Cette solution reçut pourtant un effet très positif et devint même un modèle d’enseignement à suivre par d’autres écoles des beaux-arts chinoises à cette époque.
Une autre raison pourrait également expliquer la flexibilité de l’enseignement de l’Académie des beaux-arts du Sichuan : l’absence des ressources documentaires. Du fait de l’isolement de la région avec le monde extérieur, la bibliothèque de l’école n’offrait, à part quelques ouvrages sur la Renaissance et l’impressionnisme, que très peu de documentation sur l’art moderne et contemporain occidental. Zhang Xiaogang (张晓刚), peintre diplômé de cette école, se souvient de l’atmosphère de la bibliothèque lorsque l’un des premiers ouvrages sur l’histoire de l’art occidental du 20e siècle, publié par une maison d’édition japonaise, fut introduit. Pour répondre aux besoins ardents de consultation, le volume fut présenté dans une vitrine en verre dans la salle de la bibliothèque. On tournait chaque jour une page pour que l’ensemble des étudiants puisse accéder au contenu. La pénurie de documentation exigeait donc de la direction de l’école qu’elle mobilise toutes les ressources disponibles, y compris aller dans la nature, pour motiver la créativité des jeunes artistes.
Le cas de l’Académie des beaux-arts du Sichuan démontre un aspect intéressant dans la transformation institutionnelle du système de l’art officiel en Chine. La compétition au sein de ce système, entre ses établissements d’enseignement supérieur, donne souvent une force mobilisatrice pour permettre l’émancipation. Il faut encore noter que le manque de ressources a eu un effet à double tranchant : ce fut à la fois une contrainte pour développer l’enseignement, et un élément catalyseur des nouveaux changements. C’est ainsi que la peinture des cicatrices et le courant naturaliste émergèrent d’abord à l’Académie des beaux-arts du Sichuan.
Le retour à l’être humain
Un point commun de la peinture des cicatrices et de la peinture naturaliste consiste dans le retour de la représentation picturale à la description des êtres humains dans leur état réel, pathétique et spontané. Cette tendance a eu pour effet de défier les critères idéologiques de l’art de la propagande. La peinture des cicatrices apparut d’abord à la fin des années 1970 en concomitance avec l’émergence de la littérature des cicatrices qui était alors en vogue, comme un prolongement de réflexions post-Révolution culturelle sur le trauma du peuple. Tandis que la peinture naturaliste, issue d’un état d’esprit plus romantique et parfois nostalgique, gagna rapidement une plus grande influence dans le milieu de l’art par son style esthétisant et son optimisme sur le destin commun des êtres humains, notamment par la représentation des minorités ethniques. Après une courte durée de la peinture des cicatrices en vogue au début des années 1980, la peinture naturaliste suscita ensuite nombre d’imitations dans le milieu de l’art en Chine, jusqu’au point de devenir un nouveau type d’« art officiel ».
Ces deux courants de peinture ont pris leur origine dans le contexte socioculturel post-Révolution culturelle, comme une réplique au contrôle idéologique. Sensibles au changement social, certains jeunes artistes lancèrent alors leurs premières initiatives pour briser les anciens standards de l’art officiel. Gao Xiaohua (高小华), né en 1955, avait travaillé comme journaliste et photographe pour le Journal de l’Armée populaire de Libération (《解放军报》) avant d’entrer à l’Académie des beaux-arts du Sichuan en 1978. Ayant fréquenté des descendants de dirigeants et de militaires de haut rang dans le journal, Gao Xiaohua regardait le passé avec un œil plus sceptique et critique. Dans l’école des beaux-arts, il conçut un tableau représentant plusieurs jeunes gardes rouges, blessés, assis par terre, regards perdus et visages confus, tous ayant une expression de perplexité. Ce tableau devait participer au concours national de l’Association des artistes de 1978. En raison de la procédure de sélection, c’est-à-dire que les élèves devaient d’abord soumettre leur projet de dessin au comité du concours, avant d’obtenir les matériaux pour mener leur travail à bien, Gao Xiaohua fut refusé dès le premier tour de compétition, du fait que sa manière de représenter les personnages, fidèle aux émotions réelles des personnages, avait suscité l’inquiétude des membres du jury qui avaient peur des risques politiques.

Gao Xiaohua ne fut pas le seul étudiant qui tenta de s’interroger sur le passé avec un sens aigu de la critique. Nombre de dessins rappelant les souvenirs traumatisants de la Révolution culturelle furent aussi « censurés ». Cette atmosphère frileuse dominait encore le système de l’art officiel à la fin des années 1970. Li Xianting, alors jeune critique d’art et rédacteur pour la revue officielle Beaux-arts, découvrit par hasard le dessin de Gao Xiaohua et le publia dans sa revue. Le critique d’art y perçut les signes des premières réflexions critiques de la future génération d’artistes. Selon lui, ce fut un des premiers tableaux qui a osé se confronter à une période problématique en s’approchant « de la vérité et de la nature humaine[3] ». Cette publication encouragea Gao Xiaohua à exécuter le tableau à ses propres frais pour participer au concours national de 1979. Avec la détente sociale, cette peinture intitulée Pourquoi (《为什么》) remporta finalement la médaille d’argent et fut présentée à l’occasion de l’exposition commémorative du 30e anniversaire de la Chine populaire. Le courant de la peinture des cicatrices fut ainsi justifié[4], avec Gao Xiaohua comme un de ses premiers initiateurs.
Au début des années 1980, toute la société chinoise semblait s’imprégner d’un environnement aspirant à l’émancipation. Cependant, au niveau administratif, les contraintes idéologiques s’imposaient toujours en émettant des restrictions dogmatiques à la volonté de recherche de la liberté des artistes. Pour résister aux mesures de contrôle, les jeunes artistes au sein du système de l’art officiel élaborèrent alors une tactique habile pour repousser plus loin les frontières de leur création. Le cas du tableau Le Père (《父亲》) de l’artiste Luo Zhongli (罗中立) en donne une belle démonstration.
En 1980, le tableau Le Père participa au concours annuel de l’Association nationale des artistes, en suscitant des débats virulents au sein du jury. Luo Zhongli, alors étudiant à l’Académie des beaux-arts du Sichuan, présenta le portrait d’un vieux paysan d’une taille impressionnante de 2.16 mètres de long et de 1.52 mètre de large, soit le format du portrait pour les grandes personnalités politiques. Inspiré par la peinture hyperréaliste américaine dont un cliché dans un journal était tombé sous ses yeux, Luo Zhongli mit en relief les détails du visage de l’homme de la campagne d’une manière extraordinairement précise : les rides soigneusement peintes, l’épreuve du temps et la misère de la vie avaient été minutieusement rendues.

Ce format spectaculaire avait sans doute eu pour effet de défier les règles du portrait destiné aux dirigeants. Néanmoins, Luo Zhongli avait intitulé son tableau Le Père pour suggérer son respect et sa solidarité envers les gens les plus ordinaires. Le jury se trouva donc dans l’incapacité de déterminer si c’était un « bon » ou un « mauvais » tableau. Au début des années 1980, les critères d’évaluation s’incarnaient encore dans les anciens dogmes valorisant le socialisme progressiste. La représentation d’un vieux paysan avec des rendus précis risquait de suggérer, dans l’interprétation idéologique, les conditions misérables d’une société sous-développée. Pour que le tableau soit « présentable », certains responsables de l’Association des artistes proposèrent à l’artiste d’apporter quelques modifications, par exemple en y rajoutant un stylo. Avant 1949, comme la plupart des Chinois étaient analphabètes, le stylo était le symbole d’un homme cultivé et était rarement vu dans la vie quotidienne du grand public. Mais depuis les années 1950, même les gens qui ne savaient pas lire portaient également un stylo dans la poche avant de leur costume par vanité. Une telle modification, apportée par la présence de cet instrument d’écriture dans le portrait, a pu donc faire penser à un paysan « cultivé », mieux considéré, plus convenable pour évoquer une société évoluée. Cette adaptation presque inaperçue « perfectionna » le tableau et le légitima auprès du jury. Finalement, le tableau remporta le premier prix du concours national avec les félicitations unanimes de la part des personnalités du milieu de l’art.
À la différence des artistes indépendants qui s’opposaient au système de l’art officiel, les artistes issus du milieu académique adoptèrent une position beaucoup plus flexible envers les contraintes administratives et idéologiques. Le stylo ultérieurement rajouté suggère un arrangement – sinon un « compromis » – avec les acteurs officiels. Ce genre de « compromis » a activement contribué à façonner le système de l’art officiel en modifiant implicitement les critères d’évaluation déjà établis. À travers le concours national, la « nouveauté » apportée par les jeunes artistes de l’Académie des beaux-arts du Sichuan fut rapidement valorisée et se propagea dans le milieu de l’art. Jiang Feng, alors président de l’Association nationale des artistes, voulut même faire du modèle du Sichuan un exemple d’excellence à reproduire par les autres établissements d’enseignement des beaux-arts, pour inciter les élèves à s’inspirer et à reconsidérer leur liberté artistique par le biais de la nature.
Le cas du Sichuan donne une démonstration typique des transformations du système de l’art officiel. Du point de vue du contexte social, l’absence de ressources matérielles est paradoxalement devenue une motivation pour ébranler les cadres rigides de l’art officiel, tandis que l’audace de certains artistes ne fit que renforcer l’élan d’émancipation contre les contraintes administratives. Cependant, la « nouveauté » apportée par les jeunes artistes fut relative, du fait que le système de l’art officiel au début des années 1980 était encore imprégné de l’atmosphère post-Révolution culturelle, c’est-à-dire une période pleine de contradictions entre la recherche de la liberté individuelle et la condamnation de toutes sortes de manifestations individuelles jugées « sensibles ».

Agrandissement : Illustration 6

La représentation des émotions et des sentiments dans les deux courants de peinture initiés par les artistes au sein du système de l’art officiel est principalement véhiculée par une vision pathétique et romantique sur le passé historique d’un côté, et de l’autre côté, sur la campagne considérée comme le symbole de la régénération. Cette émancipation au niveau sentimental se dégage également dans la série des tableaux Le Tibet de l’artiste Chen Danqing (陈丹青), un des représentants éminents de la peinture naturaliste. Étudiant de l’Académie centrale des beaux-arts de Beijing, inspiré par les manières de représentation des peintres français comme Courbet, Corot et Millet, Chen Danqing réalisa en 1980 la série du Tibet (《西藏组画》) dans laquelle les expressions de jeunes femmes et hommes issus de minorités ethniques furent décrites dans leur plus fine spontanéité, constituant ainsi un jalon décisif dans l’histoire de la peinture contemporaine en Chine, c’est-à-dire une transition du modèle soviétique vers une manière de représentation plus classique et humaniste. Cette série bénéficia d’une estime très élevée de la part de ses pairs du milieu de l’art et du grand public, applaudie en quelque sorte comme un travail de cristallisation de la société chinoise dans son état d’ouverture au début des années 1980.
[1] La peinture des cicatrices désigne une tendance de peinture à l’huile apparue après la Révolution culturelle – c’est-à-dire à la fin des années 1970 – dans le milieu académique des beaux-arts en Chine. Comparée aux courants de peinture précédents qui furent censés décrire des thèmes révolutionnaires et héroïques, la peinture des cicatrices s’intéressa à la description de l’aspect pathétique et compatissant de la réalité quotidienne, en accordant la priorité de la représentation aux personnages ordinaires. Cette tendance de création fut également apparue dans la littérature de cette époque qu’on appelle la littérature des cicatrices (伤痕文学).
[2] La peinture naturaliste est un courant de peinture à l’huile apparu vers la fin des années 1970 dans le milieu académique des beaux-arts en Chine, en parallèle de la peinture des cicatrices. Pour se débarrasser des carcans idéologiques qui avaient dirigé la création artistique dans le réalisme socialiste, certains artistes s’inspiraient de paysages ruraux et de la vie des ethnies pour proposer un style de peinture réaliste et figuratif, caractérisé par la simplicité et un certain primitivisme dans les expressions.
[3] Yongqing YE (叶永青). « Jilu 1980 he 1990 niandai de zhongguo dangdai yishu » [La création entre les années 1980 et 1990] (《记录1980和1990年代的中国当代艺术》), le 9 août 2013. Disponible sur : http://news.99ys.com/index.php?m=content&c=index&a=app_view&id=138078 [consulté le : 15 avril 2014].
(Tous droits réservés)



