Michael Sullivan, historien de l’art américain et spécialiste de l’art chinois, publia en 1980 un article intitulé A Review of Art in China since 1949 and a Look at the Future[1]. L’auteur y évoqua un nouveau phénomène dans la société chinoise : l’émergence d’une nouvelle élite sociale composée d’intellectuels et d’artistes qui prenaient une distance de plus en plus grande avec le grand public, celui-ci composé principalement de paysans non cultivés. La création artistique pourrait bénéficier de ce groupe d’élite, selon Sullivan, tandis que l’écart entre les classes sociales et l’élite artistique constituerait un danger pour l’utopie révolutionnaire des dirigeants chinois. Les propos de l’historien de l’art donnèrent un éclairage pour mieux comprendre le contexte des débats du début des années 1980 dont l’intérêt portait sur la question de l’expression de soi, proposée d’abord par les artistes indépendants.
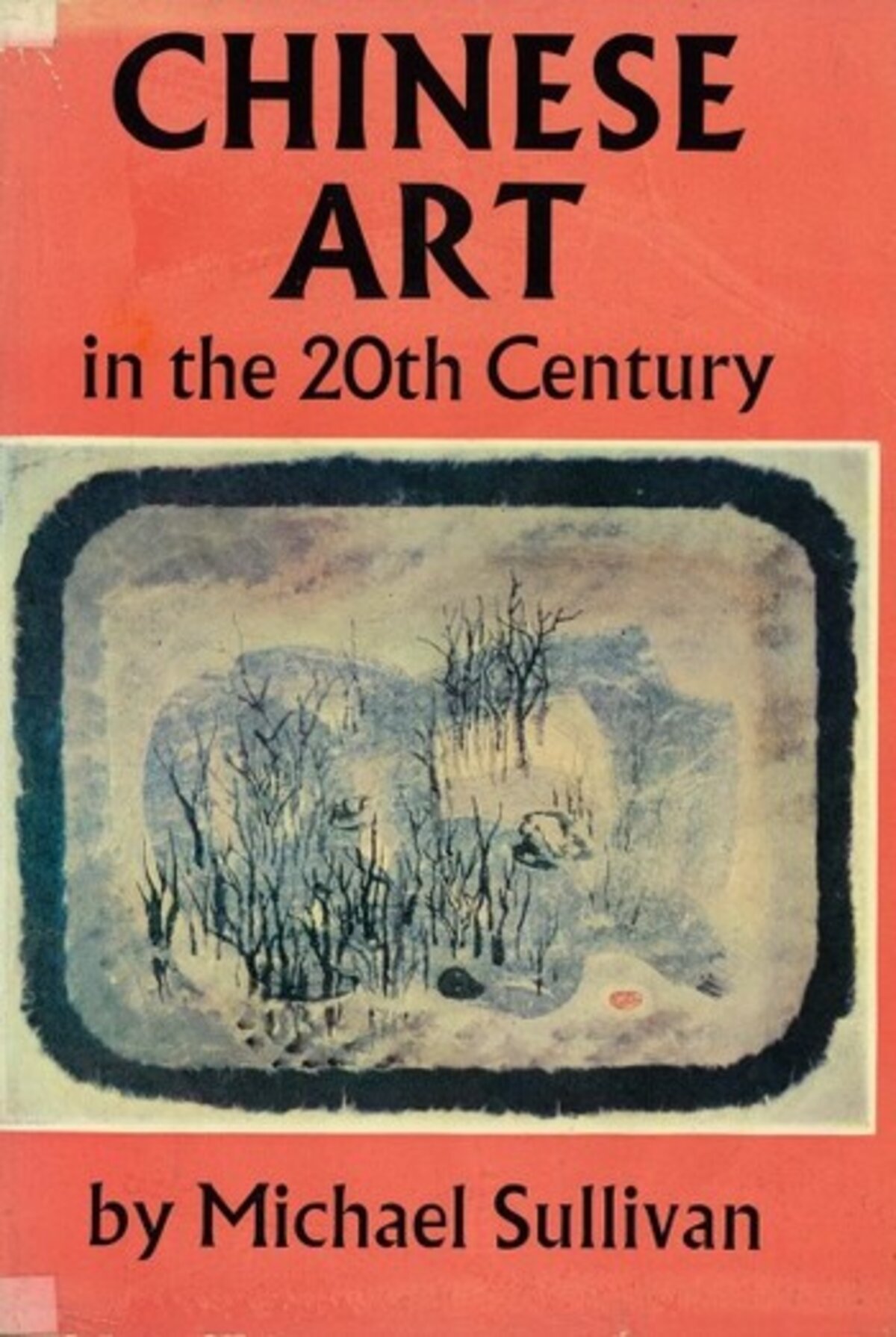
Les débats se déployèrent dans les numéros de la revue officielle Beaux-arts sous forme d’échanges d’articles entre deux camps. En fait, cette polémique sur la pertinence de l’expression de soi dans l’évaluation des créations des jeunes artistes dévoila les conditions socioculturelles spécifiques du pays où l’individualité demeurait une notion vague avec des projections variées dans les mentalités des membres sociaux. Lorsque la volonté des artistes d’avant-garde de se faire remarquer heurtait la sensibilité du grand public, celui-ci recherchait encore des formes d’art faciles d’accès, et l’État n’arrivait pas à coordonner les rapports complexes entre l’élite artistique et les classes sociales. Les débats sur l’expression de soi cristallisèrent ainsi cette impasse tout en dévoilant une question fondamentale sur la définition de l’individualité dans la société chinoise, celle-ci imprégnée depuis longtemps d’une idéologie collectiviste.
L’expression de soi est une revendication qui fut d’abord proposée par le groupe des Étoiles comme le critère d’évaluation de leur création. La deuxième exposition du groupe des Étoiles, organisée en 1980 à la Galerie nationale des beaux-arts de Beijing, avait réussi à établir la réputation des artistes indépendants dans le système de l’art officiel. Les membres des Étoiles furent rapidement sollicités par les écoles d’art pour donner des conférences sur leurs idées artistiques. La fascination des jeunes étudiants en art témoigna de la force d’influence des artistes indépendants. L’expression de soi devint ainsi une notion susceptible de mobiliser la jeune génération d’artistes dans leur future évaluation des créations artistiques. Cependant, l’accent mis sur le rôle de l’individualité suscita également le mécontentement de certains acteurs au sein du système de l’art officiel, ceux-ci affirmant encore leur conviction que l’art devrait être au service du grand public. Des reproches s’élevèrent au sein du milieu de l’art pour contester la pertinence de l’expression de soi. Certains acteurs clés du système de l’art officiel, y compris des personnalités ayant un esprit relativement ouvert, affichèrent cependant une attitude plutôt réservée.

Agrandissement : Illustration 2

Les reproches sur l’expression de soi consistaient en deux points : d’abord, idéologiquement, l’expression de soi s’oppose aux valeurs d’une société socialiste ; puis, au niveau pragmatique, l’expression de soi se détache de la sensibilité du grand public, risquant ainsi de bouleverser l’accès du grand public à l’art. En fait, dans la réception par le grand public de la création du groupe des Étoiles, on avait également constaté des voix discordantes. Ainsi, lors de la 2e exposition du groupe des Étoiles dans la Galerie nationale des beaux-arts, nombre de visiteurs s’étaient plaints de ne pas arriver à comprendre les œuvres exposées, et certains avaient même accusé les artistes de présenter des tableaux empreints de perversité comme des scènes « dissolvantes »[2]. En plus, certains critiques d’art, malgré leur esprit plus ouvert, avaient alors jugé que l’individualisme incarné dans la création du groupe des Étoiles risquait de pousser l’expression de soi au-delà du bon fonctionnement du système de l’art officiel, c’est-à-dire la priorité portée à la pédagogie artistique au grand public[3].
Il s’agissait en fait d’un affrontement entre l’art d’élite et le besoin des classes sociales. Dans le contexte spécifique de la Chine du début des années 1980, les artistes étaient considérés, par la société et par eux-mêmes, comme ayant un double rôle : celui d’émancipateur et celui de pédagogue. Cependant, ce double rôle se révéla paradoxal, notamment pour les artistes indépendants. À l’origine amateurs d’art, les artistes indépendants avaient tenté de s’associer au grand public pour défier l’esprit d’élite du système de l’art officiel. Or, au nom de la liberté individuelle, ils avaient aussi emprunté à l’art moderne occidental pour s’affirmer et se valoriser, mais ce langage pictural dépassa les capacités de réception du grand public. La revendication de l’individualité créa ainsi une situation embarrassante en Chine.

Agrandissement : Illustration 3

L’impasse des artistes indépendants
La Chine de la fin des années 1970 faisait face aux difficultés du déséquilibre économique et de la disproportion des industries lourdes, tandis que le problème de l’emploi pour la population urbaine et les jeunes instruits revenus en ville devenait de plus en plus urgent pour les autorités. La montée des réformistes au sein du pouvoir depuis la fin des années 1970 permit l’apparition de débats sur le principe de l’économie planifiée dans l’espace public. Cependant, pour longtemps, la légitimation de l’économie marchande resta un sujet sensible, puisque certains dirigeants politiques et nombre de gouverneurs locaux s’y opposaient. C’est ainsi qu’entre 1982 et 1983, les économistes qui avaient promu la libéralisation économique furent attaqués, accusés d’avoir propagé une forme de pollution spirituelle dans le milieu économique.
À côté des luttes de position sur l’économie marchande, les débats sur l’altérité émergèrent aussi à partir de 1979, initiés par certains auteurs influents du milieu intellectuel et culturel[4]. Ils s’interrogèrent sur la notion de modernité dans le contexte chinois, avec beaucoup d’interprétations variées et floues. Au début de 1983, les débats sur l’altérité en arrivèrent jusqu’au point de mettre en cause les rapports entre l’individu et l’État, en se transformant rapidement en divergence au sein du pouvoir politique[5]. La direction du Parti fut contestée et déstabilisée par son propre discours contradictoire sur le contrôle de l’espace public et l’orientation économique, ce qui créa des risques de déstabilisation dans l’espace social. Faute de moyen efficace de communication et de compromis, le pouvoir central en fut réduit à durcir le ton en prenant des mesures de contrôle renforcé dans le milieu culturel. À la fin d’avril 1983, une pièce de théâtre sur l’histoire du Parti communiste fut censurée, en déclenchant ainsi le mouvement de lutte contre la « pollution spirituelle » (反精神污染)[6]. Cette campagne idéologique régressive toucha la vie sociale, et découragea en particulier les tendances au mode de vie individualiste. Par exemple, les jeunes gens qui portaient des pantalons à la mode, ou gardaient les cheveux longs, devinrent cibles d’attaque ; les chansons de Teresa Teng furent interdites et nombre de livres censurés ; certains jeunes hommes soupçonnés d’agressions sexuelles furent même condamnés à mort. La liberté individuelle et la culture occidentale furent ainsi sévèrement attaquées, et le « libéralisme bourgeois » devint une notion suspecte dans l’espace public chinois.

L’impact du mouvement de lutte contre la « pollution spirituelle » ne tarda pas à se diffuser dans le milieu de l’art. Au début de 1984, la revue officielle Beaux-arts publia un article reprochant à l’émancipation pour contrôler l’ambiance du système de l’art officiel : « Certains camarades ont mal compris la liberté de la création, en la confondant avec le libéralisme bourgeois. Ces gens ont promu les propos valorisant la nature humaine, les valeurs de l’être humain, l’expression de soi et une notion d’art transcendant les classes sociales et le pouvoir politique, et ils ont beaucoup imité l’art occidental. Leurs œuvres sont ainsi apparues au cours des dernières années avec des thèmes qui ne sont pas sains et des formes aberrantes que le grand public n’arrive pas à comprendre. Il s’agit bien là de ‘pollution spirituelle’.[7] » C’est dans un tel climat que le 6e concours de l’Association nationale des artistes eut lieu en 1984, avec une forte tendance à la régression. Plus grand concours depuis la fondation de la Chine populaire en 1949, le 6e concours présenta nombre de productions banales, évoquant de forts signes idéologiques, ainsi que des tableaux similaires imitant le style des cicatrices et la peinture naturaliste, annonçant de manière précoce le déclin de ces deux courants qui avaient marqué une sorte de nouveauté du système de l’art officiel.
L’un des impacts du mouvement de lutte contre la « pollution spirituelle » fut la fermeture de l’espace public aux artistes indépendants. Les trois principaux membres du groupe des Étoiles, Huang Rui, Ma Desheng et Wang Keping, furent désormais interdits d’exposer leurs créations en Chine, leur inscription à l’Association nationale des artistes étant même inutile. En ayant perdu leur statut légitimé et la protection du système officiel, les artistes indépendants n’eurent plus d’accès aux canaux de diffusion. Leurs contacts fréquents avec les étrangers les amenèrent à se trouver sous la surveillance de la police, ce qui fragilisa davantage leur place dans la société chinoise. Nombre d’artistes indépendants partirent à l’étrange : Huang Rui partit au Japon en 1984, Wang Keping se rendit à Paris la même année, et Ma Desheng s’installa en France depuis 1986. Pour ceux qui restaient, une partie entre eux se rassembla dès lors dans des appartements privés pour s’échanger et s’exposer en adoptant une position clandestine.

Conclusion
De la fin des années 1970 au début des années 1980, le champ artistique en Chine vécut ses premières mutations qui avaient permis au système de l’art officiel d’introduire de nouvelles formes d’expression et de nouveaux concepts d’art, ce qui ressemble à une lutte de légitimité entre différents camps d’artistes pour justifier ce que la créativité représentait pour eux. Les forces de l’émancipation, provenant des artistes indépendants d’un côté, et des artistes au sein du système de l’art officiel de l’autre côté, réussirent à instaurer une certaine dynamique dans le champ artistique - auparavant dominé par l’idéologie totalitaire - pour s’ouvrir à une pluralité potentielle. Cependant, malgré leur aspiration partagée à l’émancipation, on constate le fait que les artistes indépendants et les artistes au sein du système de l’art officiel ne revendiquèrent pas les mêmes objectifs et ainsi, n’adoptèrent pas de logiques d’action similaires, ce qui créa un phénomène particulier : les artistes en quête de la liberté d’expression n’arrivaient pas à se soutenir mutuellement.

S’agissant des artistes indépendants, à part leur besoin de se légitimer auprès des autorités culturelles, on constate qu’ils tentèrent également de justifier une nouvelle définition de la créativité - l’expression de soi - pour défier le conservatisme académique. Le groupe des Étoiles relia même l’expression de soi à une position militante pour revendiquer ses droits artistiques. Le succès des expositions des Étoiles dans la Galerie nationale des beaux-arts établit ainsi sa popularité et permit aux artistes indépendants d’obtenir la reconnaissance de l’État et du grand public. Quant aux artistes au sein du système de l’art officiel, leurs objectifs ne consistaient ni à proposer une nouvelle définition de la créativité, ni à convaincre le grand public. Ils ne prenaient pas non plus au sérieux l’expression de soi comme un critère d’évaluation. Les artistes au sein du système de l’art officiel étaient tous passés par l’épreuve des concours nationaux, avec une base technique de la représentation réaliste excellente. Ils se considéraient comme faisant partie de petits cercles d’élite du milieu de l’art en Chine, en ne prenant que leurs pairs académiques que comme des interlocuteurs. De plus, à cette époque, la peinture demeurait encore pour eux une pratique noble. Ils discernèrent donc derrière la proposition de l’expression de soi, un manque de formation académique solide chez les artistes indépendants. À leurs yeux, le groupe des Étoiles et le groupe « Sans nom » ne constituaient pas de vrais concurrents.
Il est à noter que même entre les artistes indépendants, comme entre le groupe des Étoiles et le groupe des « Sans nom », il existait une certaine concurrence implicite au niveau du langage artistique. C’est ici que la notion d’avant-garde, couramment utilisée par la presse et le monde de l’art occidental pour décrire le groupe des Étoiles lorsque celui-ci manifesta avenue Chang’an, mérite qu’on s’y intéresse de manière approfondie. Le terme d’avant-garde semble décrire davantage une position militante, voire provocatrice, au lieu de désigner une posture indépendante et autonome comme celle du groupe des « Sans nom ». Néanmoins, il faut constater que pour le groupe des Étoiles, son activisme provenait en fait d’un dilemme moral auquel furent confrontés les artistes chinois tout au long des années 1980, c’est-à-dire une prise de position entre le militantisme et l’autonomie de l’art, comme si le choix de l’un devait nécessairement conduire à l’abandon de l’autre. En fait, l’obsession des artistes chinois pour la personnalité « schizophrénique » - dilemme moral entre l’engagement politique et le retrait intellectuel - révéla dans une certaine mesure l’impossible autonomie de l’art dans le contexte sociopolitique de la Chine des années 1980.
[1] Michael SULLIVAN. « A Review of Art in China since 1949 and a Look at the Future», The Asian Wall Street Journal, le 12 septembre 1980.
[2] Yan GAO (高焰). « Bushi duihua, shi tanxin : zhi xingxing meizhan » [Non une interrogation mais une conversation avec les artistes du groupe des Étoiles] (《不是对话,是谈心——致星星美展》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 12, 1980. p. 33-37. Quan ZI (子泉). « Zhi xingxing meizhan zuozhemen de yifengxin » [Une lettre aux artistes du groupe des Étoiles] (《致星星美展作者们的一封信》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 1, 1981. p. 41. Youqing JIN (金幼青). « Zou ziji de lu : yetan ‘kanbudong’ de wenti » [Suivre son chemin propre : du phénomène de l’incompréhension] (《走自己的路——也谈“看不懂”的问题》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 6, 1981. p. 57.
[3] Lang YE (叶朗). « ‘Ziwo biaoxian’ bushi women de qizhi » [L’expression de soi’ n’est pas notre drapeau] (《“自我表现”不是我们的旗帜》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 11, 1981. p. 4-10. Gangji LIU (刘纲纪). « ‘Ziwo biaoxian’ bushi women de qizhi yiwen duhou » [Après la lecture de l’article ‘L’expression de soi n’est pas notre drapeau’] (《“‘自我表现’不是我们的旗帜”一文读后》). Meishu [Beaux-arts] (《美术》), No. 3, 1982. p. 46-47.
[4] Ruoshui WANG (王若水). « Guanyu ‘yihua’ de gainian » [À propos de la notion d’altérité] (《关于“异化”的概念》). Waiguo zhexueshi yanjiu jikan [Recueil de textes sur l’histoire de la philosophie occidentale] (《外国哲学史研究集刊》), No. 1, 1979.
[5] Ertai GAO (高尔泰). « Yihua bianyi » [Le sens de l’altérité] (《异化辩义》), « Yihua xianxiang jinguan » [Une vue proche du phénomène de l’altérité] (《异化现象近观》), « Yihua jiqi lishi kaocha » [L’altérité et son histoire] (《异化及其历史考察》), Ren shi makesi zhuyi de chufadian [L’homme est l’origine de la pensée marxiste] (《人是马克思主义的出发点》), Éditions du peuple, 1981. Ruoshui WANG (王若水). « Guanyu ‘yihua’ de gainian » [À propos de la notion d’altérité] (《关于“异化”的概念》), « Waiguo zhexueshi yanjiu jikan » [Recueil de textes sur l’histoire de la philosophie occidentale] (《外国哲学史研究集刊》), No. 1, 1979 ; « Tantan yihua wenti » [À propos de la question de l’altérité] (《谈谈异化问题》), Xinwen zhanxian [Front journalistique] (《新闻战线》), No.8, 1980.
[6] Le mouvement de lutte contre la « pollution spirituelle » était une campagne politique provoquée par des factions conservatrices au sein du Parti communiste en 1983. Certains dirigeants chinois voulaient freiner les tendances libérales inspirées par les idées philosophiques et le style de vie de l’Occident, introduits en Chine au fur et à mesure de l’ouverture et des réformes économiques depuis 1978. La campagne atteignit son paroxysme en attaquant même la coiffure et la mode féminine et les comportements intimes de jeunes couples, avec certaines condamnations à mort de jeunes hommes « mal conduits ». Le mouvement s’estompa dans l’obscurité en 1984 après l’intervention de Deng Xiaoping. Des éléments du mouvement ont été retravaillés lors de la campagne de l’anti- libéralisation bourgeoise en 1987.
[7] Minglu GAO. 85 meishu yundong lishi ziliao huibian [The ‘85 Mouvement, an anthology of historical sources] (《85美术运动历史资料汇编》). Guangxi : éditions de la Presse de l’École normale de Guangxi, Vol. 1, 2007. p.74.
(Tous droits réservés)



