Introduction
Après les premières tentatives d’émancipation au début des années 1980, dans le milieu de l’art en Chine, de nouveaux facteurs comme l’affirmation de l’individu, le retour aux émotions et aux sentiments, le renouvellement du concept de l’art, permirent au système de l’art officiel de s’ouvrir à de nouvelles formes d’expression, et notamment à l’art moderne occidental qui avait été depuis longtemps condamné par les autorités politiques. Les jeunes générations d’artistes purent ainsi librement s’inspirer de courants d’art occidentaux pour se lancer dans de nouvelles expérimentations. Presque de manière boulimique, ces jeunes artistes firent référence aux avant-gardes occidentales pour intégrer toute sorte de « nouveaux éléments » dans leurs pratiques, afin de combler leur imagination et enrichir leur vision du monde. C’est ainsi que les mouvements de 85, aussi appelés le « 85 New Wave », naquirent, menés par les groupes d’artistes issus du milieu académique, dispersés dans des régions différentes.
Nous allons étudier dans ce chapitre les conditions socioculturelles de l’émergence des mouvements de 85, ainsi que les principales tendances de recherche des artistes. D’abord, nous démontrerons que le « 85 New Wave » fut marqué par une dispersion géographique de groupes d’artistes dans tout le pays, du fait que les ressources pédagogiques des écoles des beaux-arts des différentes régions pouvaient avoir un impact considérable sur leur démarche. Puis, nous donnerons un éclairage sur les principales tendances artistiques apparues dans les mouvements de 85, pour esquisser la vision progressiste et romantique largement partagée par les artistes des années 1980.
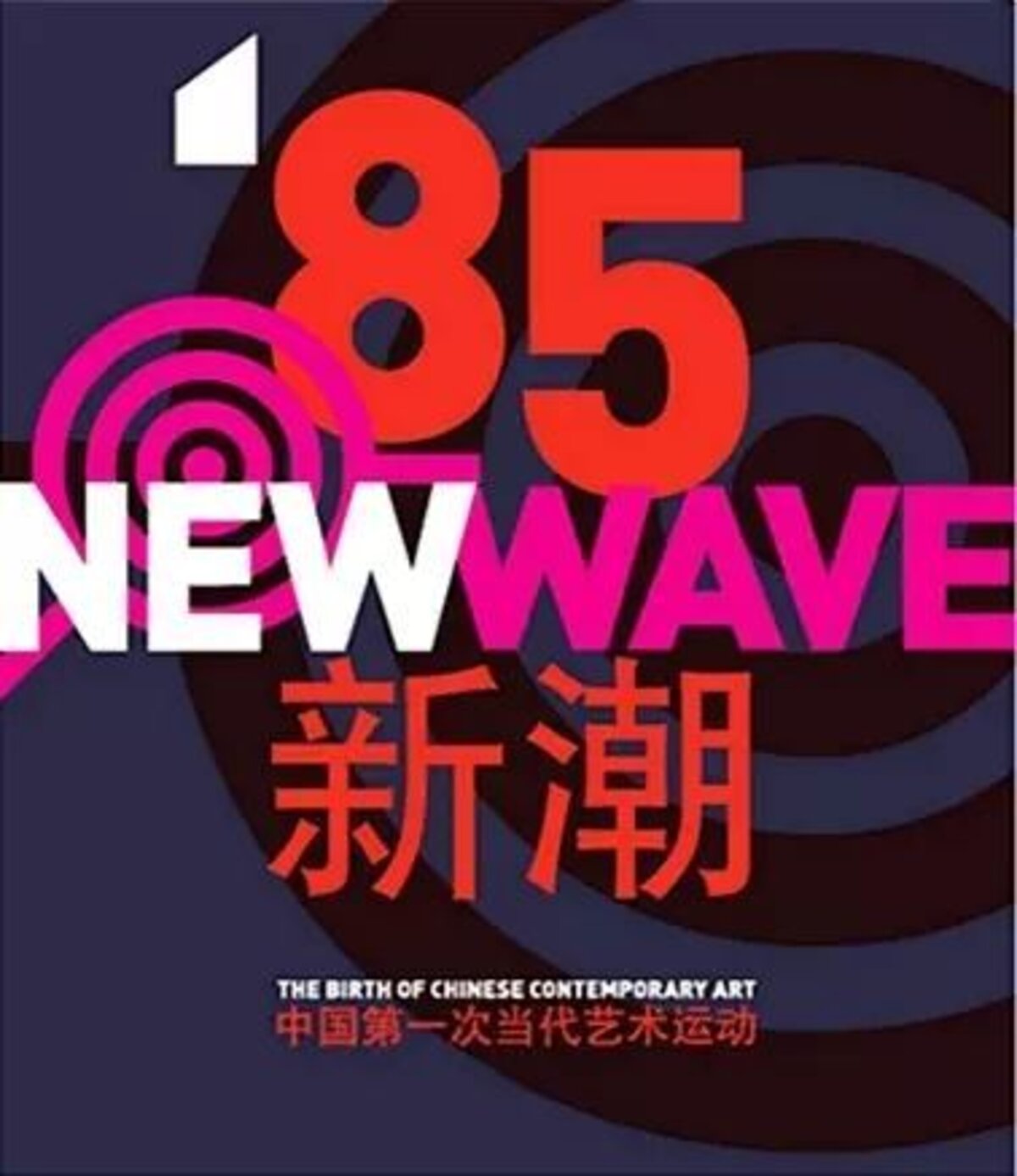
Enfin, nous jetterons un coup d’œil sur les débats qui eurent lieu à l’issue du mouvement « 85 New Wave », notamment les reproches et les réflexions sur la boulimie et l’anachronisme des artistes chinois dans leur réappropriation des courants d’art occidentaux. La question de l’imitation et de l’originalité a constamment hanté le milieu de l’art chinois pendant les années 1980, conscient de l’écart socioéconomique de la Chine avec les pays développés occidentaux. C’est ainsi que plusieurs solutions furent proposées par des artistes et des critiques d’art, mais la définition de l’identité moderne de l’artiste chinois restait toujours en suspens, car la prise de position entre l’engagement politique et l’autonomie de l’art restait toujours en contradiction et sans issue dans le contexte social chinois.
La « 85 New Wave » : Quelle originalité ? - Des pistes hétérogènes
Hangzhou : les conditions privilégiées
Vers le milieu des années 1980, plusieurs mouvements artistiques regroupés sous le nom des mouvements de 85, ou « 85 New Wave », apparurent conjointement dans certaines provinces de la Chine, marquant le réveil d’une nouvelle génération d’artistes dans le système de l’art officiel. Il s’agissait de pratiques et de recherches en groupes destinées à explorer la possibilité d’une liberté artistique acquise petit à petit. Parmi ces tentatives, c’est à Hangzhou, à l’Académie nationale des beaux-arts que l’on trouva la plupart des recherches les plus avancées. À cette époque, l’école s’appelait encore l’Académie des beaux-arts du Zhejiang, avec une tradition d’enseignement plutôt libérale se référant à l’art moderne occidental. Nombre d’artistes très actifs dans les mouvements de 85 étaient diplômés de cette école, comme Wang Guangyi (王广义), Huang Yongping (黄永砯), Gu Wenda (谷文达), Wu Shanzhuan (吴山专), Zhang Peili (张培力) et Geng Jianyi (耿建弈).

Agrandissement : Illustration 2

Tout au long du 20e siècle, l’Académie nationale des beaux-arts de Zhejiang fut dans une position de concurrence avec l’Académie centrale des beaux-arts de Beijing. Fondés au début du 20e siècle, les deux établissements avaient adopté des politiques d’enseignement distinctes. L’école de Hangzhou avait dispensé une éducation sur le modèle européen, en particulier français, sous l’impulsion de son fondateur Lin Fengmian (林风眠) (lecture complémentaire sur l'artiste en bas de cet article), qui avait étudié en France entre 1919 et 1925 et était devenu par la suite un acteur actif de la promotion de l’art moderne en Chine, tandis que l’Académie centrale des beaux-arts de Beijing était davantage sous l’influence du réalisme soviétique et de l’art classique occidental, et menée par Xu Beihong, un partisan fidèle de la représentation réaliste.

Agrandissement : Illustration 3

Depuis la fondation de la Chine populaire en 1949, le réalisme socialiste avait été imposé dans le système de l’art officiel, en encadrant l’ensemble des pratiques artistiques. La tradition libérale de l’Académie nationale des beaux-arts fut ainsi inhibée jusqu’à la fin de la Révolution culturelle. En 1980, la nomination du nouveau directeur Mo Pu (莫朴) donna un nouveau souffle à l’école. Grâce à ses initiatives et ses soutiens, et notamment ses mesures de réforme, l’Académie nationale des beaux-arts réussit à prendre une place avancée au cours de la première moitié des années 1980 par rapport à d’autres établissements d’enseignement supérieur des beaux-arts.
Les mesures de réforme consistèrent d’abord à enrichir la documentation de la bibliothèque, notamment avec des ouvrages sur l’art moderne et contemporain occidental. Au début des années 1980, la plupart des écoles d’art chinoises souffraient d’une pénurie de références et de documentation sur l’art du 20e siècle. À cette époque, le Groupe import-export de publications de Chine (中国图书进出口公司), seule entreprise d’État légitime pour introduire des publications étrangères en Chine, collaborait chaque année avec une institution de l’enseignement supérieur pour organiser une foire aux livres importés dans une discipline spécifique. L’établissement choisi dans ce genre de collaboration pouvait en conséquence avoir la priorité pour sélectionner et acheter des livres présentés.

Agrandissement : Illustration 4

En 1979, c’est l’Académie nationale des beaux-arts de Zhejiang qui collabora avec le Groupe import-export de publications de Chine pour introduire les livres consacrés au domaine de l’art. Par le biais de cette occasion, l’école acquit un grand nombre de publications provenant du Japon, de l’Europe et des États-Unis. Les ouvrages recouvraient les courants d’art des différentes périodes du 20e siècle, principalement l’impressionnisme, le cubisme et l’expressionnisme, et certaines publications sur l’art contemporain, comme les magazines Art news, Apollo, ainsi que des revues d’art françaises et japonaises[1]. À cette époque, une telle collection était très précieuse pour une école d’art chinoise, de sorte que les livres n’étaient accessibles aux élèves qu’à condition d’être accompagnés de leur enseignant.

Agrandissement : Illustration 5

La deuxième mesure de réforme de l’Académie nationale des beaux-arts fut mise en œuvre par Zheng Shengtian (郑胜天), professeur du département de peinture à l’huile. Ayant séjourné entre 1980 et 1983 aux États-Unis et en Europe grâce à une bourse du gouvernement chinois, Zheng Shengtian ramena en Chine un certain nombre d’ouvrages et de documents sur l’art moderne et contemporain. Inspiré par les écoles d’art occidentales, il lança une série de modifications du programme d’enseignement, par exemple la fusion des ateliers pour briser les frontières entre la peinture, la sculpture et d’autres formes d’expression, afin d’encourager les étudiants à pratiquer la libre création. C’est également grâce à Zheng Shengtian que le premier département de photographie en Chine fut inauguré à l’Académie nationale des beaux-arts en 1987, avec des échanges réguliers avec la School of Visual Arts de New York, ce qui fit de l’établissement le foyer de l’art photographique et de l’art vidéo en Chine.

En troisième place, au niveau des échanges internationaux, l’Académie nationale des beaux-arts adopta dans les années 1980 une politique très ouverte pour inviter des professeurs étrangers, comme l’artiste bulgare Maryn Varbanov, qui joua un rôle incontournable dans le milieu de l’art en Chine dans les années 1980. Né en 1932 en Bulgarie et diplômé du département de sculpture de l’Académie nationale des beaux-arts de Sofia, MarynVarbanov se rendit en Chine en 1953, où il épousa plus tard Song Huai-kuei (宋怀桂), une des fondatrices de l’industrie du luxe en Chine. Maryn Varbanov avait été inspiré par l’artiste français Jean Lurçat (1892-1966) – un artiste contemporain de Matisse, Picasso et Braque – dont des conférences avaient été organisées en Chine dans les années 1950[2]. Sous l’influence de l’artiste français, Maryn Varbanov se convertit aux matières douces comme les tissus et textures, pour se « libérer des entraves de la peinture et de la banalité des tableaux insensés[3] ». En 1986, Maryn Varbanov fut invité par l’Académie nationale des beaux-arts à établir un atelier consacré à l’art de la tapisserie. Cet espace, conçu dans le style du Bauhaus, se transforma vite en un univers de « sculptures souples », laissant une empreinte indélébile sur la création des jeunes artistes qui pouvaient réfléchir sur les matériaux et les formes d’expression jusqu’alors peu exploitées en Chine.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Jane DE BEVOISE. « Zheng Shengtian fangtan » [Interview avec Zheng Shengtian] (《郑胜天访谈》), le 31 octobre 2009, Materials of the Future: Documenting Contemporary Chinese Art from 1980-1990. Disponible sur : http://www.china1980s.org/files/interview/zstftfinalised_201102171538282951.pdf [consulté le : 25 août 2010].
[2] Jean Lurçat a voyagé pendant deux mois en Chine, à Beijing et à Mandchourie, en 1955, selon la biographie de Jean Lurçat publiée par la Fondation Jean et Simone. Disponible sur : https://www.fondation-lurcat.fr/jean-lurcat [consulté le 14 juillet 2018].
[3] Madeleine O’DEA. « Perpetual motion: the life and art of Maryn Varbanov », Leap, le 1e août 2010. Disponible sur : http://leapleapleap.com/2010/08/maryn-varbanov/ [consulté le : 18 avril 2011].
LECTURE COMPLÉMENTAIRE
Lin Fengmian
Lin Fengmian (林风眠) (22 novembre 1900 - 12 août 1991) est l'un des plus importants artistes peintres chinois modernes. Né en chine, sous la dynastie Qing, dans la province du Guangdong (sud de la Chine), Lin Fengmian vient d’une famille de tailleurs de pierre. Son père lui a fait connaitre la peinture et la calligraphie chinoise traditionnelle quand il n’avait que cinq ans.

Il est l'un des premiers artistes chinois à étudier en France de 1918 à 1925, d’abord à Dijon et ensuite à l’École des beaux-arts de Paris. Il fut exposé plusieurs fois au Salon d’Automne à Paris. À son retour en Chine, il occupa plusieurs postes importants dans le circuit académique officie. En 1927, Lin Fengmian devint membre du comité pour l’éducation artistique nationale et aida à établir l’école nationale des arts (maintenant connu sous le nom de l’école des beaux-arts du Zhejiang). En 1938, il devint directeur de l’Académie nationale des beaux-arts, une fusion des académies d’art du Hangzhou et de Beiping (aujourd’hui Beijing). En 1966, l’artiste devint la cible de la Révolution culturelle et vit dans l’obligation de détruire plusieurs de ses travaux et se retrouva emprisonné pendant quatre ans. En 1977, à la fin de la Révolution culturelle, il partit vivre à Hong Kong et y meurt en 1991.
En voulant être différent des autres peintres célèbres chinois du 20e siècle, comme Qi Baishi, Xu Beihong, Huang Binhong, Lin Fengmian a cherché à créer un style complètement différent de la peinture traditionnelle chinoise et de la peinture occidentale moderne. L’artiste s’efforce de capturer l’essence de l’art oriental et occidental afin de réaliser une nouvelle synthèse. En intégrant les qualités émotionnelles des maîtres européens, comme Henri Matisse, Pablo Picasso et Georges Rouault, Lin Fengmian chercha à créer des peintures colorées sur un fond monochrome de dessin à la plume et à l’encre. Le rythme issu de la lumière claire et changeante et du sentiment intense est devenu connu sous le nom de « style Lin Fengmian ». Lin Fengmian fut le tuteur de nombreux célèbres peintres chinois, comme Zao Wouki (赵无极), Li Keran (李可染), Wu Guanzhong (吴冠中) et Chu Teh-Chun (朱德群), et reste une figure centrale dans le développement de la formation artistique occidentale en Chine.
(Tous droits réservés)



