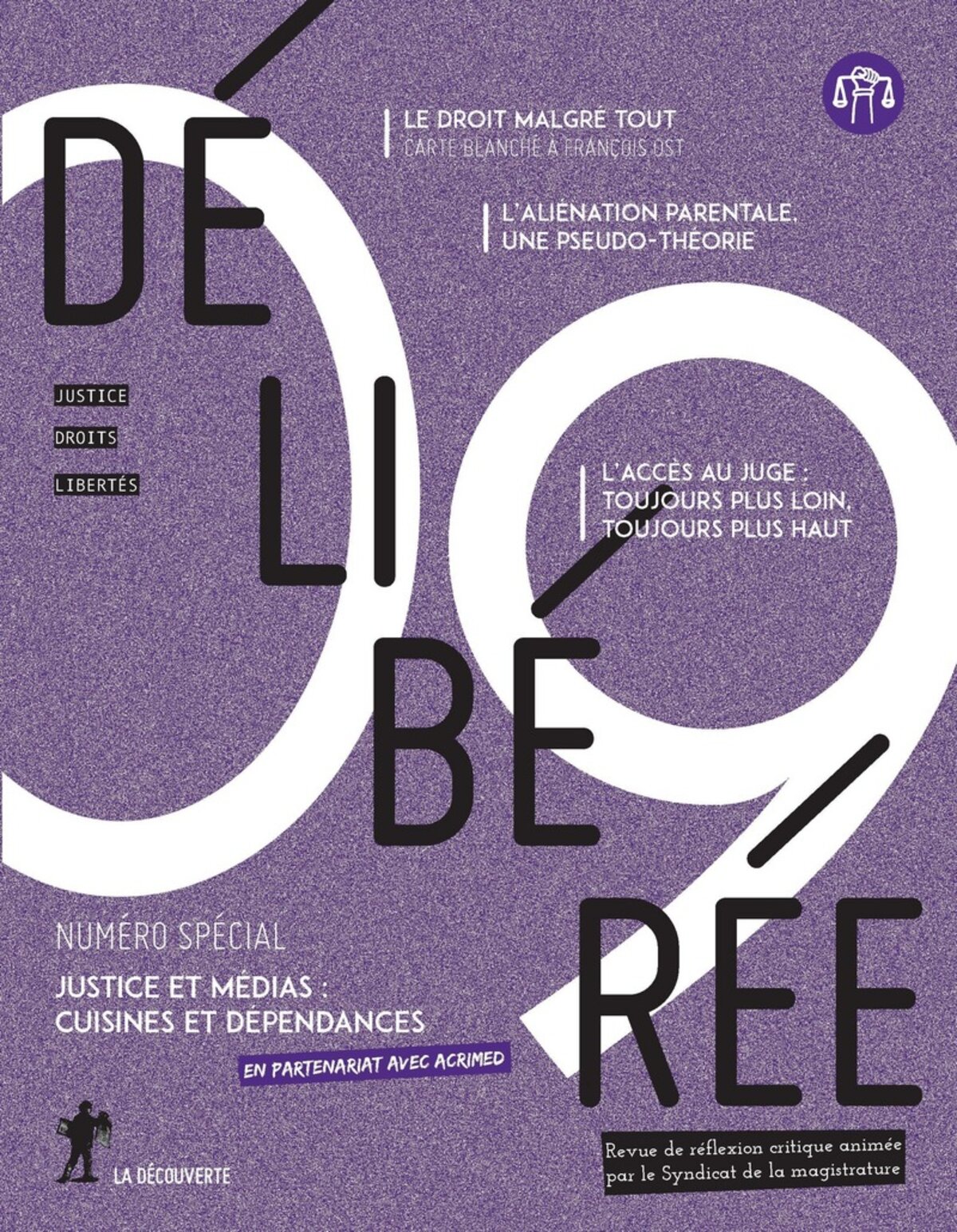
Agrandissement : Illustration 1
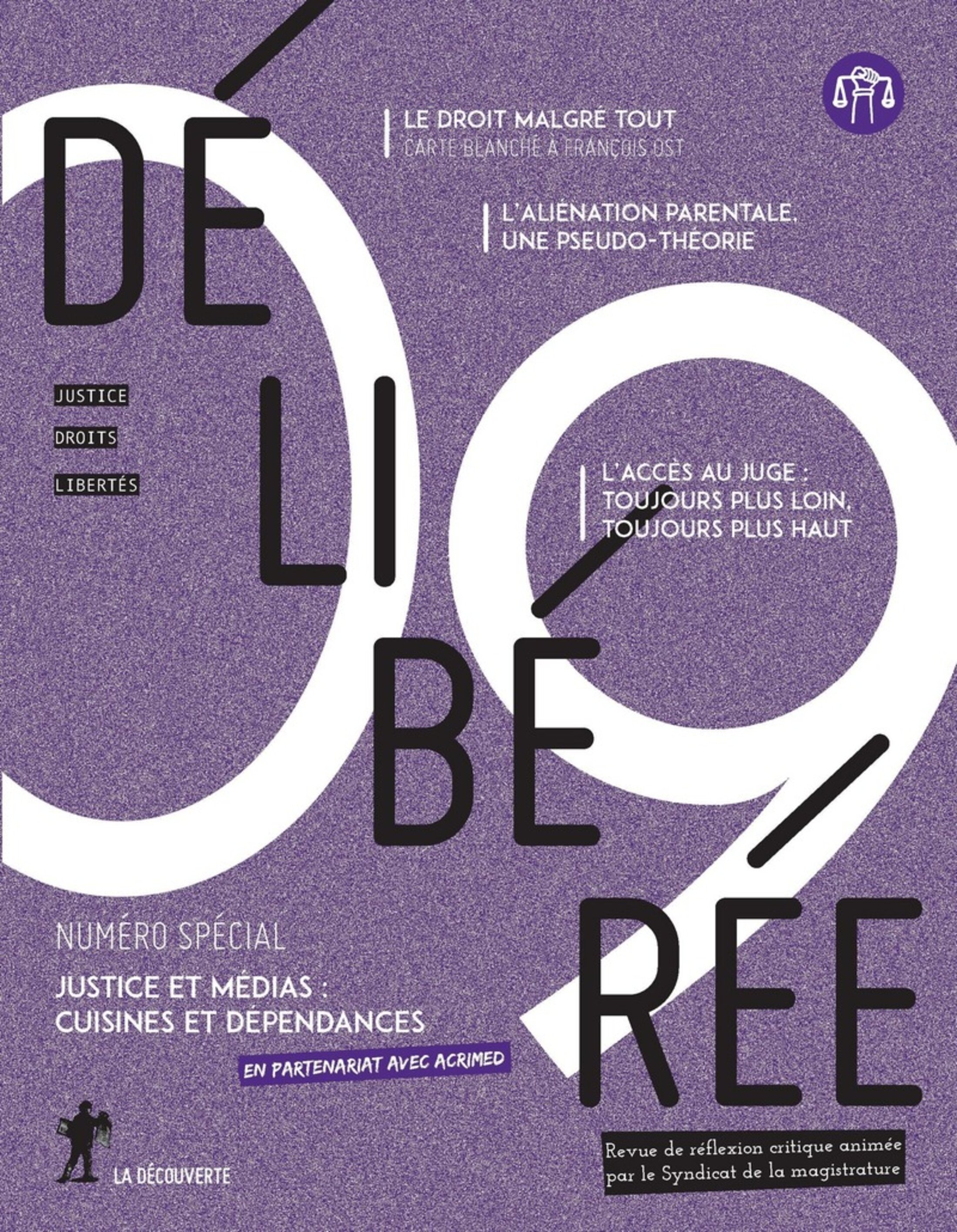
Cet article est tiré de Délibérée n°9, paru en mars 2020. Il s'agit d'un numéro spécial sur la thématique "Justice & Médias : cuisines et dépendances" élaboré en partenariat avec Acrimed. Acrimed est une association fondée en 1996 pour remplir les fonctions d'observatoire des médias. Elles réunit des journalistes et salarié·es des médias, des chercheurs et chercheuses, universitaires, et "usager·es" des médias ; elle cherche à mettre en commun savoirs professionnels, savoirs théoriques et savoir militants au service d'une critique indépendante, radicale et intransigeante. En particulier, ont participé à la rédaction de cet article Frédéric Lemaire, Jean Pérès et Pauline Perrenot. Présomption d’innocence, source proche de l’enquête, féminicide, experts : que révèle l’usage de ces termes ?
PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT OU MISÉRABLE…
La présomption d’innocence est une règle de preuve selon laquelle toute personne soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission d’une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été démontrée ; il appartient à l’accusation – c’est-à-dire le procureur de la République – de démontrer la culpabilité ; dans le jargon juridique, on dit que c’est l’accusation qui a « la charge de la preuve » de la culpabilité. Il s’agit d’un principe fondamental ancien1 dont découlent diverses implications concrètes destinées à garantir le caractère équitable du procès susceptible d’intervenir : toutes et tous, journalistes compris·es, ont ainsi interdiction de présenter publiquement comme coupables des personnes qui n’ont pas encore été définitivement condamnées2 (ce qui explique l’emploi fréquent du conditionnel pour traiter des affaires, même si l’usage du conditionnel ne règle pas tout…) ; les médias ont par ailleurs interdiction de publier des images de personnes menottées3, ce qui pourrait donner l’impression fausse au public qu’elles sont déjà condamnées, et donc coupables. Pour autant, à y bien regarder, la déclinaison de cette présomption d’innocence et son invocation médiatique paraissent à géométrie variable.
L’invitation au respect de la présomption d'innocence est plus fréquemment invoquée depuis quelques années dans les médias dominants, ce dont on devrait légitimement se réjouir au nom des principes. L’appréhension de la question est néanmoins un peu différente lorsqu’on s’aperçoit que c’est en réalité principalement quand les personnes concernées sont des hommes ou des femmes des milieux politiques ou économiques, du clergé, ou encore des stars du spectacle. Sont alors soulignés le nécessaire respect de cette présomption et le fait que « tout le monde y a droit ». Ainsi, s’agissant de l’affaire Balkany, avant le procès il nous a été bien rappelé que l’intéressé « reste présumé innocent » (L’Obs, 20/01/19), et, même après condamnation en première instance, il nous a été bien signalé, qu’en faisant appel « Patrick Balkany redevient présumé innocent » (Le Parisien, 7/10/19) ; ce même phénomène de rappel expressément formulé a pu être observé pour la mise en cause de Carlos Ghosn (Le Monde, 24/01/19, Libération, 07/02/19 et RTL 04/04/19), et bien d’autres puissants encore. Au pire seront évoquées des « malversations présumées », mais jamais Ghosn ou Balkany ne seront présentés comme des « fraudeurs présumés ».
Quand il s’agit de personnes moins connues (à plus forte raison lorsqu’elles sont issues de la classe populaire), les attitudes sont moins précautionneuses et peuvent même aller jusqu’à bafouer allègrement cette présomption d’innocence, comme ce fut le cas dans l’affaire d’Outreau4 5. Et l’on voit fleurir autant d’expressions qui énoncent une véritable présomption de culpabilité : « Gonesse : arrestation du voleur présumé de la cagnotte de Tylian » (Franceinfo, 12/03/2019) ; « Créteil : l’assassin présumé de Jean-Marie prétend avoir été confondu avec quelqu’un » (Le Parisien, 24/10/2019) ; « Au Maroc les assassins présumés de deux touristes scandinaves jugés en appel » (Le Monde et AFP, 28/08/2019) ; « Rixe en Moselle : le meurtrier présumé d’un adolescent arrêté “sans heurts” » (L’Express, 3/08/2019) ; « Gard : les gendarmes diffusent le portrait-robot d’un violeur présumé » (BFM-TV, 30/04/2019). Pour paraphraser La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les usages médiatiques de la présomption d’innocence vous rendront blanc ou noir…
C’est parfois même la victime qu’on qualifie de « présumée quelque chose » : « Pas-de-Calais : un membre du GIGN tire sur un délinquant présumé et le tue lors d’une opération de filature » (Franceinfo, 18/09/2018). C’est qu’en parallèle de la catégorie de classe du mis en cause, selon la catégorie d’infraction traitée, là aussi l’utilisation médiatique du principe de présomption d’innocence variera. Ainsi ces derniers temps, s’agissant des affaires de violences policières ou de violences sexistes ou sexuelles entendra-t-on davantage brandir ce principe par toute personne manifestement gênée par le sujet ; quitte d’ailleurs à l’invoquer même lorsqu’il n’a aucun sens, comme lorsqu’elle est invoquée au bénéfice de Roman Polanski pour des faits pour lesquels il a été définitivement condamné ou qui sont manifestement prescrits et pour lesquels il n’y aura jamais de procès5… La présomption d’innocence, d’une manière générale, sera vite agitée pour tenter d’étouffer toute analyse ou réflexion menant à interroger la norme et sa légitimité, ici l’ordre patriarcal ou policier6.
Mais comment s’étonner de cet usage à géométrie très variable du principe de présomption d’innocence, qui ne fait au fond que reproduire et renforcer les différents rapports de domination, lorsqu’un ministre qualifie à titre préventif de « complice » d’actes de dégradation tout manifestant, lorsque la législation elle-même fait la part de plus en plus belle à une pénalisation de « l’intention coupable » avant même tout passage à l’acte, lorsqu’enfin le Président Macron invite à « savoir repérer à l’école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République » ? En instillant dans l’esprit du public une vision biaisée de ce qu’implique réellement la présomption d’innocence, les médias participent, plus ou moins consciemment, à l’instauration d’une forme de société où les citoyens sont invités à en considérer certains comme suspects perpétuels, tandis que d’autres seraient d’emblée au-dessus de tout soupçon. Cette forme de société ne s’appelle pas la démocratie.
« SELON DES SOURCES PROCHES DE L’ENQUÊTE » : UN PARAVENT JOURNALISTIQUE
Des journalistes « police-justice » la convoquent en plateau pour annoncer ou commenter un fait-divers. Elle garnit les articles attachés à documenter le cours des enquêtes judiciaires. Omniprésente dans les médias, la formule d’apparence anecdotique « selon des sources proches de l’enquête » (variantes : « de source proche du dossier » ou « selon nos informations ») témoigne surtout d’un certain type de pratiques journalistiques critiquables, voire sert de paravent déontologique et politique.
Sur un plan rhétorique, cette expression s’apparente à une forme d’argument d’autorité, puisque l’on imagine que la source a accès aux éléments de l’enquête voire y participe et sait donc nécessairement de quoi elle parle ; elle offre donc un gage de sérieux, de fiabilité, et même d’« objectivité » pour qui croirait encore à ce mythe de la profession journalistique. Elle peut aussi être utilisée comme faire-valoir, privilège d’un journaliste auquel cette « source proche de l’enquête » aura « confié », en toute indiscrétion, une information exclusive… Les journalistes évoqueront sans doute le « secret des sources », et la nécessaire protection qu’une telle formule garantit à un interlocuteur pourvoyeur – régulier ou non – d’informations, et qui pourrait se voir reprocher par sa hiérarchie, voire la justice, un manquement à ses obligations professionnelles. Pour autant, secret et qualité des sources ne devraient pas dispenser des précautions et vérifications usuelles.

Agrandissement : Illustration 2

Bien des « révélations » médiatiques – et a fortiori policières et/ou judiciaires – ont en effet vu leur véracité a priori garantie par cette formule consacrée se terminer en fiascos. Par exemple, les grands médias ont quasi unanimement annoncé, de « sources proches de l’enquête » et à la suite du Parisien, que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté le 11 octobre dernier – une information démentie dès le lendemain – avant de longuement gloser sur cette arrestation à coup d’éditions spéciales, et sans le moindre recul. Ainsi Le Parisien s’est-il défendu – au cours d’un épisode qu’il fut convenu d’appeler une méprise – en affirmant que « cinq sources » avaient été consultées7. Cinq sources à différents niveaux hiérarchiques, à différents endroits de France, mais cinq sources… « proches de l’enquête », et toutes policières. Pouvait-on raisonnablement considérer que l’information était suffisamment fiable et recoupée, alors même que le procureur de la République – seule autorité habilitée à communiquer sur une affaire judiciaire en cours – refusait dans un premier temps de s’exprimer, puis que rapidement, des témoins apportaient une version contradictoire ?
Dans les affaires de violences policières – entraînant parfois la mort – vis-à-vis de jeunes racisés des quartiers populaires, ou comme on l’a vu plus récemment à l’occasion des manifestations des Gilets jaunes, la formule reste monnaie courante dans les articles de presse8. Un exemple particulier qui montre bien en quoi l’expression « source proche du dossier » est problématique9 : une manière, finalement, de se passer – ou de largement supplanter le recueil d’autres sources, notamment celles de témoins, et donc bien souvent… d’autres versions des faits.
D’une manière générale, cet usage courant voire automatique s’explique par bien des facteurs, de la foi aveugle que vouent certains journalistes dans les déclarations des institutions policières à la dépendance qui peut se créer, du fait d’un ensemble de pratiques professionnelles, vis-à-vis de certaines sources policières ou judiciaires. Des facteurs qui conduisent les journalistes à donner à la police la primeur des faits pour un résultat souvent très problématique du point de vue de l’information : ce qu’Acrimed a coutume d’appeler « le journalisme de préfecture ».
DU « DRAME FAMILIAL » AU « FÉMINICIDE » : UN BASCULEMENT SÉMANTIQUE ET POLITIQUE QUI INTERROGE LE DROIT
« Crime passionnel », « drame conjugal », « drame de la séparation », « drame familial » : depuis des décennies, ces expressions journalistiques contribuent à mal nommer ce qu’elles prétendent désigner : des féminicides, dans la grande majorité des cas, soit le meurtre d’une femme parce que femme. Comme le précise la plateforme « Reconnaissons le féminicide », « en France, on sait qu’une femme est tuée par son conjoint, compagnon ou ex tous les deux jours et demi en moyenne. […] Un meurtre intrafamilial survient toujours après une longue série de violences machistes : harcèlement psychologique, violences physiques, viols, menaces de mort. Un homme tue sa femme pour deux raisons principales : l’adultère réel ou supposé, et la séparation. Il perd le contrôle sur son corps, elle lui montre qu’elle n’est pas “sa chose”, elle lui échappe, il la tue. »
Dans les grands médias, le choix d’expressions non appropriées, la mise en récit et le traitement de ces informations sous la forme de « faits-divers » ont ainsi bien souvent contribué à la banalisation des féminicides (comme des autres formes de violences sexistes et sexuelles). Loin d’être une coquetterie féministe, le combat pour les mots est primordial : au même titre que d’autres vecteurs (films, romans, chansons, etc.), les médias articulent des représentations de phénomènes sociaux et façonnent les imaginaires. Ainsi les femmes ont-elles été abreuvées de récits véhiculant l’idée que les violences qu’elles subissent n’ont rien de spécifique ni de systémique, qu’elles semblent inéluctables (« drame ») ou peuvent être sujettes à plaisanterie (« Elle peine sur les mots croisés, il l’électrifie », Le Télégramme, 24/05/19), voire que les victimes en sont partiellement responsables10. Les médias ont joué un rôle dans leur impossibilité de nommer (et de combattre) ce phénomène. C’est une fonction (sociale et politique) possible du fait-divers : reléguées dans cette catégorie, les violences sexistes – de l’agression verbale au meurtre – ne peuvent être perçues que comme des événements extra-ordinaires, cantonnés à l’intimité des vies privées11.
Les « drames familiaux » et autres « crimes passionnels » se sont ainsi enracinés dans l’écriture journalistique au point de devenir un automatisme, charriant leur lot de stéréotypes de genre et de représentations sociales biaisées, que rien ne semblait pouvoir remettre en question. Leur usage courant dans les commissariats ou les enquêtes policières – d’où les « fait-diversiers » tirent une grande partie de leurs informations –, la faible prégnance des combats féministes dans la société, autant que les logiques professionnelles néfastes à l’information (manque de temps et de moyens pour enquêter, « bâtonnage » de dépêches AFP, racolage du lecteur, etc.) sont à compter au rang des phénomènes qui peuvent expliquer une telle malinformation de la part des grands médias, et ce malgré leur décalage vis-à-vis des qualifications judiciaires : aucune de ces expressions ne figure en effet dans le Code pénal.
Si les mauvaises pratiques journalistiques n’ont pas disparu12, un tournant majeur s’est produit à la suite du mouvement #MeToo fin 2017. Dans la société… et dans les médias. L’usage du terme « féminicide » dans la presse quotidienne et nationale (sites web et agences de presse compris) est par exemple passé de 4 occurrences en 2003 à 256 en 2018 puis 2151 en 2019 ! Un bond quantitatif qui ne garantit pas, toutefois, son pendant sur le plan qualitatif. Reste que le combat mené depuis des années par les collectifs féministes13, les pratiques de signalements et d’interpellation sur les réseaux sociaux14 sont deux exemples de facteurs ayant contribué à mettre le sujet des féminicides et des violences sexistes sur le devant de la scène médiatique. Des facteurs dont la portée fut décuplée par les mouvements #Balancetonporc et #MeToo, mais également par des « affaires » internes au milieu médiatique, comme celle de la « Ligue du lol », ayant permis de lever le voile sur les pratiques sexistes à l’intérieur des rédactions.
Ce basculement du rapport de forces s’est donné à voir le 25 novembre 2019, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, où plus de 150 000 personnes ont défilé dans les rues en France. L’étape supplémentaire d’un combat partagé, dont Internet avait massivement labouré le terrain au cours des deux années précédentes. Le jour même, les féminicides ont occupé le haut de l’agenda médiatique. Tant et si bien que l’initial décalage des médias par rapport au vocabulaire de la justice semble aujourd’hui s’inverser. Absent du Code pénal, le terme féminicide interroge en effet désormais les praticiens du droit : si certains arguent que son inscription y serait superflue en ce qu’elle ne pourrait enrichir les circonstances aggravantes au meurtre déjà existantes de meurtre par conjoint ou ex-conjoint (soit une majorité de féminicides) ou de sexisme15, d’autres y voient un outil symbolique essentiel, mais également un levier potentiel pour des politiques publiques concrètes si elles étaient dotées de moyens suffisants…
On comprend dès lors qu’un tel débat, à haute teneur politique, ne saurait rester le pré-carré des professionnels. Du fait du rôle démocratique qu’ils sont censés jouer, on pourrait attendre des médias qu’ils prennent leur part dans l’exposition et la vulgarisation de cette question essentielle. C’est petit à petit le cas : le 22 novembre, Le Monde abordait la question dans un article intitulé « Féminicide : mot masculin qui tue ». Quelques semaines plus tôt, France Culture titrait une enquête « Le terme “féminicide” interroge le droit ». Des contributions nécessaires, qui restent toutefois marginales, et dont on ne peut que souhaiter la multiplication. Malheureusement, dans les grands médias, les débats sont trop souvent monopolisés par des « experts », éditorialistes, « grandes gueules » et autres « bons clients », dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne participent pas au développement de ce genre de réflexion.
LES EXPERTS, SPÉCIALISTES EN GÉNÉRALITÉS
Dans les médias, les « experts » ont une place à part : toujours disponibles pour s’exprimer sur n’importe quel sujet, dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel moment du jour et de la nuit, ils exercent une activité continue de pseudo-analyse. Gilles Deleuze et Pierre Bourdieu ont, chacun à leur façon, décrit ces penseurs à grande vitesse (fast-thinkers) qui, du philosophe spécialisé en opinions sur tout à l’expert généraliste en opinions sur le reste, sont constamment branchés sur l’appareil médiatique16.
Les experts médiatiques convoqués pour commenter les affaires de justice, les faits-divers ou les attentats terroristes n’y dérogent pas. Dans les 24 heures ayant suivi l’attentat de Barcelone, en août 2017, une ribambelle d’« experts » ont ainsi défilé sur les plateaux17, incontournables « consultants » ou « spécialistes » au statut souvent flou, affublés de titres toujours ronflants, souvent obscurs, parfois changeants. Une présence encore renforcée par les chaînes d’information en continu, qui se doivent de meubler un temps d’antenne considérable – en raison du passage en « édition spéciale ». Au cours des fameuses éditions spéciales post-attentat, les exemples sont légion d’un même individu circulant de chaîne d’info continue en édition spéciale à la radio en passant par les JT, qui peut être tour à tour présenté comme « expert en questions de terrorisme », « spécialiste du terrorisme », « expert en terrorisme » et « expert en contre-terrorisme ». Qu’importe s’il n’a rien à dire dans les premières heures suivant l’attentat, se contentant de formuler d’hypothétiques hypothèses18. Qu’importe, enfin, si les « observatoires », « instituts » ou « centres de recherche » dont ces « experts » se revendiquent sont parfois des coquilles vides qui n’ont jamais produit aucune étude, rapport ou recherche ayant une quelconque valeur scientifique19… Plus récemment, le fiasco médiatique de la prétendue arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, le 11 octobre 2019, a également donné lieu à un défilé d’« experts » : depuis le présentateur d’une émission spécialisée dans les faits divers – qui « n’a jamais cru à la thèse du suicide » – aux auteurs de livres à succès, en passant par un obscur psychiatre et criminologue, tous venus combler le vide informationnel d’anecdotes truculentes sur l’affaire20. Tous venus, au pied levé, remplir le vide ouvert par l’absence d’informations et l’impossibilité de proposer une analyse documentée de la situation, tout en donnant l’illusion d’une compréhension des événements. Ainsi l’étiquette d’expert transforme-t-elle en commentaire avisé et autorisé des propos relevant de la pure spéculation.
La justice quant à elle a ses propres experts. Elle les désigne lorsqu’elle est confrontée à une question technique ou médicale utile à la manifestation de la vérité ou la résolution d’un litige. Si, pour des raisons déontologiques, ces experts ne sont pas censés se prévaloir de cette qualité pour promouvoir leur activité, il n’en demeure pas moins que certains, par ailleurs reconnus dans leur champ d’intervention, se retrouvent aussi sur les plateaux télé ou radio. Légitime lorsqu’il s’agit d’expliquer le rôle et le travail d’un expert ou s’exprimer sur leur domaine de compétence, mais beaucoup moins lorsqu’il s’agit de commenter et analyser sauvagement telle ou telle affaire en cours ou donner le « profil » d’un mis en cause21. Un expert judiciaire devrait en effet bien savoir qu’aucune conclusion ne peut être tirée sans accès aux éléments précis du dossier, et sans respect des règles de l’expertise (lesquelles impliquent a minima un examen des lieux, du sujet, la soumission au contradictoire, etc.). Surtout il pourrait être désigné dans ladite affaire, ce qui, eu égard à la pénurie généralisée d’experts, n’est pas forcément hypothèse d’école. Aussi, sauf à imaginer que les magistrats surveillent toutes les interventions médiatiques d’experts… il n’y a plus qu’à espérer qu’en telle hypothèse il décline de lui-même la mission.
Enfin, à cette disposition à penser (trop) vite et à remplir le vide sur commande s’ajoute l’effet « carnet d’adresses » : les journalistes et assistants de production qui préparent les émissions (dans l’urgence) font souvent appel aux mêmes « experts », de préférence parisiens, qui doivent pouvoir se rendre disponibles dans des délais très courts… Cela explique le retour récurrent, sur les plateaux, des bons clients. Comme l’indiquait Pierre Bourdieu, déjà en 1996 : « Ce sont des gens qu’on peut inviter, on sait qu’ils seront de bonne composition, qu’ils ne vont pas vous créer des difficultés, faire des histoires, et puis ils parlent d’abondance, sans problèmes. On a un univers de bons clients qui sont comme des poissons dans l’eau. »22
Acrimed
Pour vous abonner à notre revue Délibérée c'est ici ou là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info
1 Art. 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, art. préliminaire du Code de procédure pénale introduit par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence dite loi Guigou.
2Art. 9-1 du Code civil, introduit par la loi Guigou ; la violation de ce principe ouvre droit à réparation par le biais de dommages-intérêts et à une action visant à faire cesser l’atteinte.
3Art. 35ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit par la loi Guigou.
4 « La presse et Outreau », Le Tigre, 8 décembre 2006, http://www.le-tigre.net/La-presse-et-Outreau-2001-2006.html.
5 Non pas qu’il est alors loisible de dire tout et n’importe quoi, mais cela exposerait alors à des poursuites en diffamation ou dénonciation calomnieuse, et non pour atteinte à la présomption d’innocence.
6 La question de l’atteinte portée à la présomption d’innocence a été et reste un des angles majeurs du traitement médiatique de #MeToo (ce qu’on ne retrouve concernant aucun autre type d’infractions) ; s’agissant des violences policières, pour le SM, « les procédures pénales doivent pouvoir être menées dans la sérénité et avec rigueur. Mais cela ne saurait priver quiconque de la possibilité d’interroger et de critiquer le fonctionnement de l’institution policière, comme celui de l’institution judiciaire » (« Intervention policière, dérives, violences et traitement judiciaire : l’urgence d’un débat », communiqué de presse du 16 mars 2017, http://www.syndicat-magistrature.org/Intervention-policiere-derives.html).
7 « Affaire Dupont de Ligonnès : cinq sources pour une fausse piste », Le Parisien, 12 octobre 2019.
8Sur ce sujet, voir sur le site d’Acrimed la rubrique dédiée au traitement médiatique des violences policières (https://www.acrimed.org/+-Violences-policieres-+) et en particulier les articles « Comment les violences policières ont (difficilement) percé le mur médiatique » et « Violences policières : la préfecture vous informe ! ».
9 Ce d’autant qu’il peut se combiner avec un usage à géométrie très variable du principe de présomption d’innocence (cf. les développements dédiés à cette question dans ce même article).
10 Voir le travail réalisé par Acrimed, par exemple, autour du traitement de « l’affaire DSK » et plus généralement, autour du traitement médiatique des violences sexistes : https://www.acrimed.org/+-Sexisme-+ .
11 Ce que contredisent évidemment les statistiques : en 2019, les associations féministes dénombrent 149 féminicides (pour 121 en 2018), en plus des 213 000 femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint.
12 Le 17 novembre 2019, on pouvait ainsi lire sur le site de Sputnik, l’expression de « crime passionnel » dans le titre d’un article qui débutait par la présentation d’« un mari pris d’une jalousie excessive ». À son corps défendant ? Le 7 octobre, La Provence parlait encore de « drame familial » à propos d’un double féminicide (femme et fille) perpétré par le mari/père.
13 Par exemple, pour mener des formations à destination des journalistes, ou l’écriture d’une charte énumérant une séried’outils pour le traitement médiatique des violences faites aux femmes comme celle du collectif « Prenons la une ! ».
14 On pense par exemple au travail de Sophie Gourion à travers son tumblr en ligne « Les mots tuent ».
15Article 132-77 du Code pénal, dont la caractérisation est strictement encadrée et ne se confond pas avec le « mobile ».
16 Gilles Deleuze, « À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus général », supplément au n° 24, mai 1977, de la revue bimestrielle Minuit ; Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Paris, Liber, coll. « Raisons d’agir », 1996.
17« Couverture médiatique de l’attentat de Barcelone : le retour des “experts” », Acrimed.org (07/09/17) et « Attentats de Bruxelles : le bal des “experts” de l’expertise », Acrimed.org (28/03/16).
18 Pour des exemples, non exhaustifs, lire Salomé Brahimi, « #OccupyPlateauTV : la valse des experts douteux en terrorisme », Slate, 24 novembre 2015.
19 Quand il ne s’agit pas carrément d’escroquerie (voir le cas récent de la condamnation de Laurent Montet : Julien Mucchielli, « Au procès d’un criminologue : escroquerie aux diplômes et expertises sur plateaux TV », Dalloz Actualité, 28 février 2019).
20 « Dupont de Ligonnès : à France Info, le fait divers était presque parfait », Acrimed.org (17/10/19).
21 On a ainsi pu lire ou entendre des choses sur le « profil psychiatrique » d’un terroriste (« Nice : le profil “mégalo-maniaque” de celui qui tue “pour marquer les esprits” », Europe 1, 18 juillet 2016).
22 Pierre Bourdieu, ibidem, p. 38.



