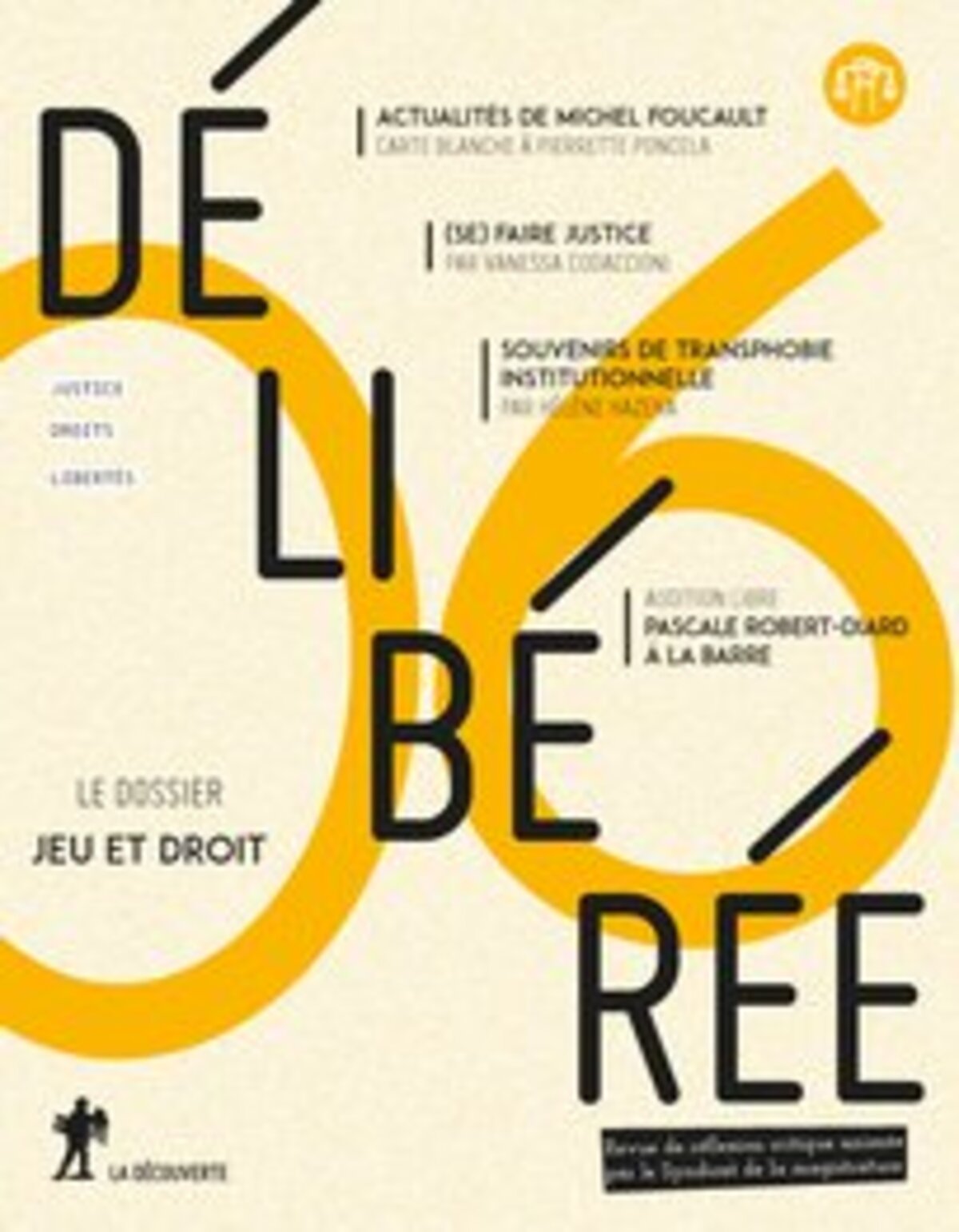
Ce texte, extrait du dossier du numéro 6 intitulé "jeux et droit", a été écrit par Liora Israël.
Liora Israël est maîtresse de conférences en sociologie à l'EHESS, membre du Centre Maurice Halbwachs. Spécialiste du droit et de la justice, elle a récemment travaillé sur la formation du droit des élites, le traitement judiciaire des discriminations ou encore les usages politiques du droit dans les années 1970.
La roue tourne, parfois. L'un des articles les plus cités dans les revues de droit nord-américaines eut beaucoup de mal à se faire publier : son auteur, Marc Galanter, dut user d'un subterfuge pour le faire publier dans une revue dont il était lui-même l'éditeur, afin de mettre fin à la longue suite de refus dont il venait de faire l'expérience. Achevé dès 1971, son article ne parut donc qu'en 1974 dans la Law and Society Review, et connaît depuis un succès considérable. Galanter en avait commencé la rédaction au retour de nombreuses années de recherche en Inde ; comme il le raconta plus tard, le regard nouveau qu'il porta à son retour sur le système en vigueur aux Etats-Unis était dû à ce déplacement. En effet, les recherches qu'il avait menées sur les tentatives de réforme visant à abolir le statut des intouchables lui avaient appris combien les règles ne constituaient qu'une partie de la réalité juridique. Ce regard dépaysé le conduisit également à se défaire du "triomphalisme juridique ambiant" qui, à la suite des victoires successives de la Warren Court en faveur des droits civiques, pouvaient faire croire à une coïncidence entre droit et progrès social1.
Un nouveau regard sur la justice
Intitulé dans sa version originale « Why the haves come out ahead ? Speculations on the limits of legal change »2, l'article entendait expliquer un phénomène attesté bien que contesté3 : le fait que l'institution judiciaire donne l'avantage aux mieux dotés. Pour démontrer ce qui apparaît toujours aujourd'hui à la fois comme un constat relativement partagé et une réalité déniée (puisque sa prise en compte devrait conduire à remettre en cause le système judiciaire dans son entier), Galanter s'appuya sur la relecture et l'analyse d'un nombre considérable de travaux de sciences sociales relatifs au fonctionnement de la justice. Ces travaux avaient en particulier émergé dans le sillage du courant Law and Society créé au milieu des années 19604, dont la Law and Society Review, où fut publié l'article, était la revue officielle. L'article était donc fondé, de façon originale, sur une analyse de seconde main de résultats de recherches empiriques, analyse qui reposait en premier lieu sur une analogie entre les parties devant la justice et des joueurs.
Souhaitant comprendre pourquoi la justice semblait toujours, ou le plus souvent, tourner au profit des plus forts, Galanter imagina de formaliser la scène judiciaire (en l'occurrence états-unienne) comme un jeu opposant de potentiels gagnants et perdants. Ces joueurs pouvaient être répartis selon lui en deux grandes catégories permettant de prévoir le résultat le plus probable, non pas en termes statistiques mais selon des raisons bien sociologiques exprimées dans l'article. Ainsi bien qu'apparemment proche, sa formalisation ne relevait pas de la théorie des jeux : si la justice n'était pas juste - et il apparaissait au regard des nombreuses enquêtes compilées par Galanter dans son article que c'était bien souvent le cas - ce n'était pas du fait d'anticipations erronées produites par ses acteurs. Au contraire, si certains gagnaient, c'est parce qu'ils savaient, pour la plupart d'entre eux (en tout cas les plus avisés) comment jouer devant la justice pour atteindre cet objectif. Ce que mit en évidence Galanter, c'est que les joueurs en présence, si l'on pouvait reprendre cette analogie pour parler des parties au procès, n'avaient pas les mêmes raisons d'agir : c'est en comprenant la structure de leurs intérêts qu'il devenait ainsi possible de mettre non pas en équation la justice, mais de trouver les raisons de sa tendance à toujours favoriser les mêmes.
Joueurs répétés versus joueurs occasionnels
A l'inverse de la plupart des analyses en sociologie du droit qui partent des règles existantes puis se penchent sur leur mise en œuvre, Galanter choisit de se focaliser sur les parties en présence, et de regarder comment leurs particularités affectaient la manière dont le système (c'est-à-dire le jeu) fonctionnait. Faisant reposer en premier lieu son analyse sur une opposition entre les mieux dotés et ceux qui ne le sont pas, les "haves" et les "haves not" du titre, Galanter remplaça rapidement ce binôme par celui, presque équivalent, des joueurs répétés (repeat players ou RP) et des joueurs occasionnels ou uniques (one-shotters ou OS) devant la justice. Cette translation, de la différente dotation en termes de ressources vers une différenciation en fonction de la propension à se trouver dans le prétoire, est ce qui permet d'expliquer comment la brutale asymétrie des revenus et des forces peut se transmuer dans l'enceinte judiciaire en chances inégales de voir advenir l'issue attendue.
Les joueurs répétés désignaient ceux qui utilisaient souvent les tribunaux, que ce soit pour porter plainte ou pour se défendre (par exemple des compagnies d'assurance ou des bailleurs) ; les joueurs occasionnels ou uniques décrivaient ceux qui n'avaient jamais ou rarement recours à la justice, le plus souvent des individus. Galanter n'oubliait pas l'existence de cas intermédiaires, comme celui du criminel professionnel (doté de peu de ressources mais habitué des prétoires) et décrivait d'ailleurs un continuum de situations plutôt qu'une stricte opposition entre les deux types de joueurs. Dans cette conception, le RP, si l’on essaie de synthétiser ses caractéristiques idéales-typiques, est une « unité » (pas forcément un acteur), qui a affaire aux tribunaux et qui anticipe d'y revenir, avec à chaque fois un enjeu relativement faible pour chaque affaire, et qui a les moyens de poursuivre des objectifs de long terme. Ce type de joueur dispose d’une capacité d’action plus routinière et rationnelle que celle d’un OS, qui a trop (ou à l’inverse trop peu) à perdre ou à gagner dans le procès pour développer le même type de rationalité. Apparaissent ainsi entre les OS et les RP deux formes de rationalité différentes qui correspondent à la fois à des ressources disponibles incommensurables, et à des attentes à l’égard du système judiciaire qui n’ont ni la même temporalité ni les mêmes enjeux : les joueurs répétés s’intéressent plus à l’évolution de la règle de droit (en intégrant la dimension jurisprudentielle), quand les joueurs occasionnels se focalisent sur la décision unique qui clôt « leur » procès. L'analogie avec le jeu permet donc une analyse fine de la manière dont joueurs répétés et occasionnels peuvent concevoir très différemment ce qui est pour eux une victoire ou une défaite.
Elle permet encore, de manière dynamique, de construire une typologie des scènes judiciaires selon les types d'acteurs qu'elles confrontent. Ainsi, la structure de jeu qui oppose deux joueurs occasionnels concerne surtout des questions familiales, telles que les divorces ou les affaires de tutelle ; le droit est dans ce cas mobilisé de façon purement instrumentale par les parties pour régler des problèmes concrets. Le second type d'affrontement, joueur répété contre joueur occasionnel, concentre une grande majorité des cas. Il s’agit du gros des procédures, engagées par des acteurs dont c’est une activité routinière ; ce contentieux de masse, dont une partie est réglée de façon transactionnelle, est typique du cas où le joueur répété est préoccupé par l'état des règles et leur évolution (assurance, commerce, etc.). Le troisième cas envisageable, dans lequel un joueur unique ou occasionnel initie l'affrontement contre un joueur répété est plus rare. Il s’agit surtout d’affaires comportant des enjeux en termes de dommages et intérêts, lorsqu’une personne considère qu’elle a été lésée par une entreprise ou une institution. Parfois, le conflit peut correspondre à une situation dans laquelle un joueur isolé cherche un appui pour s’affronter à une entité plus importante (par exemple un franchisé contre une compagnie-mère, ou un individu face à l'Etat). Bien évidemment, les joueurs répétés y sont aussi très préoccupés par l'évolution possible du droit. La dernière situation envisageable, dans laquelle deux joueurs répétés sont confrontés est, autant que faire se peut, évitée : les RP préfèrent souvent régler leurs différents par des transactions privées plutôt que par des confrontations publiques, que ce soit pour ne pas compromettre la poursuite de relations ou par souci de leur réputation. Mais des préoccupations d'un autre ordre, politiques ou morales, peuvent faire que l’une des deux parties préfère rendre publique l’existence d’un conflit. Un joueur répété d'un type bien particulier, l’État, peut jouer stratégiquement ou non sur ce registre, mais aussi être visé. Dans certains cas, les autorités publiques peuvent souhaiter que la justice prenne une décision, quitte à laisser planer une certaine incertitude sur celle-ci, pour ne pas en assumer complètement la responsabilité. Ce dernier cas correspond à des procès dont le fond est souvent plus technique, avec des attentes fortes en termes de sécurisation des règles du jeu de la part des deux parties en présence.
Un jeu de rôles en situation : le rôle des avocats et des institutions
À cette structure du jeu, Galanter ajoute ensuite une variable : celle du rôle des avocats. Il défend l’idée selon laquelle les parties qui ont des avocats sont favorisées, les avocats pouvant eux-mêmes être considérés, du fait de leur expérience professionnelle, comme des joueurs répétés. Leur rôle apparaît dès lors décisif dans l'équilibre ou le déséquilibre initial entre deux parties, et dans des proportions variables selon le type d'avocat et sa relation à son client. Galanter considère que plus l’avocat s’identifie à son client, plus il sera efficace. Cette capacité à s'identifier au client est bien entendue plus forte de la part des avocats dont la pratique est très concentrée, ce qui tend à favoriser les joueurs répétés qui sont des clients qui pèsent lourdement dans le chiffre d'affaire du cabinet dont ils dépendent. Pour les avocats dont la spécialisation correspond à des domaines dans lesquelles la clientèle est constituée principalement de joueurs uniques ou occasionnels (spécialistes du divorce, du droit du travail côté salarié…), la relation au client est bien plus fugace. Néanmoins, la spécialisation sur un domaine précis conduit aussi ce type d’avocats à avoir du point de vue de sa pratique une perspective de long terme. Toutefois, à l'échelle de chaque procès le défenseur recherche en général la maximisation des intérêts de son client individuel (la solution la plus avantageuse dans le cadre d'un divorce, les indemnités de licenciement les plus hautes...). Un autre type d’avocat de clients individuels, le pénaliste, vise a priori lui aussi l’intérêt immédiat de son client, c'est à dire l'obtention de l'absence de condamnation ou la peine la plus légère. Mais Galanter souligne que cet avocat se comporte aussi comme un membre de la communauté professionnelle des tribunaux dans lequel il travaille (« criminal court community »), et défend autant son client que sa réputation devant une enceinte familière le permet, évitant de prendre des risques inconsidérés (par exemple en tentant de défendre avec une énergie vaine le récidiviste qui sera à coup sûr condamné).
Ainsi, il n'oublie pas de prendre en compte la dimension institutionnelle du fonctionnement des tribunaux dans la compréhension de la structuration du jeu. L'engorgement des juridictions comme le poids des routines professionnelles contribuent aussi à avantager les joueurs répétés qui connaissent bien le fonctionnement de la justice et savent s'y conformer. Les règles existantes, normes juridiques mais aussi habitudes de fonctionnement, ont ainsi tendance à favoriser les intérêts dominants, non pas tant pour des raisons idéologiques comme le suggèrerait une approche trop rapidement critique de l’institution, mais aussi parce que la compréhension des règles en vigueur a permis à certain de s'y créer un espace de jeu favorable. La complexité du système judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’y voir une intention délibérée, le rend ainsi moins facile d’accès aux joueurs occasionnels et plus aisément praticable aux joueurs répétés.
* * *
La métaphore du jeu mobilisée par Marc Galanter permet de comprendre comment interviennent les asymétries de pouvoir à l'intérieur du tribunal. Loin d'influer de manière brute, celles-ci sont médiées par l'expérience variable des différents joueurs, ainsi que par la structure de leurs intérêts en jeu. Cette métaphore est sans doute à nuancer, notamment pour rendre compte de la situation de pays de civil law comme la France, dans lesquels le jeu est davantage un jeu à trois qu’un jeu à deux, du fait du rôle plus important conféré au magistrat. Galanter souligne aussi que des avocats engagés peuvent être en mesure de corriger certains déséquilibres, en constituant, par l'accumulation de cas, des effets comparables à ceux qui profitent aux joueurs répétés. Néanmoins, dans son pessimisme quant aux inégalités qui traversent la justice, cet article apparaît encore extrêmement convaincant, et continue à donner lieu à une abondante littérature visant à le décliner sur une multitude de terrains nationaux ou historiques pour en tester la validité. De manière similaire le livre marquant de Nicolas Herpin5 mettait lui aussi en évidence, en 1977 et dans le cas français, l'injustice flagrante de la justice, en l'occurrence en s'appuyant sur une enquête ethnographique au long cours menée dans ce qui s'appelait alors les audiences de flagrant délit.
Ce qui frappe aujourd'hui est la force de ces constats pourtant datés, et le caractère toujours convaincant de leurs explications dans un contexte de maintien des inégalités devant la justice. Celles-ci se sont même sans doute en partie accrues, par exemple du fait de la disparition des audiences au profit de la transaction ou du plaider-coupable, dans le cadre d'un processus là aussi brillamment décrit par Galanter bien des années plus tard dans The vanishing trial6. La situation n'est pas seulement grave : elle est peut-être bien désespérée, et dans ce contexte se tourner vers l'humour est peut-être le seul remède qui permette de la supporter. C'est ce que fit Galanter en engageant un chantier de recherche consistant à réunir un type spécial de blagues, les blagues d'avocats (lawyers jokes), visiblement très communes aux Etats-Unis, dont il rassembla plus de six cent exemples7. Toutefois, dans un article récent il analysait la disparition progressive de ces blagues hier si populaires : « (…) pour remplir la fonction de blague, une histoire doit avoir une chute, un rebondissement final qui nous surprend en même temps qu’il suit logiquement ce qui a précédé. Or actuellement, nous sommes tellement inondés par des conceptions cyniques que les idées que ces blagues portent (le caractère malléable du droit, son usage à des fins immorales, la corruption morale des avocats) ne sont plus assez surprenantes (ou difficiles à reconnaître) pour donner lieu à une chute finale. Autrement dit, ces considérations sur les avocats ne requièrent plus la voie détournée de l’humour et ont emprunté d’autres formes d’expression. »8
D'une certaine manière, le jeu ne vaudrait même plus la peine d'être joué.
Liora Israël
Pour vous abonner à notre revue Délibérée c'est ici ou là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info
1Marc Galanter, « Pourquoi les mêmes gardent l’avantage ? Introduction à la traduction française », Droit et société, no 85 (2013): 559 74.
2Marc Galanter, « « Pourquoi c’est toujours les mêmes qui s’en sortent bien ? » : réflexions sur les limites de la transformation par le droit », Droit et société n° 85, no 3 (1 décembre 2013): 575 640.
3 Notamment, comme l'écrit Galanter, par l'un de ceux qui rejeta l'article.
4Antoine Vauchez, « Entre droit et sciences sociales. Retour sur l'histoire du mouvement Law and Society », Genèses n°45, no 4 (2001): 134 149.
5Nicolas Herpin, L’Application de la loi: deux poids, deux mesures, Collection Sociologie (Paris: Éditions du Seuil, 1977).
6Marc Galanter, « The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts », Journal of Empirical Legal Studies 1, no 3 (1 novembre 2004): 459 570, https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2004.00014.x.
7Marc Galanter, Lowering the bar: lawyer jokes and legal culture (Madison, Wis: University of Wisconsin Press, 2005).
8Galanter, « Pourquoi les mêmes gardent l’avantage ? », op. cit.



