Cet article, paru dans la rubrique "Variations" (hors dossier), est tiré du numéro 24 de la revue Délibérée sorti en librairie le 27 mars 2025. Pour vous abonner c'est ici et pour en savoir plus sur la revue c'est là.
Dans ce texte, l'autrice présente les enjeux démocratiques de la liberté syndicale et d'expression des magistrat·es et les attaques qui sont portées à ces libertés. Elle était revenue sur ce sujet lors d'une soirée organisée à Paris début avril autour de la question du "gouvernement des juges", avec Vincent Sizaire, magistrat, et Judith Krivine, avocate (retrouver les informations ici).
Isabelle Boucobza est professeure de droit public à l’université Paris Nanterre, elle est directrice adjointe du Centre de Théorie et Analyse du Droit (UMR 7074) et directrice du Centre de Recherches et d’Études sur les droits fondamentaux (CREDOF).
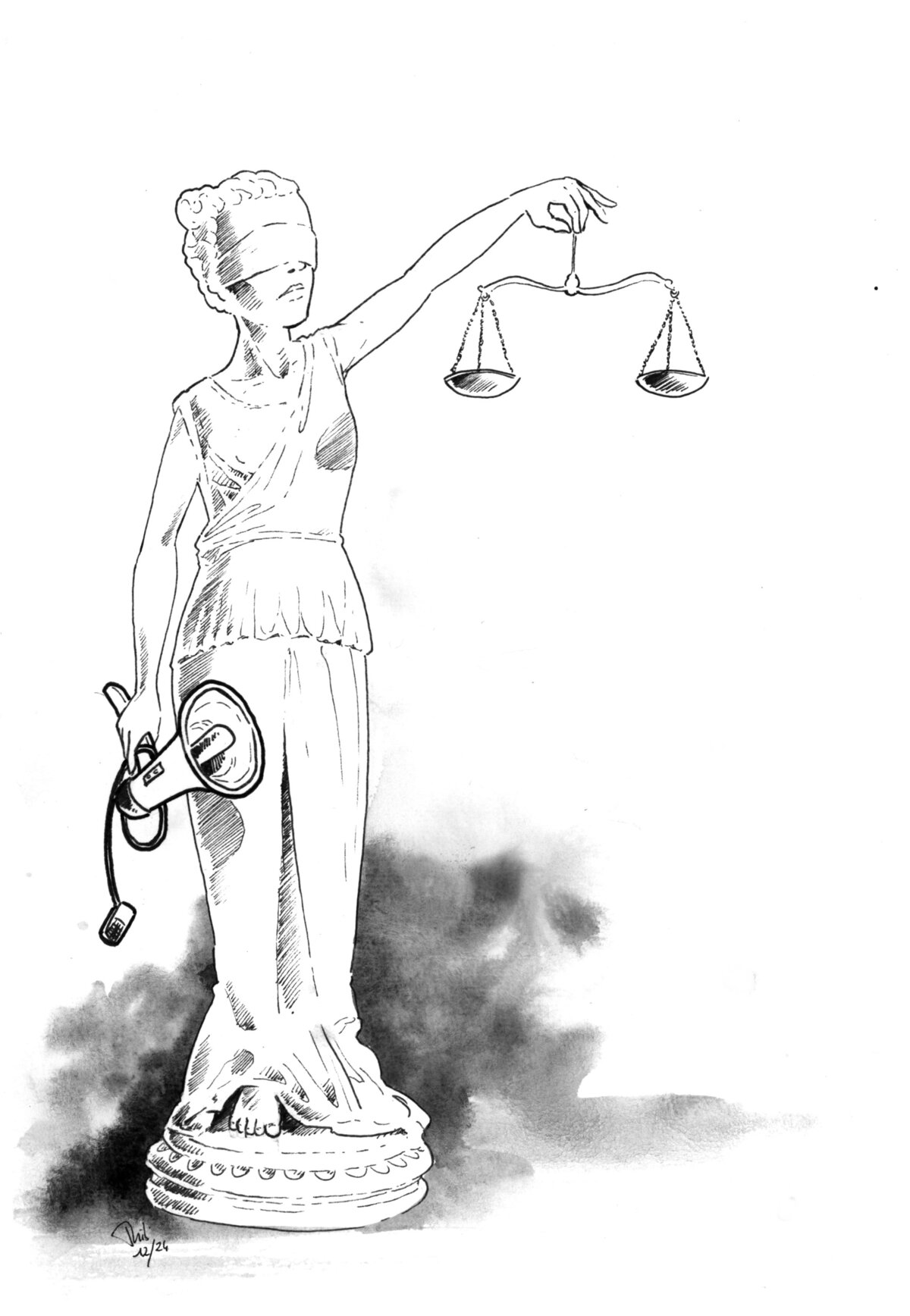
Agrandissement : Illustration 1
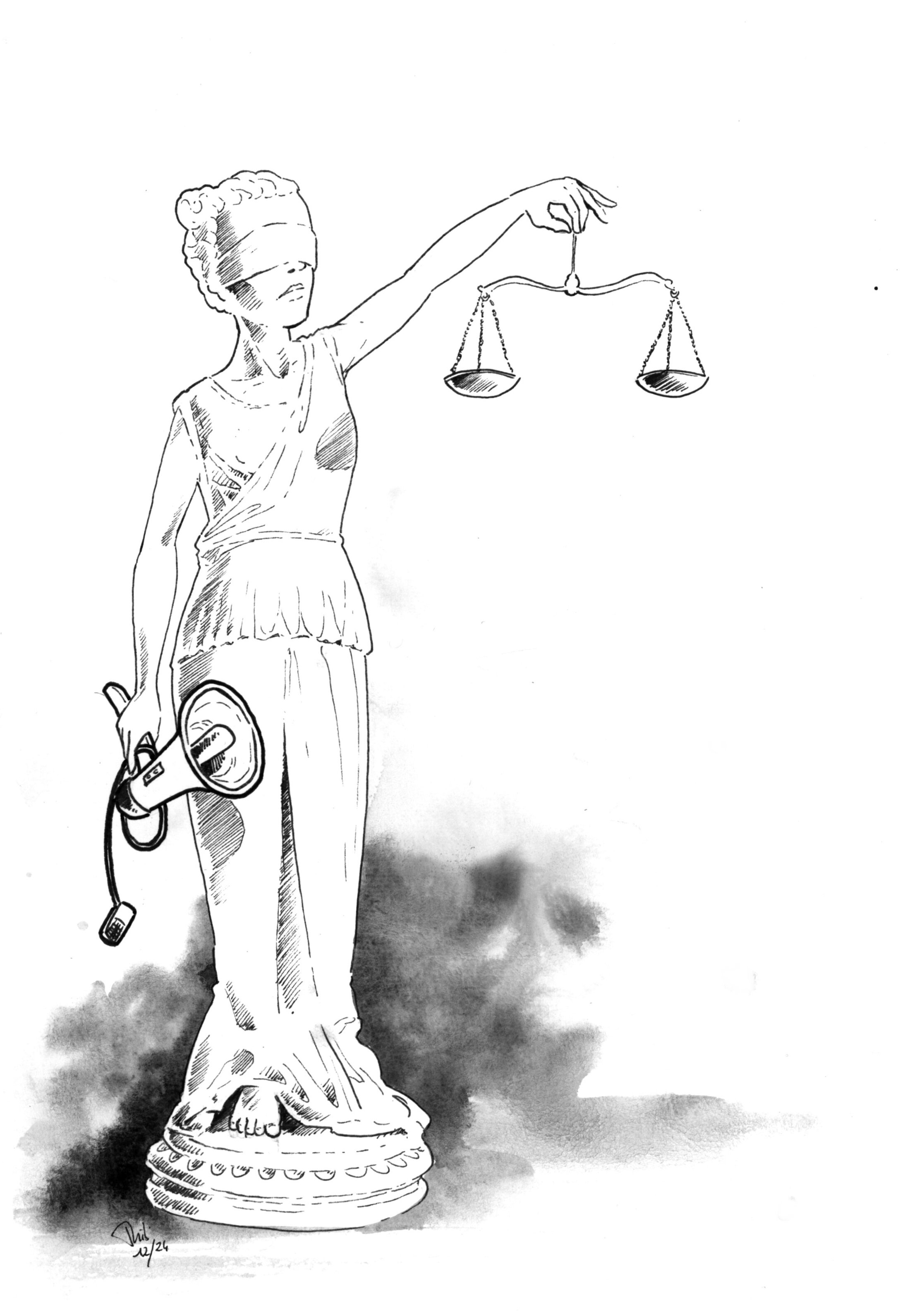
L’étude de la liberté d’expression des magistrat·es s’inscrit dans un contexte de bouleversement de l’État de droit et de la démocratie en Europe. Les attaques portées à la libre expression des juges, et plus largement à leur indépendance, font écho à d’autres attaques, contre la liberté d’expression des journalistes, des chercheur·euses, etc. On aurait tort de penser que seules les démocraties dites illibérales sont concernées. Certaines réformes relatives au statut des magistrat·es déjà intervenues en Hongrie ou en Pologne pourraient être adoptées en France ou en Italie. Elles semblent pensées pour neutraliser les magistrat·es en tant que potentielle limite au pouvoir des majorités politiques et en tant qu’organes de protection des droits et libertés. Du reste, ces réformes des systèmes de justice et des garanties d’indépendance des magistrat·es ne viennent jamais seules, elles sont généralement des accessoires d’autres lois attentatoires aux droits et libertés des personnes.
À l’heure où des partis d’extrême droite, connus pour leurs positions hostiles à l’égard des magistrat·es, sont au pouvoir ou à ses portes, la question des garanties européennes de la liberté d’expression de ces dernier·ères mérite d’être posée. En droit de l’Union européenne (UE ci-après) – auquel il est majoritairement fait référence ici –, les jurisprudences récentes sur les questions relatives à l’État de droit le montrent : la première garantie de la liberté d’expression des juges tient dans leur indépendance1 à l’égard du pouvoir politique. Son organisation doit mettre les juges en mesure de s’exprimer librement dans le débat public, pour défendre l’État de droit et la démocratie, leur propre indépendance, notamment quand ils·elles participent à des associations, à des manifestations, ou encore quand ils·elles écrivent dans des revues juridiques ou/et qu’ils·elles mènent une activité syndicale. Cette indépendance, qui permet de rendre libre leur parole, est également présentée, dans cette perspective, comme une garantie pour les justiciables eux-mêmes, les juges sont vu·es un peu comme des lanceur·euses d’alerte, dans le cadre d’une forme de dialogue avec la société.
Cette indépendance doit également, en principe, les mettre en mesure d’exercer leur fonction de juger en dehors des ingérences et pressions des pouvoirs et des parties aux procès. Or, dans les discours actuellement en vogue, le devoir d’impartialité des magistrat·es devrait s’étendre au-delà même de l’exercice de la fonction de juger, précisément dans le cadre de leur activité syndicale. S’interroger sur leur liberté d’expression à travers la question de ses garanties, c’est donc se demander aussi à quelles conditions réelles, selon quels aménagements concrets, les juges peuvent – dans l’exercice de leur fonction de juger ou en dehors de celle-ci – être en mesure de prendre part au débat public. C’est aussi se demander dans quelles limites cette « prise de parole » peut avoir lieu et si elle est bien compatible avec leur qualité même de juge. Quelles sont les réponses apportées par le droit de l’UE à ces questions ?
L’abondante jurisprudence sur les affaires polonaises relatives à l’État de droit et à l’indépendance des juges – dont le bilan est mitigé – permet de rappeler le cadre minimum des garanties de la liberté d’expression des magistrat·es. Au-delà des solutions tirées de ces décisions, les États conservent des marges d’appréciation plus ou moins importantes qui flirtent avec les limites posées.
Le bilan mitigé des garanties européennes : entre modèle minimum et modèle économiquement négociable de l’État de droit
Un modèle minimum de garanties défini par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
C’est à travers la tristement célèbre « saga polonaise » que la question des garanties de l’indépendance des magistrat·es et de leur liberté d’expression a été développée dans les jurisprudences de la CJUE (et la Cour européenne des droits de l’Homme). On retiendra qu’elle considère qu’un socle commun minimum doit être respecté et qu’il ne peut faire l’objet de régression. Les arrêts successifs rendus pour invalider les lois polonaises remettant en cause l’indépendance et l’impartialité de la justice établissent les garanties exigées eu égard aux modes de nomination des juges et à la composition de leur organe de tutelle : ils ne doivent ni l’un ni l’autre pouvoir servir de moyen de pression sur les magistrat·es pour établir un contrôle politique de la justice2.
Ce sont toutefois les décisions jurisprudentielles prises au regard de ladite « loi muselière »3– adoptée par le gouvernement polonais du parti Droits et Justice (PiS) – qui méritent une attention spécifique4 : cette loi montre que le pouvoir politique, via un organe disciplinaire qu’il contrôle, se donne les moyens de sanctionner très durement toustes les juges qui osent critiquer les réformes judiciaires qu’il mène5.
Ce pouvoir disciplinaire s’exerce évidemment sur la parole publique des juges mais également dans l’exercice de leur activité juridictionnelle. Dans les deux cas, les magistrat·es risquent gros : des retenues sur salaire, des suspensions, des poursuites pénales ou purement et simplement la révocation. Des procédures disciplinaires ou pré-disciplinaires ont en effet été initiées contre des juges qui ont parlé en public de l’indépendance de la justice, critiqué les réformes en cours, participé à des activités de sensibilisation du public aux questions liées à l’État de droit, c’est-à-dire en dehors de toute activité juridictionnelle. De même, comme le prévoit cette loi, des procédures disciplinaires ont été lancées en raison du contenu de décisions juridictionnelles, lequel peut lui-même être qualifié d’infraction disciplinaire, quand les juges résistaient aux lois nationales sur le fondement du droit européen, en utilisant le renvoi préjudiciel ou le contrôle de conventionnalité pour écarter leur application. La loi permettait d’ailleurs de prouver que ces décisions sont le fait d’engagements politiques, et non de l’application du droit en obligeant les juges à soumettre une déclaration écrite indiquant leur appartenance éventuelle à une association, à une fondation sans but lucratif ou à un parti politique. Ces informations sont ensuite mises en ligne, exposant les opinions politiques, religieuses, syndicales des juges et permettant ainsi aux justiciables ainsi qu’à leur hiérarchie, de contester leur impartialité et leurs décisions. En 2023, la Cour de Luxembourg a censuré cette loi considérée comme contraire à l’État de droit6.
À cette jurisprudence s’ajoute celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) protectrice en matière de liberté d’expression des juges. Ainsi, s’agissant des questions relatives au fonctionnement du système judiciaire, elle estime que l’expression des magistrat·es peut se transformer en devoir de s’exprimer publiquement pour la défense de l’État de droit et de l’indépendance de la Justice quand ces valeurs fondamentales sont menacées7.
Le bilan de cette saga jurisprudentielle est pourtant mitigé : certes, les jurisprudences ont donné du contenu à ce socle minimum de l’État de droit qui interdit des régressions, certes elles peuvent avoir un effet dissuasif pour d’autres États membres qui seraient tentés par des réformes ouvertement autoritaires sur le modèle polonais. Cependant, elles ont aussi donné le sentiment d’une forme d’impuissance de l’UE et plus largement de l’Europe, en raison de la lenteur des procédures et de la faible effectivité des décisions. Le recours à des politiques d’incitation économique a encore renforcé ce sentiment.
Des garanties négociables dans le cadre d’une politique d’incitation économique pour le rétablissement de l’État de droit
À cet égard, c’est en particulier la décision des institutions européennes de débloquer quelque 137 milliards d’euros du plan de « Reprise et Résilience pour la Pologne » qui donne le sentiment d’un double discours sur la protection de l’État de droit. En effet, cette décision a été perçue comme une façon de transformer les obligations juridiques qui s’appliquent aux États membres en une liste d’objectifs à atteindre avec des « cibles » et des « jalons ». Ces jalons, approuvés par la Commission et le Conseil, semblent pourtant contredire la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. En effet, au lieu de considérer les décisions de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise nulles et non avenues, comme l’exigeait la CJUE, ils prévoient que les juges sanctionné·es sur le fondement de lois censurées devront entamer une « procédure de révision » auprès de la Chambre de responsabilité professionnelle qui a remplacé la Chambre disciplinaire dissoute8.
Au-delà de cette question de réintégration des juges, le déblocage des fonds a été critiqué à plusieurs titres. D’abord, il établit le caractère négociable d’obligations légales que les autres États membres de l’UE respectent sans en attendre de récompense financière. Ensuite, ce déblocage a été réalisé alors même que le système judiciaire polonais n’avait pas été purgé de toutes les réformes illibérales introduites par le parti PiS au pouvoir de 2015 à 2023. L’état du système judiciaire polonais n’a pas changé de manière significative depuis que le gouvernement PiS a quitté le pouvoir. Cela vaut notamment pour la composition et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et du Conseil national de la magistrature. En somme, la politique d’incitation économique requalifie ces obligations juridiques en « étapes », les modifie au détriment des juges dont la liberté d’expression et l’indépendance ont été bafouées par des lois régressives. L’usage de ces nouveaux instruments peut faire craindre que l’UE tolère, comme elle le fait d’ailleurs sur d’autres questions (on peut penser par exemple à celle de l’indépendance du parquet), des différences importantes dans les garanties de l’indépendance et de la liberté d’expression des magistrat·es entre les pays membres.
À cette possible « géographie variable » des garanties entre les États européens s’ajoute la diffusion d’un discours de contestation de la liberté d’expression des magistrat·es et de ses garanties dans certains États membres comme la France ou l’Italie.
Des garanties contestées à l’échelle nationale et une arrière-pensée : la mise sous surveillance des juges syndiqué·es dans l’exercice de leur fonction
« Lorsque la Démocratie et les libertés fondamentales sont en péril, le devoir de réserve cède devant le droit à l’indignation », cette affirmation est tirée du guide des magistrat·es belges. En France, l’article 10 de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire adopté en 2023 (qui vient modifier le statut de la magistrature) dispose que « l’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leur fonction ni porter atteinte à l’indépendance de la justice ». L’exposé de ces deux dispositions illustre la distance qui peut exister entre les droits nationaux d’États membres de l’Union sur cette question. Le risque d’une extension de l’exigence d’impartialité à l’exercice de l’activité syndicale est ainsi réel pour les magistrat·es européen·nes, comme celui d’une mise sous surveillance dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.
L’extension de l’exigence d’impartialité à l’exercice de l’activité syndicale
En juin 2023, le sénateur Philippe Bonnecarrère proposait un amendement qui visait l’activité syndicale des magistrat·es en posant que « la liberté syndicale s’exerce dans le respect du principe d’impartialité qui s’impose à l’ensemble du corps judiciaire »9. Il le justifiait en ces termes : « Nous considérons que tout syndicat de magistrats a une liberté totale d’expression […]. Reste la notion d’impartialité. Elle est tellement importante qu’elle doit irriguer l’action individuelle des magistrats mais également l’action collective des magistrats. Nous ne voyons pas en quoi il pourrait y avoir une entrave à la liberté d’expression au travers de la notion d’impartialité ». C’est également une position adoptée en doctrine par le Professeur Bertrand Mathieu10 (qui a aussi été membre du Conseil d’État). Il pose la question de la compatibilité du syndicalisme judiciaire avec l’exigence d’impartialité et se prononce clairement en faveur d’un encadrement de l’activité syndicale des magistrat·es. Cependant, le propos qui expose en substance que « les politiques ne doivent pas critiquer les juges donc les juges ne doivent pas critiquer les politiques »11, ne distingue plus vraiment si le·la juge en question s’exprime dans le cadre de l’exercice de son activité syndicale ou de l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Et c’est probablement cette ambiguïté qui fait toute la difficulté.
La formulation de l’amendement du sénateur a été perçue par les magistrat·es et leurs soutiens comme une tentative de museler les juges, de les limiter dans l’exercice de leur expression publique dans le cadre de leur engagement syndical. Il aurait signifié pour les juges qu’il est préférable de s’abstenir de prendre parti sur des questions politiques ou des réformes législatives ou constitutionnelles qui intéressent directement leur activité professionnelle. Plus largement, cet amendement aurait pu être compris comme un moyen de les empêcher d’alerter publiquement les citoyen·nes sur des questions de justice, de droits et libertés, ou encore sur des questions de société sensibles. En effet, comment ne pas y voir une façon de tenter de dissuader les juges de jouer un rôle d’alerte à partir du moment où il devient difficile de savoir ce qui va relever ou non de la parole autorisée, sans s’exposer à un risque disciplinaire ?
La mise sous surveillance des magistrat·es syndiqué·es dans l’exercice de la fonction juridictionnelle
L’extension de l’exigence d’impartialité dans le champ de la liberté syndicale et de l’expression publique a une autre implication : elle insinue que les magistrat·es syndiqué·es pourraient, plus que les non-syndiqué·es, statuer de façon partiale et qu’ils·elles devraient être placé·es sous une surveillance spéciale lorsqu’ils·elles exercent leur activité juridictionnelle. L’attaque peut paraître moins frontale mais la nouvelle mouture de l’article 10, aujourd’hui en vigueur, évoque précisément l’exercice de la fonction : « l’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leur fonction ».
La cible réelle de cet usage extensif de l’exigence d’impartialité vise non pas tant la liberté d’expression ou la liberté syndicale que l’exercice de la fonction de juger tout court. Il est en effet difficile de ne pas y voir une tentative de la part des autorités politiques de faire pression sur les juges syndiqué·es pour leur dire à demi-mot : nous savons que lorsque vous jugez vous décidez des interprétations et des conséquences concrètes. Sachez que vous n’êtes pas légitimes pour l’exercer et que nous allons tout faire pour vous dissuader de l’exercer dans un sens qui pourrait nous déplaire.
Cette mise sous surveillance des juges engagé·es dans l’exercice même de leur fonction est assez facile à démontrer. C’est à peu près ce qu’il s’est passé avec la décision de suspendre l’évacuation des bidonvilles à Mayotte (opération « Wuambushu »). La juge a été accusée de manquer de neutralité12 en raison d’anciennes responsabilités syndicales, peu importe la qualité de son argumentation juridique. L’affaire de Mayotte a même fonctionné comme un argument décisif pour achever de convaincre la rapporteure du texte au Sénat d’adopter l’amendement bâillon évoqué précédemment. Aux yeux d’Agnès Canayer, « l’impartialité des magistrats existe, mais les incidents récents à Mayotte, par exemple, démontrent qu’il n’est pas inutile d’ancrer ce principe dans la loi. La commission a, de son côté, clarifié la définition de la faute disciplinaire et y a inclus les manquements au principe d’impartialité »13. Le Conseil supérieur de la magistrature avait pourtant immédiatement réagi à cette mise en cause en rappelant que « dans un État de droit démocratique, la critique d’une décision de justice ne doit en aucun cas s’exprimer par la mise en cause personnelle du magistrat auteur de la décision. Il réaffirme que la liberté syndicale est reconnue aux magistrats et rappelle que les prises de position d’une organisation syndicale ne sauraient servir de fondement à la mise en cause de l’impartialité d’un magistrat au seul motif qu’il serait membre de cette organisation »14.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, en Italie, la décision de la section immigration du tribunal de Rome de ne pas valider les transferts de migrant·es du territoire italien vers l’Albanie a déclenché des attaques sans précédent à l’égard de la magistrature accusée d’être politisée15. Des campagnes de dénigrement ont été lancées contre les sept magistrat·es du tribunal de Rome, accusés d’être « pro-migrant·es »16. Parmi ces juges, la présidente de Magistratura Democratica (proche du syndicat de la magistrature) a été mise en cause parce qu’elle a, en tant qu’experte dans les questions juridiques migratoires, pris, bien avant la décision contestée, des positions publiques, participé à des colloques où elle a discuté la légalité de l’externalisation de la demande d’asile des migrant·es sur le fondement de l’accord conclu avec l’Albanie. Les magistrat·es multiplient les communiqués de presse pour rappeler que cette décision est le résultat de « l’application de la primauté du droit de l’Union européenne et que l’accusation qui leur est portée d’avoir outrepassé leurs pouvoirs et d’avoir agi dans un but d’opposition politique au gouvernement, représente une atteinte très grave à l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi qu’au principe même de séparation des pouvoirs »17. Or, selon Giorgia Meloni, « il est très difficile de travailler et d’essayer d’apporter des réponses à cette Nation lorsque vous avez également l’opposition d’une partie des institutions qui sont censées vous aider à répondre aux problèmes de cette Nation »18. En d’autres termes, les magistrat·es devraient l’aider au lieu de s’opposer à la politique qu’elle mène et pour laquelle elle a été élue. En somme, à bien la lire, il ne semble pas demandé aux magistrat·es de ne pas faire de politique mais plutôt d’en faire en se mettant au service du gouvernement. En réponse, l’Association nationale des magistrats (ANM) rappelle qu’il n’est pas possible d’attendre du pouvoir judiciaire qu’il prenne des décisions inspirées par la nécessité de collaborer avec le gouvernement en place. S’il agissait en tenant compte des attentes politiques, le pouvoir judiciaire trahirait son mandat constitutionnel19. S’agissant de la liberté d’expression des magistrat·es, le secrétaire général de Magistratura Democratica, Stefano Musolino, renchérit : « Il s’agit d’un gouvernement souverainiste qui ne respecte pas les lois européennes et qui vise à faire taire la magistrature. Nous ne resterons pas silencieux et nous défendrons notre autonomie et notre indépendance. Nous ne voulons pas finir comme la Hongrie et la Pologne »20.
* * * *
Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.
Pour nous contacter : redaction@revue-deliberee.org
* * * *
1 « L’indispensable liberté des juges », selon les termes de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). CJUE, grande chambre, 24 juin 2019, aff. C-619/18 (Indépendance de la Cour suprême), paragraphe 60.
2 Voir notamment CJUE, grande chambre, 24 juin 2019, aff. C-619/18 ainsi que CJUE ord., 17 décembre 2018, Commission c. Pologne, aff. C-619/18 ; CJUE 5 novembre 2019, Commission c. Pologne, aff. C-192/18 (Indépendance des juridictions de droit commun) ; CJUE, grande chambre, 19 novembre 2019, A.K., aff. C-585/18, C-624/18 et C-625/18 (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), CP n° 145/19.
3 Loi modifiant les règles nationales relatives à l’organisation des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et de la Cour suprême adoptée le 20 décembre 2019 et entrée en vigueur le 14 février 2020.
4 CJUE, grande chambre, 26 mars 2020, aff. C-558/18 et aff. C-563/18 Miasto Łowicz, CP n° 35/20 ; CJUE, 15 juillet 2021, Commission c. Pologne (régime disciplinaire des juges), aff. C-791/19, CP n° 130/21. L’affaire relative au régime disciplinaire des juges avait donné lieu à une ordonnance de référé « mesures provisoires » (CJUE, ord., 8 avril 2020, Commission c. Pologne, aff. C-791/19 R.) puis à une série de trois ordonnances de référé dans l’affaire Commission c. Pologne (Indépendance et vie privée des juges). La première, datée du 14 juillet 2021 (aff. C 204/21), sera suivie de deux autres prononcées respectivement le 6 octobre (aff. C 204/21 R) et le 27 octobre 2021 (aff. C 204/21 R) (indépendance et vie privée des juges).
5 Étant précisé que la CJUE prend en considération tant les objectifs affichés que ceux implicitement poursuivis par la loi : la volonté de mettre à l’écart un certain groupe de juges, les influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, les effets d’intimidation et les effets dissuasifs. En d’autres termes, elle prend en compte le fait que ce n’est pas nécessairement l’imposition de sanctions disciplinaires qui est problématique, mais la crainte de telles sanctions qui peut entraîner une autocensure de la part des juges, v. CJUE, grande chambre, 26 mars 2020, aff. C-558/18 et aff. C-563/18 Miasto Łowicz.
6 Arrêt définitif de la CJUE, 5 juin 2023, Aff. C 204/21, Commission c. Pologne (Indépendance et vie privée des juges), CP n° 89/23.
7 Voir l’arrêt CEDH, 16 juin 2022, n° 39650/18, Zurek c. Pologne ; encore plus récemment CEDH, affaire Sarisu Pehlivan c. Turquie, n° 63029/19 ainsi que CEDH, 20 février 2024, n° 16915/21, Danilet c. Roumanie, où la Cour de Strasbourg a condamné l’État roumain sur la base de l’article 10 de la CEDH, qui protège la liberté d’expression, en raison de la sanction disciplinaire infligée à un juge roumain pour ses déclarations sur Facebook.
8 Le plan est actuellement contesté par quatre organisations internationales de juges qui considèrent que la Pologne ne remplit pas les conditions nécessaires à l’approbation du plan de relance, voir sur le site de MEDEL le communiqué commun de l’AEAJ, l’IAJ-EAJ, MEDEL, Judges for Judges : https://medelnet.eu/joint-press-release-of-aeaj-iaj-eaj-medel-judges-for-judges/.
9 Texte de l’amendement : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/662/Amdt_38.html.
10 Bertrand Mathieu, La Justice en question, Paris, Dialogues, coll. Mercuriales, 2024, p. 41 : « l’impartialité constitue le devoir essentiel du magistrat, le fondement de son pouvoir [...] il serait paradoxal de considérer que le droit de grève peut être interdit aux magistrats mais que leur liberté syndicale ne peut être encadrée ».
11 Bertrand Mathieu et Olivia Dufour, « Magistrats et libertés d’expression : la notion d’impartialité est fondamentale » in Actujuridique.fr, 13 octobre 2023.
12 Eugénie Boilait, « Qui est Catherine Vannier, la juge qui a suspendu la destruction d’un bidonville à Mayotte ? », Le Figaro, 27 avril 2023, https://www.lefigaro.fr/actualite-france/qui-est-catherine-vannier-la-juge-qui-a-suspendu-la-destruction-d-un-bidonville-a-mayotte-20230427.
13 Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, Sénat, séance du 8 juin 2023, https://www.senat.fr/seances/s202306/s20230608/s20230608.pdf.
14 Communication du 4 mai 2023, http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/publications/avis-et-communiques/communication-du-4-mai-2023.
15 Voir sur le site de Fratelli du 18 octobre 2024, un article intitulé « Albanie, les magistrats politisés font un travail d’opposition » (libre traduction), https://www.fratelli-italia.it/albania-magistrati-politicizzati-fanno-lavoro-opposizione/.
16 Voir l’article de Leonardi Blanc paru dans le journal Il Giornale, « Donc le juge à l’origine de la décision a préparé le blitz anti-gouvernemental » (traduction libre), https://www.ilgiornale.it/news/politica/cos-giudice-sentenza-preparava-blitz-anti-governo-2383633.html.
17 Voir sur le site de l’association professionnelle « Magistratura democratica », « Déclarations sur les attaques contre la justice italienne » (traduction libre), https://www.magistraturademocratica.it/articolo/dichiarazione-sugli-attacchi-contro-la-magistratura-italiana.
18 Voir le site du gouvernement italien, article du 18 octobre 2024, « Visite en Jordanie et au Liban, point de presse du président Meloni » (traduction libre), https://www.governo.it/it/articolo/visita-giordania-e-libano-punto-stampa-del-presidente-meloni/26871.
19 Voir sur le site de l’association professionnelle « Associazione nazionale magistrati », un article du 22 octobre 2024, « Le respect de la juridiction est une nécessité démocratique » (traduction libre), https://www.associazionemagistrati.it/doc/4423/il-rispetto-per-la-giurisdizione-una-necessit-democratica.htm.
20 Voir sur le site du journal Corriere della Calabria l’article du 22 octobre 2024, « Musolino : “Meloni veut nous asservir, le risque, c’est d’être comme la Hongrie” » (traduction libre), https://www.corrieredellacalabria.it/2024/10/22/musolino-meloni-ci-vuole-asserviti-il-rischio-e-lungheria/.



