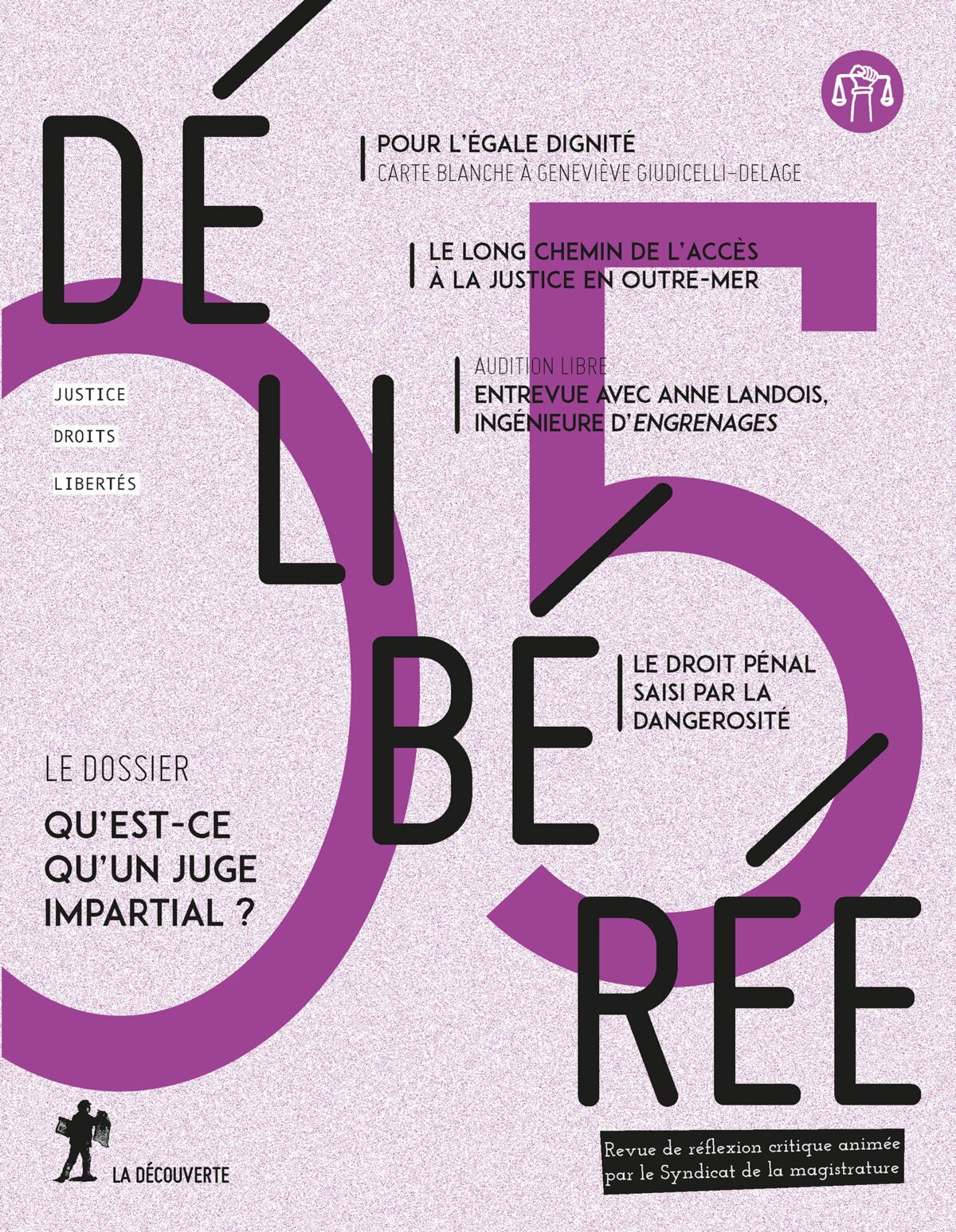
Agrandissement : Illustration 1

Ce texte, extrait du dossier du numéro 5 consacré à l'impartialité, a été écrit par Matthieu Bonduelle et Thérèse Renault.
Matthieu Bonduelle est vice-président chargé de l'instruction au TGI de Paris après avoir exercé à Mulhouse, Bobigny et Créteil, il est ancien secrétaire général et président du Syndicat de la magistrature (SM).
Thérèse Renault est première conseillère des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Elle exerce les fonctions de rapporteur publique au tribunal administratif de Paris. Elle est membre du Syndicat de la juridiction administrative (SJA).
« Il n’est pas de vice si simple qui n’affiche des dehors de vertu. »
William Shakespeare, Le Marchand de Venise
Le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé à maintes reprises1, en se fondant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. ». La Convention européenne des droits de l’homme en fait également l’une des garanties du droit à un procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] par un tribunal indépendant et impartial » (article 6§1). Le juge ne doit donc pas seulement être indépendant du pouvoir politique, mais encore – si l’on peut dire – de la chose à juger elle-même : nul n’est juge en sa propre cause (nemo judex in causa sua). Comment cet impératif élémentaire se traduit-il, non seulement dans les règles qui gouvernent la profession de magistrat, mais aussi dans un certain discours politique sur la justice ? Quel visage du juge impartial ces usages dessinent-ils ?
Une valeur cardinale pour des juges humains
Étonnamment, le devoir d’impartialité ne figure pas dans le serment des magistrats de l’ordre judiciaire mentionné à l’article 6 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. On en trouve cependant la trace aux articles 7-1 (prévention des conflits d’intérêts), 8 à 9-1-1 (régimes d’incompatibilité) et 43 (« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état... »). Il est surtout consacré de longue date par la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats du siège et doit être consulté avant toute sanction prononcée par le garde des Sceaux contre un magistrat du parquet. Le CSM exerce plus généralement une mission de « veille déontologique » et a publié en 2010 un Recueil des obligations déontologiques des magistrats2 articulé autour de six « valeurs cardinales », dont l’impartialité (en deuxième position, juste après l’indépendance et avant l’intégrité, la légalité, l’attention à autrui et enfin la discrétion et la réserve). Elle est décrite comme un « devoir absolu, destiné à rendre effectif l’un des principes fondateurs de la République : l’égalité des citoyens devant la loi » ou encore comme « un élément essentiel de la confiance du public en la justice ».
S’agissant de l’ordre administratif, les articles L.131-2 et L.213-1-1 du Code de la justice administrative – issus de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 créant par ailleurs un Collège de déontologie de la juridiction administrative – prévoient que les membres du Conseil d’État ainsi que les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel « exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ». L’impartialité et l’indépendance sont définies comme des « principes fondamentaux » par la Charte de déontologie de la juridiction administrative, adoptée en 2011 et rénovée en 20173.
On l’aura compris : l’impartialité du juge est une affaire sérieuse, et c’est heureux. On est loin, dès lors, de la représentation d’un juge automate, appliquant mécaniquement la loi. S’il est si important que le juge soit impartial, c’est bien qu’en disant le droit il contribue à le créer – une évidence qui cesse de l’être (pour les « profanes » comme pour les juristes eux-mêmes) dès lors qu’on naturalise le droit, tentation constante. C’est bien aussi que ce juge a une histoire, qu’il est pris dans la société : il ne s’agit donc pas de l’en extraire, mais d’identifier et de traiter les inévitables situations problématiques que cette immersion dans la vie sociale génère.
Une exigence à géométrie variable
Afin de garantir l’impartialité des juges, le CSM évoque « la mise en œuvre de principes institutionnels, fonctionnels et personnels » (p. 7-12 du Recueil).
Les principes institutionnels portent sur les modalités de nomination et d’affectation des magistrats, les incompatibilités professionnelles, etc. Un certain « laxisme » doit être ici souligné. Dans l’ordre judiciaire d’abord, il convient de rappeler qu’au sein du CSM lui-même, celui de ses membres chargé d’instruire une procédure disciplinaire (le « rapporteur ») a longtemps participé à l’audience ainsi qu’au délibéré portant sur ladite procédure... Il a fallu attendre une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans une décision de 2011 portant sur la procédure disciplinaire des vétérinaires, pour que le rapporteur cesse de prendre part à la décision du CSM4. Dans un registre différent, il est frappant d’observer la réticence qu’ont souvent les parquets à « dépayser »5 des procédures pénales mettant en cause des policiers, des avocats, des greffiers voire des magistrats du ressort de la juridiction concernée, alors que leur instruction ou leur jugement sur place est susceptible de troubler, non seulement les relations entre ces professionnels, mais aussi l’image d’impartialité offerte aux parties. Le CSM relève par ailleurs que « le principe d’impartialité d’une juridiction et des membres qui la composent implique que les modalités de nomination et d’affectation des magistrats reposent sur des règles d’application objective et transparente, fondées sur les compétences professionnelles ». On rappellera seulement à ce sujet, d’une part, que la Chancellerie choisit 100 % des magistrats du parquet et plus de 95 % des magistrats du siège selon des critères souvent obscurs6 et, d’autre part, que les chefs de juridiction disposent d’une grande liberté pour affecter les magistrats au sein des services qui composent la juridiction. Le CSM estime aussi que « l’impartialité appelle des moyens matériels, budgétaires et humains qui procurent aux magistrats et aux juridictions des conditions de travail et de fonctionnement excluant toute dépendance à l’égard des personnes, publiques ou privées, même dans des situations exceptionnelles » : la pauvreté notoire de la justice française7 parle à cet égard d’elle-même.
La juridiction administrative pose quant à elle un problème institutionnel spécifique : la dualité des fonctions du Conseil d’État (CE), juge de l’administration et conseil du Gouvernement. Certes, après plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)8, il a été mis fin en 2008 à la possibilité pour un membre du CE d’être successivement conseiller et juge dans une même affaire, et ses formations juridictionnelles et consultatives ont été « désimbriquées ». La CEDH a d’ailleurs validé son organisation9. La jurisprudence a, en outre, permis de préciser les conditions dans lesquelles un même juge peut connaître, dans différentes fonctions, d’une même affaire10. L’hybridité du Conseil d’État n’en demeure pas moins problématique. Ainsi Jean-Marc Sauvé pouvait-il déclarer à la veille de quitter ses fonctions de vice-président du Conseil : « Quand un ministre me demande un nom pour rédiger un rapport, diriger un cabinet ou une mission, je m’efforce de lui proposer le bon profil »11. C’est que, comme le rappelait Édouard Philippe, Premier ministre et membre du CE, lors de l’installation du nouveau vice-président Bruno Lasserre le 6 juin 2018, l’une des missions du Conseil est de fournir l’administration en hauts responsables. À ceux qui s’étonnent d’une telle porosité des fonctions, les plus hautes autorités de la juridiction administrative opposent avec une remarquable constance le même argument : pour bien juger l’administration, il faut bien la connaître, et pour qu’une administration marche droit, il faut qu’elle soit, sinon entre les mains, du moins largement irriguée par le savoir-faire des éminents juristes du Conseil d’État au service du seul intérêt général12. Face à ces protestations d’efficacité et de vertu, qu’il soit permis d’alerter la haute juridiction sur le risque d’aveuglement qui la menace : à trop fréquenter l’administration, ne risque-t-on pas d’en adopter les présupposés, d’en intérioriser les contraintes, d’en reproduire les raisonnements – surtout si on a contribué à les façonner –, au risque de délégitimer les présupposés, les contraintes et les raisonnements de la partie adverse ? C’est ainsi que le Premier ministre s’est dit à l’écoute de « toutes les idées [...] pour faire vivre et renforcer le lien entre le Conseil d’État et l’administration », c’est-à-dire entre une partie et son juge... Ce péché d’orgueil ne serait pas si grave si le mélange des genres pratiqués par le CE ne rejaillissait sur l’ensemble de la juridiction administrative, du fait de sa « discipline juridictionnelle » d’une part, du pouvoir qu’exerce le Conseil sur les niveaux juridictionnels inférieurs en gérant le corps des magistrats administratifs d’autre part.
Les principes fonctionnels portent en particulier sur ce que le CSM appelle une « absence apparente de préjugés » doublée d’une « absence réelle de parti pris » des magistrats. Cette dernière renvoie à une forme d’ascèse du juge, « pour qu’il soit libre d’accueillir et de prendre en compte tous les points de vue débattus devant lui ». L’intériorité du juge étant par définition incontrôlable, ce principe apparaît quelque peu incantatoire, même s’il rappelle une chose essentielle : l’impartialité est un métier. Certains en déduisent abusivement que le juge doit d’abstenir de toutes convictions. Outre que cela revient à exiger la réalisation d’un idéal impossible, cette conception sert incontestablement les intérêts conservateurs – il n’est dès lors pas surprenant de la voir relayée par nombre d’autorités hiérarchiques. Dans l’ordre judiciaire, la mention dans une évaluation de ce qu’un magistrat est « engagé » est ainsi notoirement péjorative – et ne s’applique qu’à des magistrats progressistes. C’est un point aveugle chez les juges administratifs, qui refusent même la possibilité de se regarder comme « engagés ». Les seules convictions acceptables seraient donc celles qui ne bousculent en rien l’ordre établi. Quant à l’apparence, elle est aussi diversement appréciée : qu’un juge des libertés et de la détention (JLD) fasse une application rigoureuse des critères de la détention provisoire et il est démis de ses fonctions à la suite d’une campagne de presse lancée par des policiers13 ; qu’un autre remette en liberté des dizaines d’étrangers malgré la pression hiérarchique et la Chancellerie lui réclame des comptes14 ; qu’en revanche, trois membres de la chambre sociale de la Cour de cassation soient rémunérés par une entreprise (pour participer à des formations ou rédiger des articles) puis prennent part à une décision qui lui est favorable et le premier président de la Cour en personne – par ailleurs président du CSM – diffuse un communiqué pour prendre leur défense (tout en appelant les magistrats à « une vigilance accrue » en matière d’impartialité objective...)15.
Enfin, l’approche personnelle s’attache, en dehors de l’exercice juridictionnel, aux engagements du magistrat et à son expression publique. Pour le Recueil du CSM, « si le magistrat bénéficie des droits reconnus à chaque citoyen, il ne peut cependant souscrire aucun engagement de quelque nature qu’il soit (politique, philosophique, confessionnel, associatif, syndical, commercial...), ayant pour conséquence de le soumettre à d’autres contraintes que celles de la loi républicaine et de restreindre sa liberté de réflexion et d’analyse. […] Il se comporte ou s’exprime en public avec prudence et modération ». Les membres de la juridiction administrative sont également soumis à un devoir de réserve16. Selon la Charte précitée, leur expression publique « ne doit pas risquer de porter atteinte à la nature ou la dignité des fonctions exercées » et « la plus grande prudence s’impose » à eux, « même lorsqu’ils s’expriment sous leur nom », concernant « toutes leurs opinions, qu’elles soient d’ordre politique, juridique, religieux ou associatif ». Ces énoncés frappent par leur généralité : il s’agit de ratisser large. Leurs présupposés sont éminemment discutables : l’engagement est spécialement corrupteur et l’expression individuelle engage l’institution elle-même. On voudrait dissuader les magistrats d’exercer leurs droits – à commencer par celui de se syndiquer ou d’exprimer un point de vue critique – qu’on ne s’y prendrait pas autrement... Ainsi, lorsqu’une dizaine de juges administratifs publient anonymement une tribune pour alerter sur les dangers de la constitutionnalisation de l’état d’urgence17, le vice-président du Conseil d’État tente pendant plusieurs semaines d’identifier les « traîtres »18. À tout le moins, on retrouve ici la représentation d’un magistrat d’autant plus irréprochable qu’il serait impénétrable. Étrange idée quand on voit les projections fantasmatiques dont les magistrats les moins bavards (et même les plus paranoïaques) font immanquablement l’objet dès lors qu’ils se retrouvent exposés malgré eux à l’occasion de telle ou telle affaire sensible... En réalité, on passe ici explicitement de l’impérieux devoir d’impartialité à une exigence attrape-tout de neutralité sous prétexte d’irréprochabilité – au risque d’entretenir la mécanique infernale du soupçon.
Une notion falsifiée à des fins politiques
Bien sûr, il est aussi question dans ces corpus déontologiques de garde-fous structuraux qui ne soulèvent guère de difficultés, tels que la publicité des débats19 ou leur caractère contradictoire. L’institution n’en demeure pas moins largement aveugle ou complaisante à des formes de partialité systémique20, mettant davantage l’accent sur la responsabilité individuelle – quitte, on l’a vu, à travestir en l’étirant à l’infini la notion même d’impartialité.
Cette attention plus forte à l’acteur qu’au système entre en résonance avec une certaine obsession politique pour la figure du juge justicier. Lorsqu’il se confronte au monde politique, le magistrat est en effet presque toujours taxé de partialité. Qu’il mette en examen un homme ou une femme politique (de droite de préférence), qu’il use de sa liberté d’expression21, qu’il pratique un syndicalisme offensif ou même qu’il soit simplement saisi d’un dossier politiquement sensible et l’on tente de le délégitimer en le cataloguant. C’est ainsi qu’on ne compte plus les responsables politiques attaquant frontalement les juges à l’occasion de telle ou telle affaire, de Nicolas Sarkozy à Marine Le Pen en passant par François Fillon ou Jean-Noël Guérini. Les besoins propres de la défense pénale rejoignent ici des motifs politiques plus profonds : qui ne veut pas d’une justice indépendante l’accuse de partialité – et quelle meilleure preuve de partialité que le fait de s’en prendre à une personnalité politique ?
Au besoin, on fouillera dans le passé du magistrat pour mieux prétendre le démasquer : les juges Jean-Michel Gentil et Serge Tournaire ont signé un texte appelant à mieux lutter contre la corruption, c’est donc qu’ils ont un parti pris contre Nicolas Sarkozy qui était alors au pouvoir (et contre la corruption sans doute aussi) ; la juge Claire Thépaut a été déléguée régionale du Syndicat de la magistrature (SM), c’est donc qu’elle a un parti pris contre Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen (et probablement d’autres), etc. Dans un registre à peine différent, l’impartialité d’un membre du Conseil d’État ayant pris part à l’ordonnance du 26 août 2016 sur le « burkini » a été mise en cause par une certaine presse au motif qu’il avait rédigé en 2013 un rapport sur l’intégration prônant une « société inclusive ».
Pour être convaincu de partialité, mieux vaut que le juge soit « rouge » : dans l’ordre judiciaire, on dira donc qu’il est membre du Syndicat de la magistrature, même s’il n’en est rien. Allant au bout de leur logique, certains vont jusqu’à prôner l’interdiction du syndicalisme judiciaire, ou à tout le moins du SM, au nom de l’impartialité22. Comme si un syndicat, fût-il de magistrats, se devait d’être impartial – et pouvait l’être. Comme si chacun de ses membres pouvait être tenu individuellement responsable, non seulement de chacune de ses prises de position, mais de ce que celles-ci recèleraient de « parti pris » dans une affaire particulière. Comme si être « de gauche » disait plus qu’autre chose la manière dont on va rendre la justice dans tel ou tel cas. Il n’est alors plus du tout question d’impartialité, mais d’un combat politique contre une partie de la magistrature et, au-delà, de la volonté de maintenir la justice « à sa place », c’est-à-dire à sa botte. Bref, de la neutraliser. Il est à cet égard regrettable de voir des magistrats s’arc-bouter sur un « apolitisme » qui brouille le concept d’impartialité en entretenant le mythe de leur neutralité23 et qui, loin de les protéger, appauvrit leur expression, affaiblit leur rôle démocratique et les expose au grief de corporatisme. Au sein de la juridiction administrative, où la question politique se pose de manière beaucoup plus feutrée, cette posture est revendiquée par ses membres comme une vertu et une fierté. Elle est pourtant, de même que le culte du précédent, éminemment politique : tous deux favorisent le conservatisme et disqualifient la prise de risque, la solution audacieuse, au profit d’un conformisme dont les hérauts appartiennent rarement au camp des progressistes.
Pour paraphraser Péguy, un juge détaché de toute préférence personnelle a les mains pures, certes, mais il n’a pas de mains. Garantir autant que faire se peut son impartialité – enjeu majeur – est donc avant tout une affaire de responsabilité collective et d’assurances objectives. À cet égard, la collégialité des décisions apparaît essentielle. Pourtant, dans un souci de réduction des coûts de l’activité juridictionnelle, le nombre de contentieux soumis à une formation de jugement collégiale se réduit comme peau de chagrin, et ce dans les deux ordres de juridiction. « Juge unique, juge inique » disait-on hier ; « juge économique » pense-t-on aujourd’hui. L’idéal serait qu’en plus, il ne fasse pas de vagues.
Matthieu Bonduelle et Thérèse Renault.
Vous pouvez lire l'édito de ce numéro consacré à l'impartialité ici.
Pour vous abonner à notre revue Délibérée c'est ici ou là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info
1 Cf. notamment ses décisions n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 (cons. 3), n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 (cons. 3) et n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 (cons. 4).
2 http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil_des_obligations_deontologiques_des_magistrats_fr.pdf
3 http://www.conseil-etat.fr/content/download/94218/906715/version/6/file/Charte-deontologie-26062018-vs-digitale.pdf
4 Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 (cons. 13).
5 En application de l’article 43 du Code de procédure pénale.
6 Cf. Jean-Baptiste Jacquin, « Le débat escamoté sur l’indépendance de la justice », Le Monde, 16 juillet 2018.
7 Lire Olivia Dufour, Justice, une faillite française ?, LGDJ, 2018.
8 CEDH, 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg ; 6 mai 2003, Kleyn c. Pays-Bas ; 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines.
9 CEDH, 30 juin 2009, UFC Que Choisir de Côte d’Or c. France.
10 Cf. notamment CE, 12 mai 2004, Commune de Rogerville ; 7 décembre 2006, Mme Sene ; 11 février 2005, Commune de Meudon.
11 Jean-Baptiste Jacquin, « Jean-Marc Sauvé, au cœur de la machine de l’État », Le Monde, 29-30 avril 2018. Lire aussi le savoureux billet de Paul Cassia sur son blog, « Le Conseil d’État vu par son futur ex-vice-président », Mediapart, 9 mai 2018.
12 Voir par exemple les allocutions de Jean-Marc Sauvé en ligne sur le site du Conseil d’État, notamment : « Justice administrative et état de droit », 10 février 2014 ; « Le nouveau contexte de l’exigence de la déontologie dans la sphère publique », 3 juin 2016.
13Camille Polloni, « Un juge de Créteil victime de la vindicte policière », Les Inrockuptibles, 17 juin 2010.
14Maryline Baumard, « Devoir de réserve : un juge sommé de s’expliquer », Le Monde, 23 avril 2016.
15 Marc Chevallier, « Cour de cassation : un conflit d’intérêts, où ça ? », Alternatives Économiques, 4 mai 2018.
16 Articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du Code de justice administrative.
17 https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/291215/etat-d-urgence-des-juges-administratifs-appellent-la-prudence
18Jean-Baptiste Jacquin, « Jean-Marc Sauvé, au cœur de la machine de l’État », ibid.
19 Même si sa pratique, en dehors des exceptions légales, est loin d’être satisfaisante. On songe par exemple à ces JLD ou ces chambres de l’instruction qui l’écartent systématiquement, inversant de fait le principe et l’exception résultant de la loi.
20 D’autres problèmes n’ont pas pu être abordés ici, en particulier ceux posés par l’unité du corps judiciaire (procureurs et juges).
21 Voir par exemple http://www.syndicat-magistrature.org/L-impartialite-selon-Pascal.html ou http://www.syndicat-magistrature.org/Quand-la-ministre-de-la-Justice.html.
22 Éric Ciotti, Henri Guaino, Marine Le Pen ou encore Guillaume Larrivé se sont notamment prononcés en ce sens.
23 Lire à cet égard Franck Johannès, « Ce que montre le “mur des cons” : la neutralité du juge est un leurre », Le Monde, 30 avril 2013.



