Ce texte, paru sous le titre CJIP : l'arbre qui cache la forêt, est tiré du numéro 20 de la revue Délibérée, Vivants contre vivant, qui sort en librairie ce 7 décembre. Dans le contexte du déréglement climatique, Délibérée a essayé de cerner la manière dont les dispositifs juridiques tranchent en faveur d'une catégorie de vivants plutôt qu'une autre. Ainsi par exemple, est-il pertinent de privilégier l'énergie propre fournie par les moulins à eau qui par ailleurs mettent en péril la vie aquatique ? Est-il juste d'abattre des bouquetins au prétexte qu'ils risquent de contaminer des troupeaux de vaches laitières ? Autant de situations, à la dimension éminemment politique, qui illustrent à travers les réponses majoritairement apportées, une forte domination anthropocentrée et appellent un autre regard pour esquisser des solutions (voir notre édito). Mais pour palier l'indigence des moyens de la justice judiciaire pour lutter contre les atteintes à l'environnement, le choix d'introduire en droit français une procédure pénale négociée pour les personnes morales - la CJIP - qui tord les règles, écarte le juge du processus décisionnel ainsi que toute mention au casier judiciaire, mérite sérieusement d'être débattu.
Léa Clouteau est magistrate et membre du syndicat de la magistrature dont elle co-anime le groupe de travail sur l’écologie. Elle a exercé les fonctions de juge placée et de substitute du procureur et est actuellement en disponibilité. Elle a auparavant effectué plusieurs missions en matière de lutte contre le blanchiment au sein d’établissements privés. Lara Danguy des Déserts est également magistrate, membre du SM et co-coordinatrice de la rédaction de la revue Délibérée. Elle a exercé ses fonctions au parquet ainsi qu’en tant que juge d’application des peines et juge d’instruction. Ancienne conseillère de la garde des Sceaux, elle a travaillé au sein de l’administration pénitentiaire et en détachement au ministère des Affaires étrangères sur les questions de justice pénale internationale.
* * * *

Agrandissement : Illustration 1
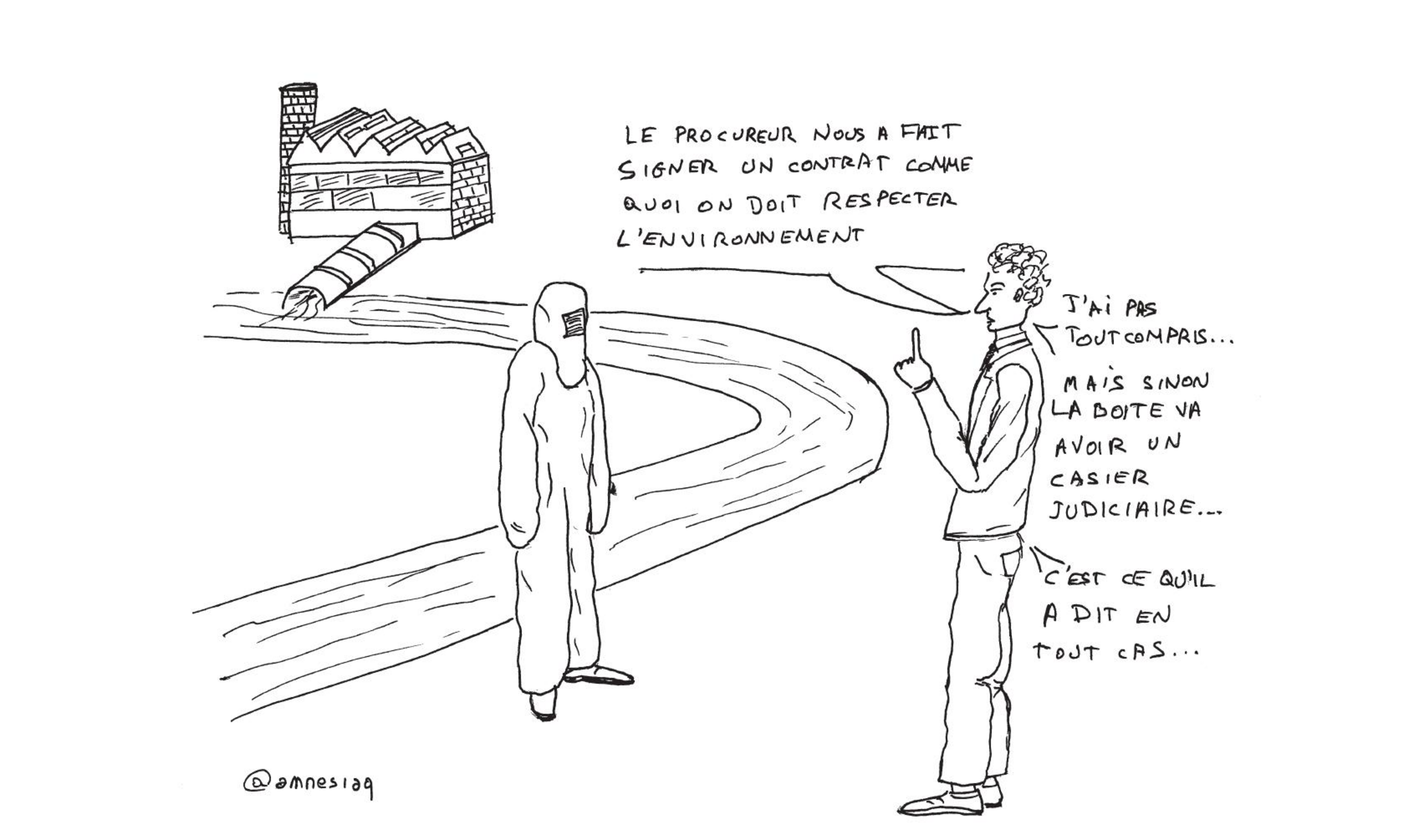
Pragmatisme. C’est le mot qui s’impose quand cette nouvelle mesure est évoquée. Quatre ans après l’introduction en droit français de la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) pour les atteintes à la probité par la loi dite Sapin II du 9 décembre 2016, cette alternative aux poursuites a été étendue à tous les délits du Code de l’environnement1 et leurs infractions connexes par la loi du 24 décembre 20202. Elle est présentée dans la circulaire d’application comme un moyen de « pallier l’absence de dispositif transactionnel permettant un traitement efficace et rapide des procédures ouvertes pour des atteintes graves à l’environnement»3.
Malgré sa création récente, le peu de recul sur son efficacité et une utilisation limitée, elle suscite un engouement quasi unanime tant parmi les professionnel·les s’intéressant à la protection du vivant (associations, avocat·es) que parmi les acteurs institutionnels (magistrat·es spécialisé·es, inspecteur·ices de l’environnement) et les représentant·es d’entreprises. Le rapport de la Cour de cassation sur la justice pénale environnementale du 7 décembre 20224 comme les représentant·es du ministère de la Justice lors du séminaire des parquetier·es en charge du contentieux de l’environnement en mars 2023 incitent à une plus grande utilisation de ce dispositif.
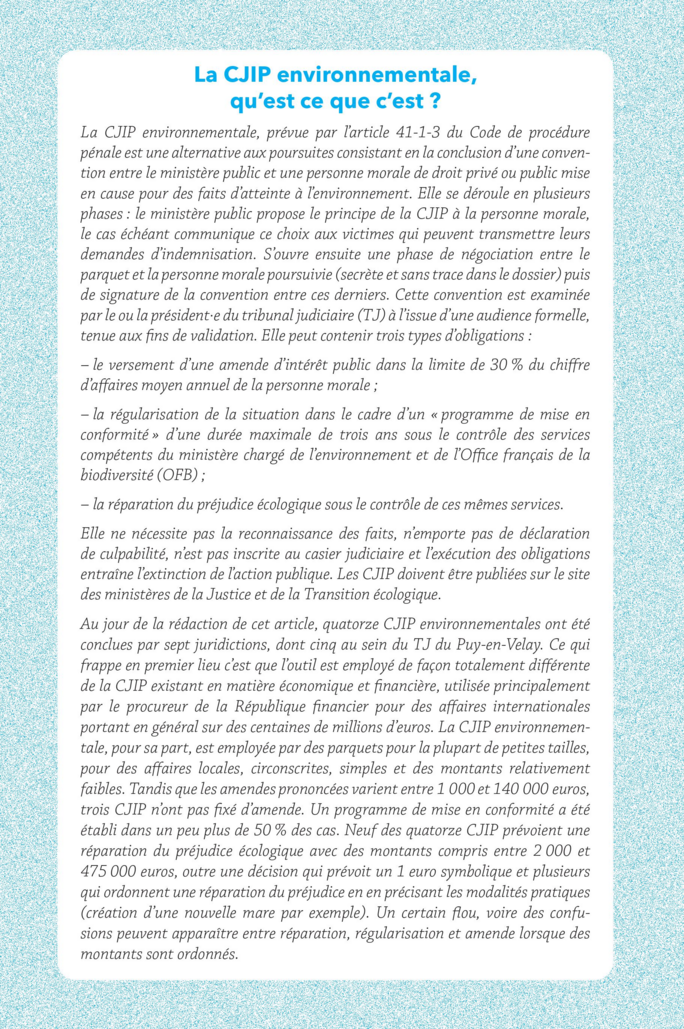
Agrandissement : Illustration 2
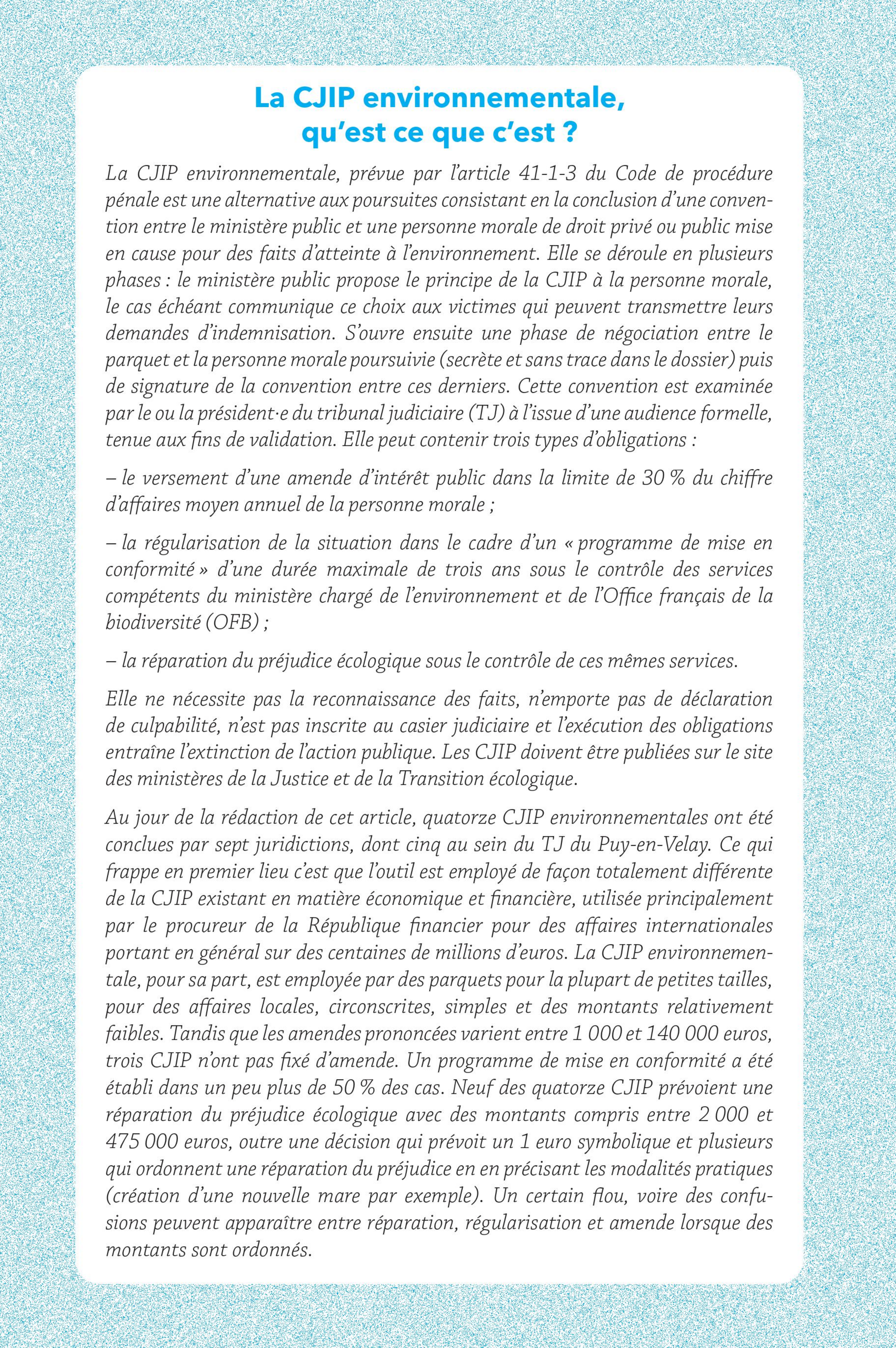
En moins de cinq ans, presque toutes les craintes initialement exprimées vis-à-vis de ce nouvel outil étranger au droit français semblent s’être dissipées. Pourtant, en 2016, de nombreuses associations5 ainsi que le Syndicat de la magistrature s’étaient fortement opposés à l’adoption de la CJIP relative aux atteintes à la probité. Ce dernier dénonçait notamment l’introduction d’un « nouveau système de justice à deux vitesses, où les fraudeurs fiscaux et les sociétés commettant des atteintes à la probité sont traités différemment des délinquants de droit commun »6. Il craignait aussi l’instauration d’un « rapport de forces risquant d’être fortement déséquilibré au profit des entreprises, bien conseillées, et au détriment de l’autorité judiciaire aux moyens plus limités». Cette même année, le Conseil d’État avait également émis d’importantes réserves estimant que le projet de CJIP « ne permettrait pas à la justice pénale d’assurer pleinement sa mission, qui est de concourir à la restauration de la paix publique et à la prévention de la récidive ». Il précisait qu’en « l’absence de contradiction et de débat public, l’intervention de la justice perdait sa valeur d’exemplarité et la recherche de la vérité s’en trouvait affectée ». Le Conseil d’État s’inquiétait en outre de l’absence de « participation personnelle au procès pénal » de la victime. En 2020, ce même Conseil d’État rendait un avis radicalement différent lors de l’examen du texte instituant la CJIP environnementale en considérant qu’elle était « de nature à contribuer à assurer une plus grande effectivité et un meilleur respect des prescriptions du Code de l’environnement », insistant notamment sur la rapidité de la procédure et la possibilité de sanctionner plus fermement les atteintes grâce au recours à une amende d’intérêt public, possiblement plus important que les amendes prévues par le Code de l’environnement7. Le SM émettait aussi un avis beaucoup plus nuancé, mais exprimait encore la double crainte que le dispositif ne soit pas assez dissuasif et qu’il soit systématiquement privilégié compte tenu notamment de l’insuffisance des moyens de la justice. Il recommandait «de prévoir la possibilité d’exclure les personnes morales du droit de candidater à des marchés publics » et « de doter les services d’enquêtes judiciaires de moyens à la hauteur des enjeux et des rapports de force en cause »8.
Le changement de positionnement, l’enthousiasme que la mesure suscite et la communication institutionnelle dont elle bénéficie ont de quoi interroger. Pourquoi tant d’engouement alors que seules quatorze conventions ont été signées, que le taux d’activité des juridictions pénales consacré au contentieux de l’environnement continue d’osciller entre seulement 0,5 % et 1 % des affaires traitées – chiffre en baisse continue ces dernières années – et que les pôles régionaux environnementaux créés en décembre 2020 demeurent des coquilles vides ? Comment analyser l’indulgence persistante à l’égard des pollueur·euses alors que dans son rapport du 4 avril 2022, le GIEC rappelle que le réchauffement climatique « menace les conditions nécessaires à la vie humaine sur terre ». En outre, ce résultat justifie-t-il le bouleversement de l’équilibre de la procédure pénale ?
Des entretiens avec des magistrat·es du siège et du parquet, des inspecteur·ices de l’environnement, des délégué·es du procureur, des avocat·es, des associations de protection de l’environnement, des universitaires et des représentant·es d’entreprises permettent d’éclairer ce que révèle et ce qu’occulte cet emballement.
MIEUX QUE RIEN ?
« La CJIP environnementale m’enthousiasme, elle me permet à court terme d’agir, de contourner les obstacles, mais dans le fond je sais que ce n’est pas la solution », note un parquetier. Nombre de praticien·nes contacté·es expriment leur lassitude face à la discordance entre la multiplication des annonces ministérielles relatives à la justice environnementale et l’inertie constatée sur le terrain. Dans ce contexte, la CJIP offre des perspectives d’une nouvelle réponse rapide et souple. Elle permet d’échapper aux délais traditionnels de la justice qui sont rigides et apparaissent soit trop courts, soit trop longs pour assurer une protection effective du vivant. Pour un délégué du procureur spécialisé en matière environnementale, la CJIP « s’inscrit facilement dans le cycle des saisons, ce qui est indispensable pour mettre en oeuvre une remise en l’état d’un espace naturel et une réparation du préjudice écologique en nature compatible avec les exigences écosystémiques. Il faut par exemple une réaction rapide afin de dépolluer un site, et au contraire attendre la saison adéquate pour replanter une haie ou réintroduire une espèce ». Ainsi, le plan de mise en conformité qui s’étale sur trois années apparaît plus à même de tenir compte de la saisonnalité que les mesures prévues dans le cadre d’une composition pénale qui ne durent que six mois. Il lui paraît donc séduisant de remplacer les audiences ayant parfois lieu trois ou quatre ans après la commission de l’infraction par une procédure rapide.
Plusieurs représentant·es du ministère public contacté·es expriment toutefois leur malaise face à l’inadéquation entre les contraventions peu dissuasives prononcées pour nombre d’atteintes à l’environnement et la gravité des impacts sur les milieux naturels voire sur la santé. Comme le suggérait le Conseil d’État, la CJIP, qui prévoit un programme de mise en conformité et la réparation du préjudice écologique, leur permet de contourner cette difficulté en leur ouvrant la possibilité d’une réponse plus sévère. « Il s’agit d’une solution nécessairement ponctuelle et résiduelle, qui ne résout pas le manque de cohérence du droit répressif de l’environnement dont les textes d’incriminations et de répression sont éparpillés dans différents codes sans faire système, ni le manque de lisibilité tant pour les justiciables que pour les praticiens du droit eux-mêmes », regrette l’un d’entre eux.
Rendant tangibles les craintes exprimées initialement, un parquetier explique que le principal atout de la CJIP est bien de permettre d’esquiver certains dysfonctionnements de la justice pénale environnementale : «Dans le petit tribunal où je travaille, nous n’avons pas les effectifs [pour] consacrer cinq jours à une audience sur un dossier complexe en matière environnementale, le pôle régional environnemental a refusé mon dossier, aujourd’hui ma seule solution c’est la CJIP ». Il ajoute que cet outil pourrait également lui permettre de ne pas renvoyer à l’audience « un dossier un peu bancal, monté par des enquêteurs peu aguerris tant à la matière environnementale qu’à la procédure judiciaire ». Il souligne aussi que, pour certaines infractions, notamment les pollutions diffuses dont la caractérisation est très complexe, la CJIP, qui ne nécessite ni reconnaissance ni démonstration de culpabilité, apparaît comme une solution, précaire et ponctuelle certes, mais qui permet d’élargir le champ de répression des atteintes au vivant. Il conclut cependant en s’interrogeant sur les conséquences d’une telle utilisation sur la vérité judiciaire.
BEAUCOUP DE BRUIT POUR QUOI ?
Cet intérêt partagé par les professionnels interrogés ne doit pas occulter le fait que la CJIP est tributaire des mêmes difficultés que la justice pénale environnementale traditionnelle. « Les préfectures nous tiennent déjà à l’écart en matière environnementale. Et nous, avec la CJIP [...] on se met à adopter les méthodes de l’administration, on dialogue, on négocie, ça m’interroge sur notre utilité, sur notre rôle », déclare une parquetière en charge du contentieux de l’environnement. Elle explique également que cette procédure ne règle en rien le principal problème auquel la justice doit faire face, soit le fait que l’autorité administrative, dont la hiérarchie tend à privilégier les intérêts économiques, ne transmet que peu de dossiers au parquet, et ce même quand des infractions sont constatées. Ici, le procureur de la République est dépossédé de l’opportunité des poursuites au profit du préfet. L’analyse de l’évolution de la réglementation environnementale permet à Thomas Le Roux, historien, d’observer une volonté politique grandissante de fabriquer les conditions d’une « impunité industrielle » en favorisant la régularisation administrative sur la sanction et en privilégiant la négociation entre industriel·les et représentant·es de l’administration. Cette exclusion organisée de la justice judiciaire est aggravée par d’autres dysfonctionnements majeurs que la CJIP ne règle pas non plus : « une police sans moyens, une priorité donnée aux impératifs économiques, une pratique menant aux procédures transactionnelles et une culture juridique vide de préoccupations environnementales »9.
Plusieurs parquetier·es contactés déclarent ne consacrer qu’une infime part de leur emploi du temps au contentieux de l’environnement. Une substitute en charge d’un pôle régional environnemental, témoigne ainsi: « J’ai à peine une demi-journée par semaine pour traiter l’ensemble des contentieux spécialisés. Si l’environnement était vraiment une priorité de politique pénale, les chefs nous parleraient moins de CJIP et nous donneraient davantage de temps pour traiter ce contentieux. C’est quand même l’avenir de l’humanité qui est en jeu, c’est pas rien ». À cette réalité s’ajoute celle du manque de formation des inspecteur·ices de l’environnement à la procédure pénale et des magistrat·es tant du siège que du parquet à ce contentieux technique faisant appel à de nombreuses connaissances extra-juridiques liées à la compréhension du vivant, ce que la CJIP ne permet pas non plus de résoudre. Un agent de l’OFB explique : « Je redoute toujours les audiences correctionnelles, j’ai toujours peur que le dossier sur lequel je me suis investi pendant des mois passe entre une affaire de baffes et une conduite en état d’ivresse, que le juge ne soit pas formé ni intéressé, qu’il ne prenne pas le temps d’écouter, d’appréhender la complexité et la spécificité de l’affaire, qu’il préfère accélérer pour ne pas finir son audience au milieu de la nuit ». La responsable juridique d’une association de protection de l’environnement s’interroge quant à elle sur la capacité des services de l’État à élaborer et suivre les plans de mise en conformité et s’inquiète à ce titre du risque de délégation de ces attributions à des organismes privés, notamment en l’absence d’autorité indépendante. Une parquetière confirme d’ailleurs que hormis la bonne volonté de l’agent de l’OFB aucun dispositif n’existe sur son ressort pour assurer le suivi des mesures ordonnées.
TRAITEMENT DE FAVEUR
« En matière environnementale, privilégier la remise en l’état sur la sanction fait consensus. Dans d’autres domaines, ça ferait scandale », analyse une magistrate du siège. Un parquetier a mis en avant le fait que la perspective d’une CJIP modifiait la relation avec la personne poursuivie: d’une situation de défiance, de défense, nécessitant un travail méticuleux et considérable de recherche de la preuve de la part des enquêteur·ices, sa participation devient en quelque sorte constructive. À cet égard, plusieurs parquetier·es et inspecteur·ices de l’environnement soulignent le caractère pédagogique de ce nouvel outil au niveau local. L’un d’eux explique par exemple qu’après la signature d’une CJIP avec une entreprise agricole, « ça se sait nécessairement dans le milieu, ça force à bouger, à changer les pratiques », et un autre que le paiement intervient quasi immédiatement sans avoir besoin de démarche de recouvrement.
En outre, la Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement note que le dispositif permet d’associer à la procédure pénale des modes de réparation civile, avec comme idée qu’au-delà de la sanction, l’objectif est la « mise en conformité de l’entreprise avec une réglementation, la réalisation de mesures techniques de prévention de la réitération du risque environnemental ou la remise en état d’un milieu fortement dégradé »10.
Un représentant d’une association de défense de la nature ajoute : « Le succès d’une procédure négociée suppose que les entreprises aient un intérêt à entrer en négociations ; or, aujourd’hui, les poursuites en la matière sont rares, et les peines peu sévères. Ce qui a fonctionné pour la CJIP relative aux atteintes à la probité ne fonctionne pas pour la CJIP environnementale car les risques en termes de sanctions et d’images sont bien moindres, et que les pôles régionaux environnementaux disposent de moyens moindres que le parquet national financier ». Il faut cependant relever que deux représentant·es du parquet ont indiqué avoir commencé avec des faits simples « pour se faire la main » avant d’envisager l’examen de comportements plus graves et plus complexes.
UN BOULEVERSEMENT ORGANISÉ
Avec la CJIP environnementale, une acceptation presque unanime du glissement du rôle traditionnel des acteur·ices judiciaires, et notamment du mouvement préexistant de marginalisation du juge pénal au profit du ministère public, semble s’opérer. Cela interroge à plusieurs égards. « J’ai l’impression d’être une caisse enregistreuse, pire encore qu’en CRPC, mon office est réduit à une peau de chagrin », s’émeut une juge correctionnelle.
Les juges, y compris avec l’aval d’un grand nombre d’entre eux, apparaissent avoir « été dessaisis de leur mission de protection de l’environnement et des victimes d’infractions environnementales ». En effet, déjà avant décembre 2020, le renvoi des affaires environnementales à l’audience correctionnelle ou de police était très faible et le taux de recours aux alternatives aux poursuites, dans ce domaine, particulièrement élevé (entre 70 % et 80 %). Aujourd’hui, ce mouvement se poursuit et la plupart des condamnations pénales en cette matière interviennent par voie d’ordonnances pénales et de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. « En l’absence de procès, une impression d’impunité domine alors même que la réprobation sociale, légitime, à l’égard des atteintes à l’environnement ne cesse d’augmenter. Ce recul de la place du juge est préoccupant. En effet, historiquement, les procès pénaux dans ce domaine ont d’une part favorisé la sensibilisation du public aux enjeux de la sauvegarde de la nature, par leur caractère public et médiatique, et ont d’autre part contribué à la construction du droit de l’environnement à travers des avancées jurisprudentielles majeures »11. Si les CJIP sont accessibles sur les sites ministériels, la lecture d’un document, souvent sibyllin, n’a pas la vertu d’un débat judiciaire incarné par les différentes parties et repris par des journalistes spécialisés assistant à l’audience.
La juge correctionnelle interrogée questionne à la fois la légitimité et la compétence des représentants du ministère public à effectuer les nouvelles tâches dans le cadre d’une CJIP environnementale : rédaction d’un contrat, définition d’un plan de mise en conformité, évaluation du préjudice écologique, choix des victimes. Elle ajoute : « Le juge ne contrôle que la régularité de la procédure et la proportionnalité des mesures, il ne statue même pas sur les intérêts civils. Laisser le parquet, qui n’a aucune expérience en la matière, fixer le montant du préjudice écologique dont l’appréciation est particulièrement ardue m’interroge, ce d’autant que la motivation n’est pas obligatoire. La tentation pour le parquet va être grande de renvoyer les parties à trouver un accord, au risque d’aboutir à un résultat déséquilibré pour les victimes ». Un membre du ministère public admet en effet que « la rédaction d’un contrat n’est pas [son] coeur de métier, et qu’à ce titre la CJIP est nécessairement source d’insécurité juridique, ce d’autant que pour être pertinents les plans de mise en conformité doivent prendre en considération de multiples enjeux techniques de biodiversité et qu’il n’existe pas d’instance équivalente à l’AFA12 pour apporter du soutien à la rédaction des conventions ». Alors que l’évaluation du préjudice écologique et la remise en l’état font l’objet de nombreuses réflexions et sont régulièrement érigées en priorité, exclure le juge de l’élaboration de la décision et réduire drastiquement son contrôle questionne une fois de plus la réalité de la volonté politique au-delà des affichages.
En outre, le glissement du rôle des acteur·ices entraîne également un recul de la place des victimes, alors même qu’à ce jour les associations de protection de l’environnement jouent un rôle déterminant dans la protection de la nature tout au long de la procédure pénale, depuis la dénonciation d’un comportement délictueux jusqu’au débat à l’audience. Un juriste d’une association de défense de l’environnement déplore que la structure dans laquelle il travaille n’ait pas été convoquée à l’audience d’homologation alors qu’elle était partie prenante et que le montant des dommages et intérêts alloués était bien plus faible que celui demandé. Il ajoute qu’à ce jour l’existence d’« une possibilité de formuler un recours » n’est « pas très claire ». Plusieurs autres représentant·es d’associations soulèvent des points de vigilance similaires, notamment leur difficulté à être informé·es lorsqu’une CJIP est envisagée, leur exclusion de la phase de négociation, l’absence de recours prévus quand le montant du préjudice fixé ne correspond pas à leurs attentes. On peut en outre s’interroger sur l’appréciation du préjudice par les juges civil·es en cas de demande d’indemnisation a posteriori par une victime qui n’aurait pas été avertie de la CJIP. En l’absence de condamnation pénale et en présence d’une procédure avec un exposé des faits très succinct sans possibilité d’approfondissement, seront-ils en mesure de statuer ?
Les préconisations du rapport de la Cour de cassation relative à la CJIP environnementale permettront certainement une amélioration du dispositif13. Cependant, sans une analyse approfondie des rapports de force en présence, un rééquilibrage du rôle de chacun·e au profit de la justice judiciaire, une réflexion globale pour un droit répressif de l’environnement cohérent et en adéquation avec les enjeux, une redéfinition effective des priorités de politique pénale, l’attribution de moyens et la formation des magistrat·es et des inspecteur·ices de l’environnement, aucun outil, aussi maniable soit-il, ne permettra de faire face efficacement aux atteintes graves à l’environnement, qui constituent pourtant un enjeu majeur en termes d’ordre public. Ainsi que le relavait une représentante du ministère public, « la CJIP environnementale est devenue une vitrine, un moyen de donner l’illusion qu’une juridiction est dynamique en matière de justice environnementale. Elle permet à la hiérarchie de répondre aux objectifs fixés par le ministère, à savoir faire croire à l’opinion publique que les parquets sont proactifs en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement ».
* * * *
Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.
Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com
* * * *
1 À l’exception des crimes et des délits contre les personnes prévus au livre II du Code pénal.
2 Loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
3 Circulaire du 11 mai 2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale.
4 Rapport accessible sur le site de la Cour de cassation : https://www. courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/12/07/groupe-de-travail-relatif-au-droit-penal-de-lenvironnement.
5 Tribune signée par un collectif parue dans Le Monde du 17 septembre 2018, « Non à une justice négociée qui “permettrait aux fraudeurs d’acheter leur innocence” », https://www.lemonde.fr/idees/ article/2018/09/17/non-a-une-justice-negociee-qui-permettrait-aux-fraudeurs-d-acheter-leur-innocence_5356014_3232.html.
6 https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/justice-penale/ justice-economique-et-financiere/1363-premiere-evaluation-de-la-loi-sapin-2.html.
7 Avis sur un projet de loi organique et un projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée du 30 janvier 2020 accessible à l’adresse suivante : https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-relatif-au-parquet-europeen-et-a-la-justice-penale-specialisee.
8 Observations du 5 juin 2020 sur la mise en œuvre de la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/ justice-penale/justice-economique-et-financiere/1363-premiere-evaluation-de-la-loi-sapin-2.html.
9 Thomas Le Roux, « Pourquoi l’impunité industrielle ? », in Philippe Boursier et Clémence Guimont (dir.), Écologies. Le vivant et le social, Paris, La Découverte, 2023, p. 231-238.
10 V. le rapport d’inspection commune rendu en octobre 2019 : https://www.justice.gouv.fr/justice-lenvironnement.
11 V. le rapport précité de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/12/07/groupe-de-travail-relatif-au-droit-penal-de-lenvironnement.
12 Agence Française Anticorruption
13 Clarifier les modalités de calcul de l’amende d’intérêt public, mieux accompagner juridiquement l’évaluation du préjudice écologique, mieux suivre les programmes de mise en conformité en appelant notamment à la création d’une entité nationale dédiée en charge du suivi territorial des mesures sur le modèle de l’Agence française anticorruption, qui pourrait produire des « lignes directrices », normes non contraignantes mais destinées à renforcer la prévention et à créer des critères unifiés de mise en conformité, renforcer l’information des associations de défense de l’environnement.



