Ce texte, paru sous le titre Hiérarchie et responsabilité : les barricades n’ont que deux côtés…1, est tiré du numéro 16 de la revue Délibérée qui sort en librairie ce 8 septembre 2022. Il s'agit d'un des articles publiés sur le thème, ô combien sensible, de la responsabilité des magistrat·es. Dans un contexte d'indigence des moyens conférés à la justice, combinée à l'invocation récurrente de la recherche de la responsabilité de ceux et celles qui ont pour tâche de la rendre, Délibérée a en effet souhaité faire le tour de cette épineuse question au cœur de notre État de droit.
Katia Dubreuil est magistrate. Après avoir exercé au parquet et à l’instruction notamment à Créteil et à Bobigny, puis à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), elle fut présidente du SM et est actuellement vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris.
* * * *
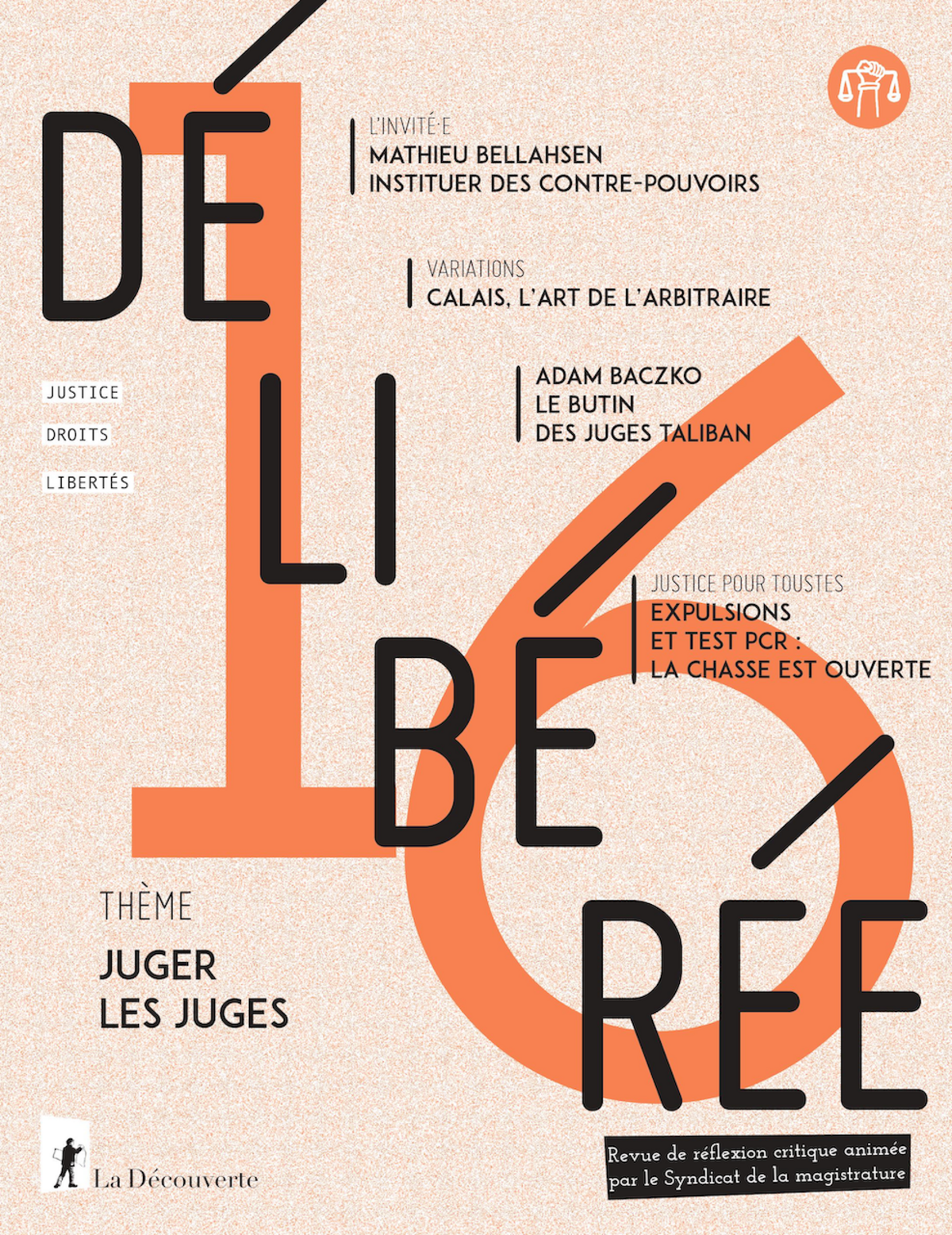
Agrandissement : Illustration 1
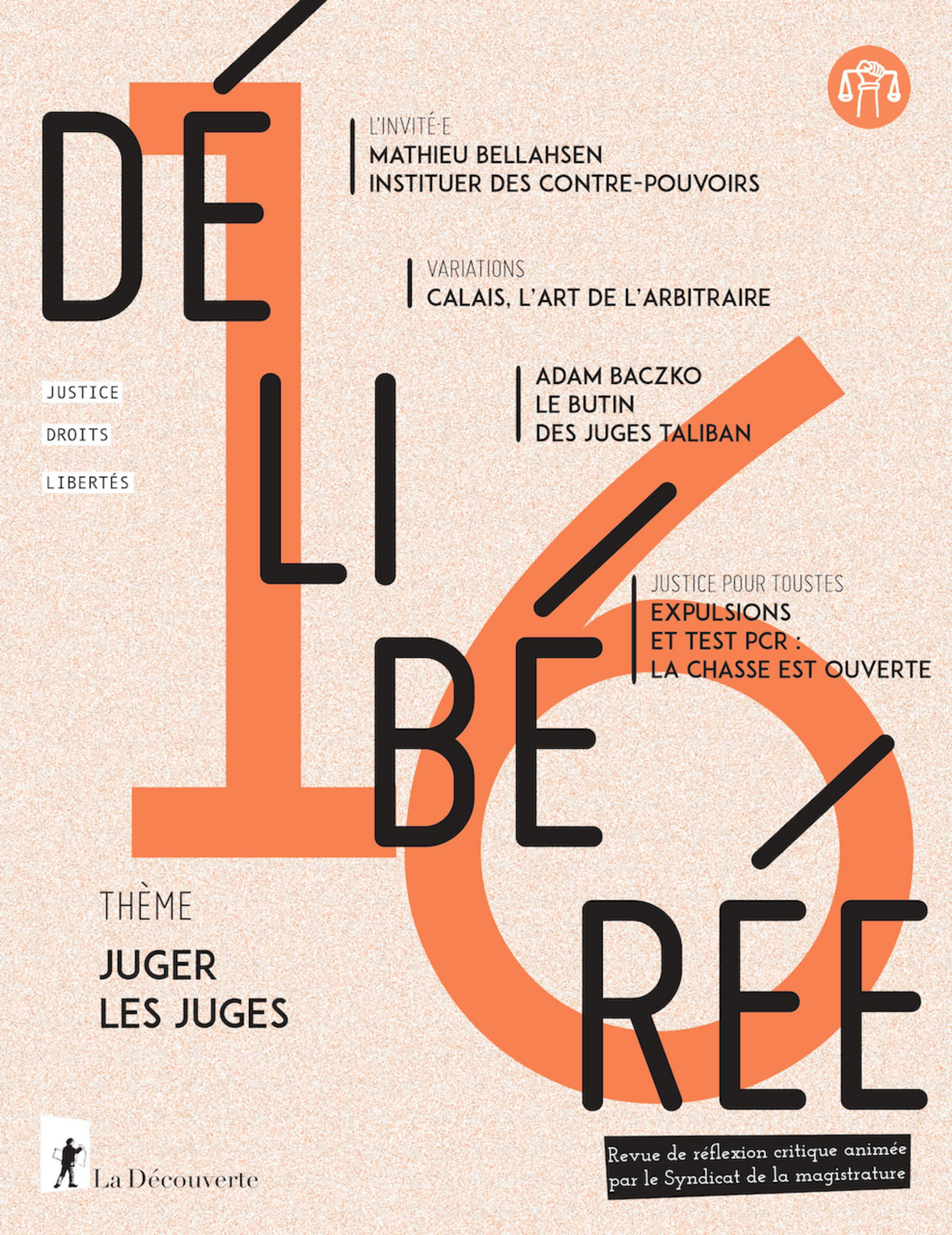
La hiérarchie judiciaire s’est trouvée, bien involontairement, sous le feu des projecteurs en novembre dernier à l’occasion de la publication de la désormais fameuse tribune signée par près de 8.000 professionnels de justice dont 5.594 magistrats dénonçant les conditions indignes dans lesquelles est rendue la justice2. Ils y écrivaient que « le dialogue entre la justice et la société est aujourd’hui rendu impossible par une vision gestionnaire de notre métier à laquelle nous sommes chaque jour un peu plus soumis » et citaient la lettre de démission d’une magistrate tout juste arrivée en fonction : « Que fait l’institution de cette souffrance ? Elle la tait, comme elle tait ses manifestations : les abus d’autorité, le harcèlement, le surmenage, ou même les suicides ». Le garde des Sceaux a cru bon de se défausser en stigmatisant « le management » comme cause essentielle du malaise. Cette attaque opportune du ministre avait pour but de détourner l’attention de l’incurie d’un pouvoir qui n’a rien fait pour remédier à la misère de la justice : elle a donné lieu à une réaction unitaire du corps.
Le caractère indécent de cette prise à partie ne saurait exonérer d’une analyse rigoureuse du positionnement spécifique de la hiérarchie au sein de l’institution, de l’étendue de ses pouvoirs, et des conséquences de l’usage qu’elle en fait. Le contraste est alors saisissant entre une hiérarchie dotée de prérogatives étendues afin d’organiser l’activité judiciaire et d’objectiver d’éventuels manquements individuels ou dysfonctionnements collectifs, et des magistrats de terrain qui sont mis dans l’incapacité de faire reconnaître les carences des chefs de cour et de juridiction lorsqu’elles existent.
Remédier à une telle asymétrie, qui préjudicie non seulement aux magistrats mais également à la qualité de la justice rendue, à son indépendance, et à l’image de celle-ci dans le corps social, supposera que plusieurs évolutions majeures et désormais documentées voient enfin le jour.
TROIS LEVIERS DU RISQUE D’ARBITRAIRE
Les prérogatives confiées aux chefs de juridiction sont étendues. Elles relèvent de la « cuisine interne » des cours et tribunaux, celle-ci demeurant un terrain relativement vierge d’analyse pour les chercheurs et professeurs de droit public. Même les avocats, observateurs parmi les plus avisés du monde judiciaire, ignorent bien souvent de quelle manière sont attribués aux magistrats leurs services et leurs dossiers, comment ils sont évalués et quelles sont les règles, écrites ou non, qui déterminent leur avancement dans la carrière. Un des pouvoirs essentiels des chefs de juridiction consiste à répartir les magistrats dans les services et, parfois, à répartir les dossiers entre eux : en l’absence de consécration en droit français du principe du « juge naturel »3 et de définition des attributions propres du substitut du procureur de la République, ce pouvoir n’est nullement borné, si l’on excepte l’avis simple des assemblées générales des magistrats. De nombreuses fonctions spécifiques ne figurant pas parmi celles soumises à une désignation par décret du président de la République4, un juge peut être, selon le choix du président de la juridiction, affecté au service correctionnel ou exercer les fonctions de juge aux affaires familiales.
Cette compétence propre des présidents est devenue d’autant plus lourde de conséquences pour les magistrats que le législateur n’a cessé de créer de nouveaux pôles (juridictions interrégionales spécialisées, pôle santé publique et accidents collectifs, pôle antiterroriste, JUNALCO5…) dans lesquels les magistrats sont là encore affectés par les chefs de juridiction. Les textes confient également aux présidents des juridictions le choix du juge d’instruction qui sera désigné pour poursuivre une enquête initiée par le parquet. S’agissant des magistrats du parquet, bien que la Cour de cassation ait jugé qu’« il puise de sa seule qualité, en dehors de toute délégation de pouvoir, le droit d’accomplir tous les actes rentrant dans l’exercice de l’action publique »6, aucun texte n’organise les compétences de chacun dans le cadre de la relation hiérarchique prévue par le statut7. Les chefs de cour sont également chargés de procéder à l’évaluation des magistrats. Celle-ci est, pour les juges et parquetiers officiant dans les tribunaux, quasi exclusivement le fruit de la seule appréciation de leur chef de juridiction. Celui-ci dispose pourtant de peu d’éléments sur le contenu du travail fourni par le magistrat. Il n’a par exemple pas le droit, en raison du principe du secret de l’enquête, de consulter les dossiers des juges d’instruction. L’évaluation s’appuie donc principalement sur des éléments statistiques et non sur la qualité du travail fourni. Rien ne permet de garantir que la modulation des appréciations formulées par le chef de juridiction – toujours sibylline, afin de ne pas ouvrir la voie à une contestation, possible seulement en cas d’erreur manifeste d’appréciation – ne soit pas fonction d’éléments étrangers aux compétences du magistrat. Ainsi, un magistrat critique en assemblée générale ou ayant eu un conflit avec sa hiérarchie pourra éventuellement en faire les frais.
Les travaux récents engagés avec la direction des services judiciaires sur l’évaluation, partant du constat unanime que son processus est insatisfaisant, n’en modifieront pas substantiellement l’économie : la chancellerie, loin de souhaiter confier l’évaluation à une autorité extérieure à la juridiction chargée d’observer le magistrat « en acte », tend plutôt, au contraire, à faire des chefs de juridictions de véritables «profilers» chargés de débusquer les talents, dans un contexte de filiarisation qui devient le maître mot de la politique de gestion des ressources humaines. S’ajoute à cela une évaluation qui ne dit pas son nom et qui n’a pas à être motivée : l’attribution de la prime modulable par le chef de cour, une part de la rémunération des magistrats étant déterminée en fonction de leur « contribution au bon fonctionnement de l’institution judiciaire »8.
Enfin, les chefs de cour peuvent, depuis la réforme statutaire de 2001, saisir le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du comportement d’un magistrat – prérogative dont ils font peu usage, en l’absence de moyens propres leur permettant de réaliser des vérifications préalables9. Ils privilégient dans les faits l’envoi de rapports à la chancellerie, le garde des Sceaux étant le seul à pouvoir saisir l’inspection générale de la justice (IGJ) d’une enquête administrative. Il n’est pas en soit critiquable que la hiérarchie judiciaire puisse saisir l’autorité disciplinaire. En revanche, la pratique consistant à convoquer les magistrats à des entretiens sans cadre juridique défini, de plus en plus utilisée par les chefs de juridiction, est très contestable. Elle prend par exemple la forme d’un « rappel des obligations déontologiques » ou d’une « convocation à un entretien » dont l’objet n’est pas préalablement porté à la connaissance des magistrats. Cette manière de faire va souvent de pair avec une réticence marquée des chefs de juridiction lorsque le magistrat concerné souhaite se faire assister lors d’un de ces entretiens par un représentant d’un syndicat ou un collègue.
LA « BASE » RÉDUITE À L’IMPUISSANCE
Dans ce contexte, les organisations syndicales interviennent régulièrement pour défendre des magistrats sujets à des décisions ou comportements arbitraires de leurs chefs de juridiction au sujet de leur évaluation, de leur avancement, de l’attribution de leur service, de la répartition des dossiers, de l’octroi des congés et des primes, ou de la convocation injustifiée à un «entretien», précédant parfois la rédaction d’un rapport à destination du garde des Sceaux. Selon les cas, ces pratiques peuvent caractériser des atteintes à l’indépendance des magistrats ou encore confiner à des pratiques de harcèlement.
Les organisations syndicales interviennent en première intention directement auprès du chef de juridiction dont la décision est contestée. Si cette intervention reste sans effet, elles peuvent être amenées à saisir le chef de cour lorsque le comportement problématique est celui d’un président ou d’un procureur, et/ou le garde des Sceaux. Force est de constater cependant que l’action syndicale se heurte généralement à l’inertie de la hiérarchie et du ministère. Dans la mesure où la chancellerie se préoccupe ces dernières années quasi exclusivement de la productivité des juridictions, un haut magistrat a peu de chance de rencontrer un obstacle dans sa carrière ou de faire l’objet d’une poursuite disciplinaire lorsqu’il donne satisfaction sur ce point. Les organisations syndicales constatent ainsi quotidiennement que les signalements qu’elles peuvent être amenées à faire sur le comportement de certains chefs de juridiction demeurent dans une très large mesure sans suite.
Sans doute consciente de ce hiatus, l’IGJ a créé de manière prétorienne en 2019 un nouveau cadre d’enquête, « l’examen de situation », dont l’objectif affiché est de « remédier à des dysfonctionnements en termes managériaux », et de réaliser une « photographie » d’une situation donnée10. Ce nouveau cadre n’ouvre aucun droit pour les personnes concernées, contrairement à l’enquête administrative, puisqu’il n’est supposé viser personne en particulier, bien qu’il concerne la plupart du temps des membres de la hiérarchie. Les examens de situation déjà réalisés – avant même que la méthodologie en soit arrêtée – ont cependant donné lieu à des préconisations telles que l’invitation du chef de juridiction concerné à quitter ses fonctions et, en cas de refus, lorsque celui-ci exerçait au parquet, celle d’une mutation dans l’intérêt du service. Ce cadre d’enquête a donc une nature clairement paradisciplinaire, sans toutefois offrir aucune des garanties afférentes. Si l’on doit se réjouir de cet intérêt nouveau porté aux méthodes de management et au fonctionnement de la hiérarchie, la solution retenue ne sera pas pleinement satisfaisante si elle conduit à porter atteinte aux droits des magistrats concernés ou au contraire à les faire bénéficier d’un régime de faveur sans trace dans leur dossier administratif, dans le cas où les faits constatés auraient pu justifier une sanction disciplinaire.
DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES POUR UNE RESPONSABILISATION ACCRUE DE LA HIÉRARCHIE JUDICIAIRE
L’ensemble de ces règles et les pratiques qui en découlent dessinent les contours de la fragilité du statut des magistrats. Cette fragilité est d’autant plus tangible qu’ils ne disposent actuellement d’aucun levier institutionnel pour faire constater et cesser une atteinte à leur indépendance ou une situation de harcèlement, ou encore une organisation du travail propice au développement des risques psycho-sociaux, notamment lorsqu’elle est le fait de leur hiérarchie. C’est fort de ce constat que le Syndicat de la magistrature a proposé au CSM, saisi par le président de la République d’une demande d’avis sur la responsabilité des magistrats, l’ouverture d’une telle possibilité, en ouvrant plusieurs hypothèses de travail, visant notamment à permettre aux magistrats et aux syndicats de magistrats de saisir la commission d’admission des requêtes (CAR) du CSM. Le CSM a lui-même ouvert des perspectives en proposant dans l’avis rendu au président de la République11 la « création d’un dispositif permettant de pallier le défaut d’engagement d’une enquête administrative par le garde des Sceaux, lorsque de telles investigations lui ont été demandées par un magistrat ou une organisation syndicale » et en l’assortissant de conditions strictes12. Le gouvernement n’a pour le moment donné aucune suite à cet avis du CSM, les questions de la protection des magistrats et de leur indépendance n’ayant, c’est le moins que l’on puisse dire, pas été mises en avant dans les « États généraux de la Justice » lancés en octobre dernier13.
Plus cruciale encore est la question de l’évaluation des chefs de juridiction, aujourd’hui quasiment inexistante. En effet, si peu de comportements problématiques de la hiérarchie judiciaire relèvent in fine de poursuites disciplinaires, il est particulièrement dommageable pour l’ensemble du corps que les qualités professionnelles de ces magistrats ne soient pas correctement analysées afin de déterminer leurs besoins en formation, d’une part, et les fonctions qu’ils sont en capacité d’exercer, d’autre part. Dans les faits, les chefs de cour sont uniquement astreints à la rédaction d’une note à partir d’une trame portant sur des éléments statistiques de leur activité. Les présidents de tribunaux sont évalués par leurs supérieurs hiérarchiques sans qu’aucun autre avis ne soit recueilli sur leur manière de servir.
Le projet d’une évaluation « à 360° » des chefs de cour et de juridiction, visant à recueillir l’opinion de professionnels amenés à travailler avec eux, a fait l’objet d’un rapport remis en 2019 par Guy Canivet à la demande de Nicole Belloubet, sans qu’à cette heure, aucune suite tangible n’y ait été apportée.
Le CSM et le ministre n’ont ainsi, pour nommer dans une nouvelle affectation les chefs de juridiction, d’autres outils à leur disposition que des dossiers administratifs quasiment vides et la possibilité de mener des entretiens avec les intéressés. La composition et les prérogatives du CSM ont également une incidence forte sur les carrières des hauts magistrats, qui mériteraient à elles seules de longs développements. Il peut à tout le moins être relevé que, parmi les magistrats siégeant dans cette instance, les membres de la hiérarchie judiciaire sont majoritaires14.
Les chefs de juridiction, aujourd’hui relativement intouchables lorsqu’ils ne déplaisent pas à la chancellerie, disposent de prérogatives particulièrement étendues qui ont un fort impact sur l’activité et la carrière des magistrats des tribunaux et cours qu’ils administrent et sont, de ce fait, en capacité de fixer seuls les priorités de leurs juridictions en ne rendant de comptes qu’au ministère de la Justice. Dans cette organisation très pyramidale, tout converge finalement pour faire de ceux-ci des relais de l’administration centrale, ce qui génère de la confusion sur le positionnement de la hiérarchie dans l’institution. Allant jusqu’au bout de la logique, d’aucuns se prennent à rêver de remplacer ces magistrats par des administrateurs civils. Les chefs de juridiction sont majoritairement hostiles à cette idée et mettent en avant leur statut, qui permettrait d’assurer une indépendance effective. L’objection est sagace, encore convient-il de lui donner tout son sens et partant, de procéder à un véritable rééquilibrage des prérogatives et devoirs de ces hauts magistrats. Ces derniers ne sauraient exercer leurs fonctions qu’en étant pleinement en prise, non seulement avec la collectivité judiciaire, mais également avec les exigences des justiciables et de la société.
Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info. Vous pouvez aussi consulter notre site internet ici.
Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com
1 Elsa Triolet, Proverbes d’Elsa, Bruxelles, Aden Éditions, 2011.
2 « Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout », Le Monde, 24 novembre 2021.
3 Sur ce point, voir Emmanuel Jeuland, «Le droit au juge naturel et l’organisation judiciaire», Revue française d’administration publique, 2008/1 : « Si on s’en tient à la question de la distribution des affaires dans chaque tribunal et non à la question de la compétence, il faut convenir que le droit au juge naturel est introuvable ».
4 Article 28-3 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
5 JUNALCO : juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
6 Crim, 3 juillet 1990, pourvoi n° 90-82418.
7 Article 5 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
8 Article 3 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire.
9 Ainsi, jusqu’à ces dernières années, seules deux saisines des chefs de cour avaient été dénombrées. La tendance est toutefois peut-être en train d’évoluer, trois nouvelles saisines ayant eu lieu ces deux dernières années.
10 Projet de méthodologie adressé en 2021 par l’IGJ aux organisations syndicales dans le cadre des réunions de travail sur ce nouveau cadre d’enquête.
11 CSM, Avis au président de la République sur la responsabilité et la protection des magistrats rendu le 24 septembre 2021.
12 Le CSM propose par ailleurs « de permettre à tout magistrat de le saisir en cas d’atteinte à son indépendance, et d’instaurer la faculté pour le Conseil de se saisir d’office en pareil cas, à l’effet d’émettre une recommandation pour faire cesser l’atteinte », ce qui vise davantage à répondre aux tentatives de déstabilisation provenant de l’extérieur du corps.
13 Les conclusions des États Généraux n’étant pas connues au jour de la rédaction de cet article.
14 Quatre membres sur les sept magistrats de chaque formation.



