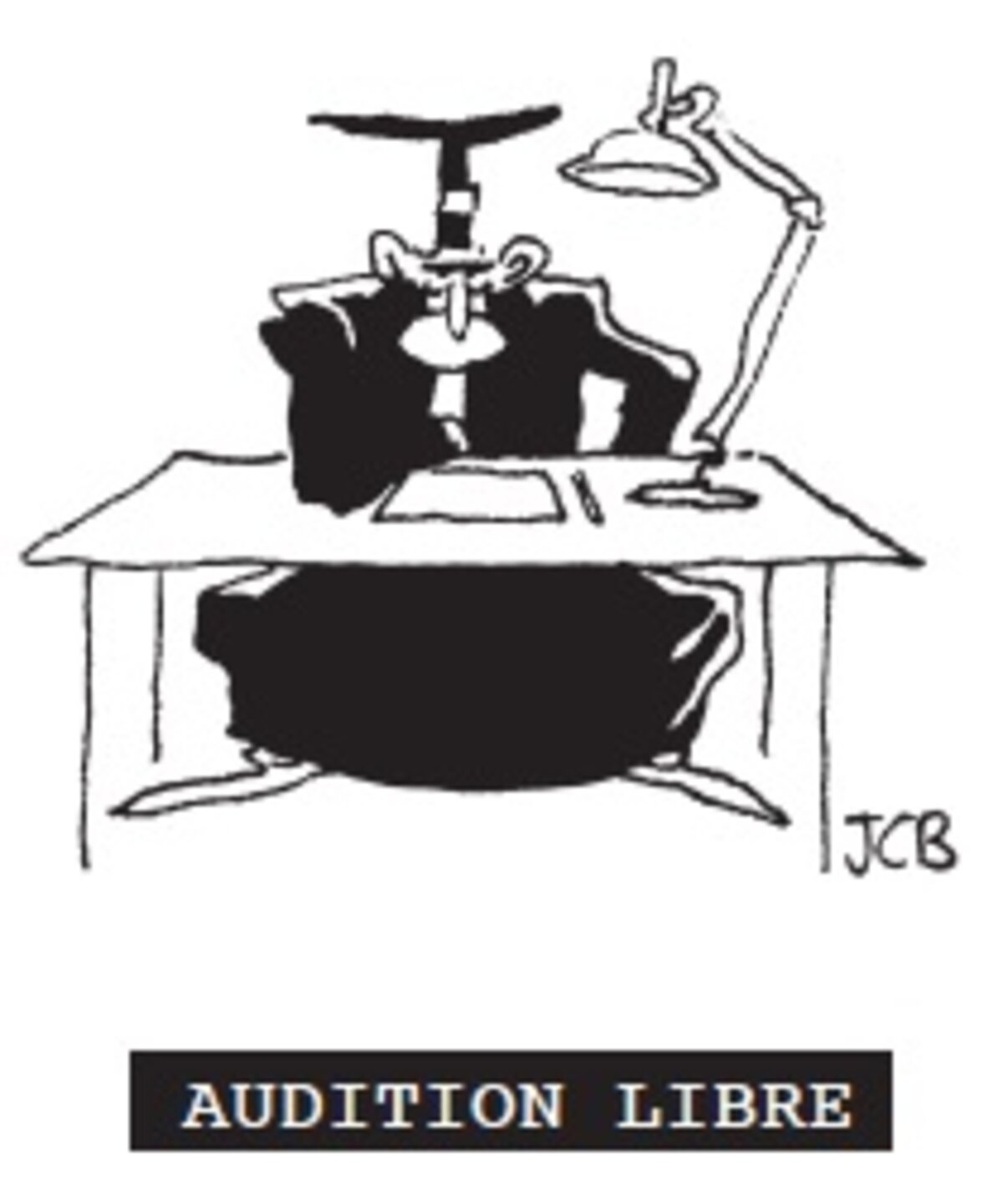
Cette audition libre de Pascale-Robert Diard a été réalisée pour le numéro 6 de la revue Délibérée, parue le 10 mars 2019.
Délibérée : Pour quelle raison êtes-vous devenue chroniqueuse judiciaire ?
Pascale Robert-Diard : J’ai été attirée par cette fonction car j’avais eu l’occasion d’assister au procès de Klaus Barbie quand j’étais stagiaire au Monde et j’en avais été très marquée. En commençant ma carrière, j’ai assisté à un procès sur une histoire d’infanticide par une jeune femme algérienne, de condition très modeste, arrivée en France à l’âge de 15 ans, tombée enceinte d’un garçon qui avait promis de l’épouser et n’en avait rien fait. Elle avait caché sa grossesse puis tué son bébé. Au procès, lors de ses réquisitions, l’avocat général s’est levé et tourné vers le père de l’enfant en lui disant : « C’est vous, monsieur, qui devriez être dans le box des accusés. » Et devant ce moment-là, si intense, je me suis dit que j’avais vraiment envie de devenir chroniqueuse judiciaire, ce qui a fini par m’arriver en 2002 et j’en ai été très heureuse.
D. : Comment choisissez-vous les audiences auxquelles vous assistez ?
P.R.-D. : Il y a d’abord toutes celles que l’actualité impose : les grands faits divers, certaines affaires politico-financières, ou toutes celles qui ont un retentissement important par les personnes mises en cause ou le sujet de société qu’ils révèlent. Les enceintes judiciaires sont le lieu où viennent résonner ces questions de société. Et puis il y a des procès qui sont des choix particuliers, parce que j’ai été alertée sur une histoire criminelle ou une petite affaire correctionnelle. Ou encore parce qu’au journal, nous avons décidé d’enquêter sur tel ou tel aspect du fonctionnement judiciaire, comme ce fut le cas avec un reportage sur la 17e chambre du tribunal de Paris ou les juges des tutelles.
D. : Pour le procès de l’affaire dite « Fiona »1, vous avez commencé à assister aux débats puis vous êtes partie en cours d’audience. Pourquoi ?
P.R.-D. : Je suis partie car je me sentais très mal à cette audience. Il est vite apparu que la mère de Fiona et son compagnon, assommés de médicaments, n’allaient pas parler alors que l’un des enjeux de ce procès était de savoir où ils avaient mis le corps de l’enfant. Il y avait aussi ce climat de haine, d’appels à vengeance... Et une consoeur m’a parlé d’un autre procès qui se déroulait à Grenoble au même moment. J’ai donc appelé mon chef au Monde, je lui ai dit : « Voilà, on est 80 journalistes, il ne se passera rien, et à Grenoble il y a une autre histoire qui m’intéresse où on sera beaucoup moins nombreux » , et il m’a dit : « Vas-y, prends le train ».
D. : Mais comment on peut dire d’un procès criminel où de lourdes peines d’emprisonnement sont en jeu, et qui a un tel retentissement dans le débat public, qu’il ne « s’y passera rien » ?
P.R.-D. : La culpabilité était acquise, même si c’était à des degrés divers. Aucun des deux accusés dans le box n’était en mesure de parler. Il y avait déjà eu un énorme battage médiatique avant l’audience, orchestré par les associations de défense des enfants. Pour traiter la question très générale de la protection des mineurs, je n’avais pas besoin d’assister à cette audience en particulier. Ça ne m’intéressait pas d’être partie prenante de tout ça. Je me suis quand même engagée à revenir pour le réquisitoire, les plaidoiries et le verdict, et je l’ai fait. Je n’ai jamais regretté de ne pas avoir couvert la totalité des débats, surtout quand j’ai appris qu’une radiesthésiste était venue à la barre !
D. : Quelle est l’affaire judiciaire qui vous a le plus marquée ?
P.R.-D. : Il n’y en a pas ou plutôt... toutes ! Plus que l’affaire en elle-même, ce sont surtout des moments qui vont me marquer, dans ce qu’ils ont d’exceptionnel, d’imprévisible.
D. : Le rôle de la « chronique judiciaire » consiste-t-il plutôt à restituer des moments d’audience ou la façon dont la justice est rendue ?
P.R.-D. : À mon sens, le premier rôle de la chronique judiciaire, c’est de raconter des histoires, je l’assume. Deuxièmement, c’est de raconter comment ces histoires, à un moment donné, sont perçues et jugées. Je me vis donc comme un témoin de la façon dont la justice est rendue. Ce rôle de témoin me paraît très important vu le manque de connaissance de l’opinion sur le fonctionnement de la Justice... que je mesure d’autant plus que, moi-même avant de commencer la chronique judiciaire, je n’y connaissais rien ! Cela me paraît fondamental de témoigner de la beauté du fonctionnement judiciaire, cette organisation publique d’un débat impossible et pourtant si respectueux, et ce haut degré de civilisation que permet le principe du contradictoire. En dehors de l’enceinte judiciaire, dans le débat public, je suis frappée par le degré de violence dans les échanges, alors qu’à l’inverse dans les cours d’assises ou dans les tribunaux, alors qu’on aurait mille raisons de s’affronter violemment, on arrive à se contenir, à faire parler les uns et les autres et à faire de cela une décision de justice. Ça ne veut pas dire que je partage le sens de toutes les décisions rendues mais je persiste à être impressionnée par l’enseignement de la complexité qu’offrent les audiences, à mille lieux des échanges médiatiques où l’on simplifie et caricature si facilement.
D. : Alors que 80 % de l’activité judiciaire des 473 tribunaux en France est consacrée aux affaires civiles, comment expliquez-vous que vos chroniques judiciaires portent principalement sur des affaires pénales parisiennes, au risque de donner une représentation de la Justice totalement décalée de sa réalité ?
P.R.-D. : Je ne suis pas d’accord, je couvre souvent des procès hors Paris et je les apprécie particulièrement car ils me permettent de vivre pleinement dans cette « bulle » de l’audience où rien d’autre ne compte. Sur la sur-représentation du pénal, c’est vrai. Je ne peux même pas l’expliquer, ça relève peut-être d’une forme de tradition. Les rares fois où je me suis aventurée hors du champ pénal, je me suis d’ailleurs toujours dit que je devrais le faire plus. C’est bien, il me reste plein de choses à faire ! [rires] Pour vous magistrats, c’est sûr que le visage de la Justice tel qu’il est donné à voir par la presse ne correspond pas du tout à votre travail, je suis d’accord. Ce décalage a toujours existé. Il y bien sûr l’intérêt du public pour les affaires criminelles, même s’il est tout aussi intéressé – et surtout beaucoup plus concerné – par le travail des juges aux affaires familiales, aux tutelles ou celui des juges des enfants. Je plaide donc coupable.
D. : Est-ce que ce ne serait pas un peu par « mondanisme » que la presse rend plus compte de la justice pénale parisienne, les journalistes s’informant sur l’oeuvre de justice auprès des avocats les plus visibles, qui sont surtout les pénalistes parisiens ?
P.R.-D. : J’entends et je ne sous-estime pas du tout le fait que certaines affaires sont traitées en raison de la présence de tel avocat. Mais ce n’est pas la majorité. C’est d’abord l’affaire qui fait venir l’avocat célèbre. En réalité, il a pu m’arriver, très rarement, d’aller à une audience, alertée par un avocat. Je préfère être informée par un magistrat parce que je sais qu’on va être attiré par les mêmes choses, par l’intérêt humain d’un dossier.
D. : Il y a des audiences du quotidien auxquelles il est très facile d’assister et qui présentent un fort « intérêt humain », ce sont les audiences de comparutions immédiates et pourtant on vous y voit rarement. Pour quelle raison ?
P.R.-D. : Je l’entends. Mais je trouve que vous magistrats, êtes votre propre caricature dans ces audiences ! Et côté journalistes, ces audiences sont un peu la mauvaise conscience des chroniqueurs judiciaires... on se dit que l’on n’a pas assez traité de justice ordinaire dans le journal alors on va suivre des comparutions immédiates. Si on voulait montrer la Justice telle qu’elle fonctionne vraiment, il faudrait aller s’ennuyer dans des audiences médiocres, avec des magistrats et des avocats moyens et des histoires qui peuvent être formidables mais qui sont jugées en un temps moyen. À mon avis, c’est ça d’ailleurs le vrai visage de la Justice : le moyen, pas l’exceptionnel du grand procès, ni l’abattage des comparutions immédiates.
D. : Qu’est-ce que vous appelez une audience « médiocre » ?
P.R.-D. : Une audience où tout le monde est paresseux. Où le président n’a pas vraiment travaillé, où le procureur fait son travail de façon mécanique et sans investissement personnel, et où les avocats sont moyens car ils n’ont ni le temps ni l’argent de s’investir plus. Mais ça, c’est difficile à raconter ! Finalement quand on ne rapporte que les grands procès, on montre une vision déformée positivement de la Justice car on raconte un fonctionnement judiciaire qui est exemplaire, qui a du temps, qui repose sur des magistrats qui ont souvent été sélectionnés. Et je pense que le fait qu’il y ait des journalistes dans la salle contribue à rendre tout le monde meilleur.
D. : Vous semblez dire que le vrai visage de la Justice c’est surtout celui du « moyen » mais vous racontez peu le manque de moyens et les conditions de travail des professionnels de justice, qui pourraient aussi être éclairants pour décrypter la façon dont la Justice est rendue. Pour quelle raison ?
P.R.-D. : Parce que ce n’est pas mon travail. Au Monde, on a un chroniqueur judiciaire et un rubricard « justice » dont le travail est de raconter le fonctionnement de la justice. Moi, je suis en charge de la chronique judiciaire, je ne raconte pas non plus l’enquête ni le fait divers. Mon travail à moi, c’est l’audience. Et avant, je ne lis que l’ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. Et encore, pour une raison « technique » si je puis dire, car cela me permet de faire un article dans le journal que l’on appelle un « avant-papier », qui paraît à l’ouverture de l’audience, pour faire une présentation de l’affaire. Mais je me refuse à lire le dossier !
D. : Ce qui va principalement servir à rendre le jugement, c’est l’audience, mais aussi le contenu du dossier. Pourquoi, en tant que journaliste, se refuser de lire le dossier avant d’aller à l’audience ?
P.R.-D. : Pour les assises, je veux pouvoir me mettre dans la tête d’un juré, c’est mon obsession. Ce qui se passe en dehors de la salle d’audience, ce n’est pas mon histoire d’une certaine manière. Dans un livre que j’ai beaucoup aimé, La vérité côté cour2, l’ethnologue Christiane Besnier décrit les étapes traversées par les jurés pour la construction d’une vérité judiciaire. J’y ai vu un écho de mon travail. Je me dis que mon rôle à moi, c’est de ne pas louper ces moments d’audience qui deviendront des étapes clefs du raisonnement au cours du délibéré.
D. : Ne pas lire le dossier et se limiter aux « moments d’audience » ‒ qui peuvent être provoqués artificiellement par les acteurs du procès ‒ n’est-ce pas s’exposer à un risque accru de manipulation par l’un ou l’autre de ces acteurs, qui ont chacun leur stratégie, et se priver des outils nécessaires à l’appréhension de l’enjeu central du procès, qui parfois peut être très juridique ?
P.R.-D. : Non car cet enjeu réel va forcément surgir au cours de l’audience, à l’initiative de l’une des parties au procès ! Moi, quelle légitimité j’aurais pour faire une telle chose ? Ma légitimité à moi, c’est de m’asseoir sur un banc, d’assister à l’intégralité des débats ‒ et pas simplement au réquisitoire et aux plaidoiries ‒, et de raconter ce qui s’est passé. J’assiste à la construction d’une vérité judiciaire et j’en rends compte. Je peux faire une analyse après en disant que le procès a été passionnant ou raté compte tenu de telle stratégie d’acteur du procès, mais je ne peux le faire qu’après.
D. : Vous considérez que votre rôle consiste à « assister à la construction d’une vérité judiciaire », mais cette construction ne passe-t-elle pas davantage pas des éléments d’un dossier que par des « moments d’audience » ?
P.R.-D. : Vous caricaturez ce qu’est un moment d’audience ! C’est une vision de magistrat ! Vous nous voyez comme des gens qui veulent assister à de la castagne en audience et cherchent à tout prix le moment où, par exemple, l’avocat de la défense va terrasser un tel... Un moment d’audience, pour moi, c’est ce qui justement échappe au dossier de papier, aux procès-verbaux et ne peut se produire que dans le prétoire. C’est aussi le moment que tous ceux qui ont assisté à l’audience emporteront avec eux. Dans leur délibéré, pour les juges ou les jurés, parce que ce sera l’un des épisodes autour duquel se sera cristallisée leur intime conviction. Mais aussi au-delà du procès, ce sera ce qui leur restera et qu’ils raconteront à leurs proches en rentrant : la dignité d’un témoin, le regard d’une mère sur son fils accusé, le chagrin d’un père. Et qui comptera bien plus pour eux que telle plaidoirie ou tel réquisitoire.
D. : Mais, au cours d’un délibéré d’assises, ce n’est pas l’intensité d’un moment d’audience, la dignité d’un témoin ou d’une partie qui va déterminer la culpabilité et le quantum de la peine de l’accusé, non ?
P.R.-D. : Vous opposez émotion et droit ! Mon travail, c’est de raconter à des lecteurs, pas celui de juger. Il y a dans un procès des moments d’humanité qui valent d’être racontés en soi, car ils témoignent de quelque chose d’universel qui va au-delà de l’affaire jugée. C’est d’abord cela que j’aime dans ce métier. Ce serait injuste de me dire que, dans mon travail, je fais une confusion entre émotion et droit. Il n’y a rien que je déteste plus que l’émotion convenue, de quelque côté que ce soit. Prenons la décision rendue dans le procès Tron, la motivation de l’acquittement est un modèle ! Elle rappelle que l’émotion ne suffit pas, qu’un viol c’est une définition judiciaire qui répond à des critères. Autre exemple, l’affaire Jacqueline Sauvage, sur laquelle j’ai écrit pour dénoncer la confusion entre l’émotion et le droit. Aujourd’hui, je m’aperçois que je me suis blindée contre l’émotion obligée.
D. : Quelle est alors justement la place de l’émotion dans votre travail journalistique ?
P.R.-D. : Je peux rester de marbre face à certaines démonstrations d’émotion que je qualifierais d’attendues. Je me suis blindée au fil du temps contre ces moments où le procès devient une sorte de réplique publique d’une cérémonie funèbre privée. En revanche, je peux me laisser totalement envahir par l’émotion qui jaillit d’une confrontation ou d’une déposition. Il m’arrive alors de pleurer, discrètement bien sûr. Pour moi, la vraie émotion, c’est celle qui surgit de façon inattendue, qui donne de la complexité, ouvre une fenêtre sur les sentiments et les passions humaines. On peut considérer que c’est littéraire, je considère que c’est la vie. Ensuite il y a la décision de justice qui intervient. Et l’intérêt de la chronique judiciaire, c’est le mélange des deux. De cette matière littéraire, extrêmement romanesque de l’audience et de la borne que lui apporte la justice au nom d’une société donnée à un moment donné.
D. : Est-ce que la chronique judiciaire ne souffre pas d’un écueil qui est justement celui de la fictionnalisation, qui se traduit parfois par un journaliste qui cherche surtout à faire incarner des rôles à des personnes réelles, de façon un peu figée et préétablie mais déconnectée de la réalité du procès ?
P.R.-D. : Je ne cherche pas du tout à faire jouer des rôles mais à regarder, à comprendre. Bien sûr qu’il y a une part de montage dans l’écriture mais je l’assume. Dans un verdict aussi il y a aussi un montage, entre les images fixes et troubles qui se sont forgées tout au long d’un procès, et si tout est trouble on va acquitter. Avec le temps, je prends de plus en plus de liberté dans mon travail au sens où je ne suis pas une greffière qui devrait rendre compte de la parole de chacun. Je peux ne consacrer que quelques lignes à un réquisitoire ou faire l’impasse sur une plaidoirie s’il m’apparaît qu’ils n’apportent rien de plus que les débats au lecteur, ou au contraire accorder toute la place à l’un ou l’autre, quand j’ai été impressionnée par leur démonstration. C’est un privilège que j’ai de me sentir libre face aux acteurs du procès. Surtout, j’ai la chance dans mon journal de pouvoir écrire au long. C’est un luxe ! C’est aussi pour cela que je revendique mon travail sur les mots. Je travaille souvent une bonne partie de la nuit, car contrairement aux autres quotidiens, le Monde « boucle » ses pages le matin. J’ai donc plus de temps pour travailler l’écriture. Et c’est essentiel car je pense que les choses sont tellement complexes, fragiles, graves que ce que je dois aux lecteurs, c’est la précision et la justesse des mots.
D. : À propos de votre goût des mots justes, est-ce que la recherche du style ne pousse pas parfois la plume à aller trop loin ? Je pense notamment à l’un de vos papiers publiés sur votre blog3, sur Dominique Cottrez4, dans lequel vous aviez écrit à propos de l’accusée : « Est-ce d’ailleurs une femme que l’on regarde ou un corps, un magma de chair ? »5
P.R.-D. : Je l’assume complètement. Un écrivain aurait peut-être fait mieux. Mais cette question-là était déterminante au cours des débats, la fascination que cette accusée a exercée était liée à son surpoids.
D. : Ma question ne porte pas sur le principe de l’évocation du surpoids de cette femme mais sur la façon de qualifier son apparence en parlant de « magma de chair ». N’était-ce pas un de ces excès de plume auquel peut pousser la recherche de style ?
P.R.-D. : Il n’y avait pas que ça dans le papier... J’ai surtout voulu expliquer cet effet très particulier que le corps de Dominique Cottrez faisait sur les gens qui ne la connaissaient pas. Son corps l’a précédée en tout, toute sa vie, et elle le savait. En réalité, tout le monde regardait Dominique Cottrez non pas comme une femme mais comme un « magma de chair ». C’est ce que j’ai voulu exprimer, cette violence. Ce n’est donc pas un excès de plume. Après, le terme « magma » n’est pas très joli, je préfère « amas ». Si j’avais travaillé plus, je garderais la même idée mais je choisirais un autre mot.
D. : Vous avez fait référence tout à l’heure à la proximité qu’entretiennent littérature et chronique judiciaire. Ne peut-on parler de « liaisons dangereuses » quand on pense à certaines expériences d’écrivains qui en se frottant au monde judiciaire sont passés complètement à côté du sujet ? On pense à Marguerite Duras qui joue à faire de Christine Vuillemin la coupable du meurtre de son fils Grégory, ou encore à Colette fascinée par le tueur en série Landru...
P.R.-D. : Colette a assisté au procès, Marguerite Duras non. Giono, lui, a livré un témoignage très intéressant sur l’affaire Dominici. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de matières où le journalisme peut rivaliser avec la littérature mais peut-être qu’en matière judiciaire, oui. Sauf qu’à la fin, la boussole du journaliste doit rester la vérité judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’écrivain.
D. : Mais ne prenez-vous pas un risque lorsque vous vous aventurez sur le terrain de la littérature ? Par exemple, quand vous parlez de « la Bovary de Chambéry »6 à propos d’une accusée en procès pour le meurtre de son amant, est-ce que ce détour par un personnage de fiction ne jette pas le trouble sur la vérité judiciaire ?
P.R.-D. : Je ne suis pas partie couvrir ce procès à Grenoble pour trouver une Bovary, j’en ai vue une en arrivant sur place ! Cette femme, de cet âge-là, qui s’ennuie, en province, qui prend un amant... Personne mieux que Flaubert n’a décrit cette situation-là ! Qu’une telle ait tué son amant, ce n’est pas intéressant en soi. Ce qui faisait de cette femme une accusée si intéressante, c’est qu’elle était une Bovary contemporaine ! Dans le destin singulier de cette accusée-là, le lecteur retrouve une certaine universalité.
D. : Dans la mesure où vous êtes très attachée aux « moments d’audience », que pensez-vous des comptes rendus d’audience qui se font en direct sur Twitter, les « live-tweet » ?
P.R.-D. : Je change d’avis tout le temps. En fonction des audiences et des journalistes qui le font. Le premier bénéfice, c’est d’avoir fait revenir des journalistes dans les salles d’audience, et sur un temps long. Il faut distinguer deux formes : le « live-tweet » est différent du compte rendu en quasi-direct publié sur les sites lors de certains grands procès. Je préfère cette deuxième forme, qui est plus élaborée. Au début, j’ai eu peur que ça fasse disparaître la chronique judiciaire ! Et finalement, les deux cohabitent et ne s’adressent pas au même public. Personnellement, j’ai un peu testé le live-tweet, notamment pour le procès Galliano, mais c’est épuisant. Et puis j’ai arrêté car je pense que rien ne vaut un bon papier, ce travail qui consiste à faire décanter, sélectionner, éliminer pour donner forme à l’audience. Rien ne vaut le travail de composition, d’édition et de distance par rapport à l’information.
D. : Vous suivez les procès d’assises depuis 15 ans et avez connu l’introduction de la motivation des arrêts des cours d’assises après la loi du 10 août 2011. Qu’est-ce que cela a changé des procès criminels, d’après vous ?
P.R.-D. : Le plus souvent, je trouve que la motivation n’apporte rien. Mais il y a deux affaires exceptionnelles et très médiatisées où j’ai trouvé que c’était fondamental. Il y a eu la décision de la Cour d’assises d’appel de Rennes dans le procès Agnelet. Dans cette affaire ancienne, sans cadavre, qui avait déjà fait l’objet d’un acquittement puis d’une condamnation et qui revenait pour la troisième fois aux assises, il était essentiel de montrer dans la motivation toutes les étapes qui avaient convaincu les juges de la culpabilité de l’accusé. Et puis la deuxième motivation d’arrêt de cour d’assises que j’ai trouvée remarquable, est celle de l’acquittement de Georges Tron par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis. Initialement, la motivation a été faite pour les condamnés, diminuer l’arbitraire, leur dire pourquoi ils étaient condamnés. Et là, on a une motivation pour expliquer l’acquittement, expliquant que les relations sexuelles sont avérées, qu’il y a eu des pressions mais qu’il ne s’agissait pas de rapports sexuels contraints au sens juridique. Vu l’enjeu de cette affaire à l’époque Metoo, il était essentiel de faire comprendre cet acquittement. Cette motivation a été le seul moment de vérité de l’audience !
D. : En tant que témoin régulier des débats judiciaires, que pensez-vous du recours croissant à la visioconférence ?
P.R.-D. : J’y suis défavorable car je préfère, comme beaucoup, la présence de quelqu’un en chair et en os, et je crois beaucoup à la force du lieu de l’audience. Pour les experts, c’est peut-être différent, mais ça dépend desquels. Après, c’est facile d’être défavorable ! Dans la mesure où les audiences sont de plus en plus longues, on comprend que la visio soit perçue comme un moyen de gagner du temps. Il y a quand même beaucoup de répétitions et de temps perdu dans la procédure criminelle...
D. : Que pensez-vous d’ailleurs du projet de création des « tribunaux criminels » qui permettront de juger des affaires relevant autrefois des cours d’assises mais uniquement par des magistrats professionnels et avec le dossier en délibéré ?
P.R.-D. : Je me dis pourquoi pas, allons voir. Je ne me suis pas sentie concernée par les cris d’orfraies.
D. : Vous ne pensez pas que l’arrivée du dossier en délibéré et l’absence des jurés risquent d’abîmer l’oralité des débats à laquelle vous êtes si attachée ?
P.R.-D. : Oui, mais je sais que la majorité des procès auxquels je suis très attachée continueront à se dérouler aux assises. Et pour les autres affaires, sincèrement, je ne sais pas si tout le monde a intérêt aux assises, à cette durée, cette exposition, cette pression...
D. : Plus globalement, que pensez-vous des réformes visant à une dématérialisation croissante du travail judiciaire et à créer des obstacles à l’accès direct au juge, à favoriser la négociation préalable, et nourrissent une forme de déclin de l’audience perçue comme un temps judiciaire trop aléatoire et coûteux aux yeux de certains ?
P.R.-D. : Je me dis, après tout, pourquoi pas. Fondamentalement, je n’ai pas de plaisir à voir un individu mis en cause publiquement. Si demain François Fillon était condamné en audience de CRPC7et qu’on était privé d’un procès, je me dirais : « Il est d’accord pour cette procédure, il reconnaît donc qu’il est coupable, que l’enquête était légitime, n’est-ce pas le plus important ? » Alors que là, l’histoire est derrière nous, et pourtant on va sortir les tam-tams médiatiques pendant trois semaines de procès Fillon. C’est quand même beaucoup de journalistes qui pourraient être utilisés à faire d’autres choses.
D. : Même quand le débat public est passé à autre chose, que les enjeux semblent avoir dégonflé entre le moment où l’affaire éclate et celui où celle-ci est audiencée, vous ne pensez pas que l’audience publique peut être un moment de régulation nécessaire ? Comme dans l’affaire dite du Mur des cons à propos de laquelle vous avez pourtant écrit que c’était un procès « hors sujet et anachronique »8...
P.R.-D. : Oui, je trouve que le temps est souvent bénéfique. Mais, pour François Fillon, dans la mesure où il n’est plus susceptible d’être un personnage public qui occupe des responsabilités, ça n’a plus d’intérêt. Sur le procès du Mur des cons, quand j’ai écrit ça, c’est qu’en réalité, je pense, comme le Ministère public, que cette affaire ne méritait pas d’être renvoyée en correctionnelle. Et puis, c’était un procès très décevant car il n’a pas permis de faire progresser les choses, chacun est reparti avec la conviction que l’autre était un con.
D. : Vous avez dit tout à l’heure être attachée aux lieux. Que pensez-vous du nouveau tribunal de grande instance de Paris ?
P.R.-D. : Je l’aime beaucoup. Le Palais de justice de l’île de la Cité, c’est mon palais car c’est là que j’ai commencé. Mais je dois dire que quand je suis arrivée au nouveau TGI de Paris, j’ai été assez émerveillée par la lumière, la clarté, la propreté. Je sais que les professionnels ne sont pas très contents mais du point de vue des justiciables, qu’est-ce qui compte ? Être jugé là où Marie-Antoinette a été jugée, ne plus pouvoir déjeuner place Dauphine ? Je ne pense pas ! Quant à prendre la ligne 13 encombrée, les justiciables ne découvrent pas cette réalité, c’est leur quotidien.
D. : À propos de la conception de ce tribunal, l’architecte Renzo Piano a revendiqué la création d’un univers dé-symbolisé, éloigné du judiciaire. N’est-ce pas contestable dans un lieu où s’exerce une forme de violence institutionnelle qui doit être régulée par un langage symbolique, tant pour les justiciables que pour les professionnels ?
P.R.-D. : Je ne trouve pas ce tribunal dé-symbolisé, il y a des balances dans les salles d’audience. Les allégories dans l’ancien palais, on peut les trouver magnifiques, mais je me demande vraiment si elles font plus sens pour les justiciables que les maximes écrites sur les murs du nouveau TGI. Et avoir des fleurs de lys, des « lex » dans les caissons, des tapisseries sublimes et des inscriptions latines partout, ça vous aide vraiment pour juger ? Ce nouveau TGI de Paris est pour moi parvenu à quelque chose de positif. Je suis beaucoup plus critique sur des palais construits en régions, avec moins de moyens, que l’on décore avec des tapisseries de l’artiste du coin qui ne font pas sens, et où l’on assiste à une disparition complète des symboles judiciaires essentiels. Les salles d’audience du TGI de Paris, elles, par leur dépouillement et leur lumière, donnent une véritable sensation de proximité.
D. : Et à propos de la sensation de proximité, dans les salles d’audience de France ont fleuri au cours de l’été 2017, des box vitrés. Qu’en pensez-vous ?
P.R.-D. : Je partage l’avis des avocats là-dessus ! C’est beau ce moment où l’avocat est physiquement proche de quelqu’un qui est accusé. C’est essentiel cette respiration, de sentir celui ou celle que l’on défend à côté de soi. Et pour celui qui est dans le box de pouvoir toucher des mains à l’extérieur du box. Le verre empêche tout cela et c’est terrible.
Propos recueillis à Paris le 10 décembre 2018 par Elsa Johnstone, magistrate, coordinatrice de la rédaction.
Pour vous abonner à notre revue Délibérée c'est ici ou là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info
1- Après un procès en première instance qui s’est déroulé en novembre 2016, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf ont été condamnés en appel, en février 2018, à 20 années de réclusion criminelle pour leur responsabilité dans la mort de Fiona, alors âgée de 5 ans. Un pourvoi en cassation est en cours
2- Christiane Besnier, La vérité côté cour : une ethnologue aux assises, Paris, La Découverte, 2017.
3- http://prdchroniques.blog.lemonde.fr
4- Dominique Cottrez a été condamnée par la Cour d’assises du Nord le 2 juillet 2015 à 9 ans de réclusion criminelle pour 8 assassinats sur mineurs de moins de 15 ans, ses 8 nouveau-nés, entre 1989 et 2000.
5- Pascale Robert-Diard, « Cottrez : le surpoids du silence », article publié le 25 juin 2015 sur son blog hébergé par le site du Monde.
6- Pascale Robert-Diard, « La Bovary de Chambéry », Le Monde, 22 novembre 2016, article portant sur Nathalie Michellier, condamnée à 20 ans de réclusion criminelle en novembre 2016 pour le meurtre de son amant.
7- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, parfois appelée « plaider- coupable ».
8- Pascale Robert-Diard, « Le mur des cons, un procès anachronique et hors sujet », Le Monde, 8 décembre 2018.



