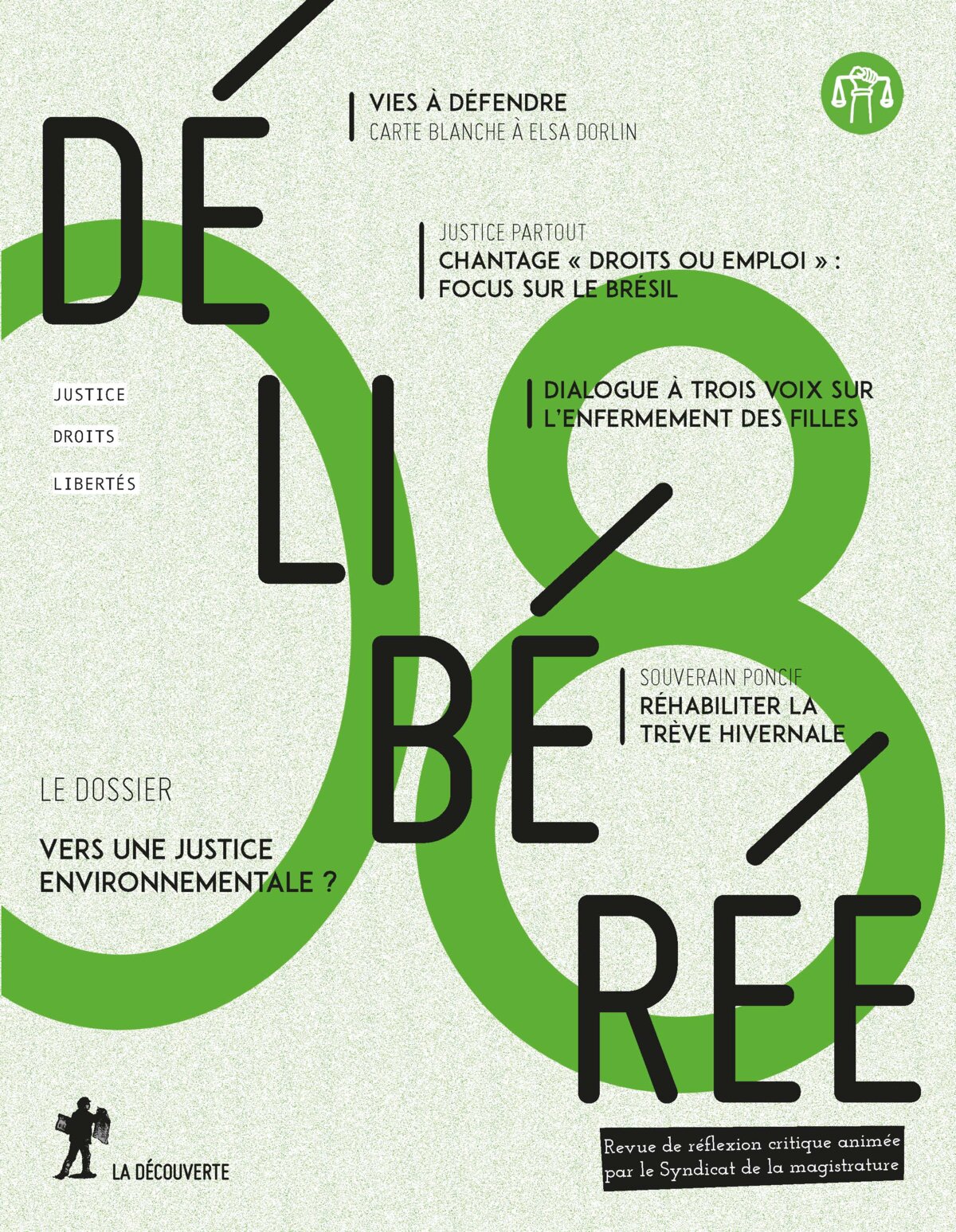
Agrandissement : Illustration 1
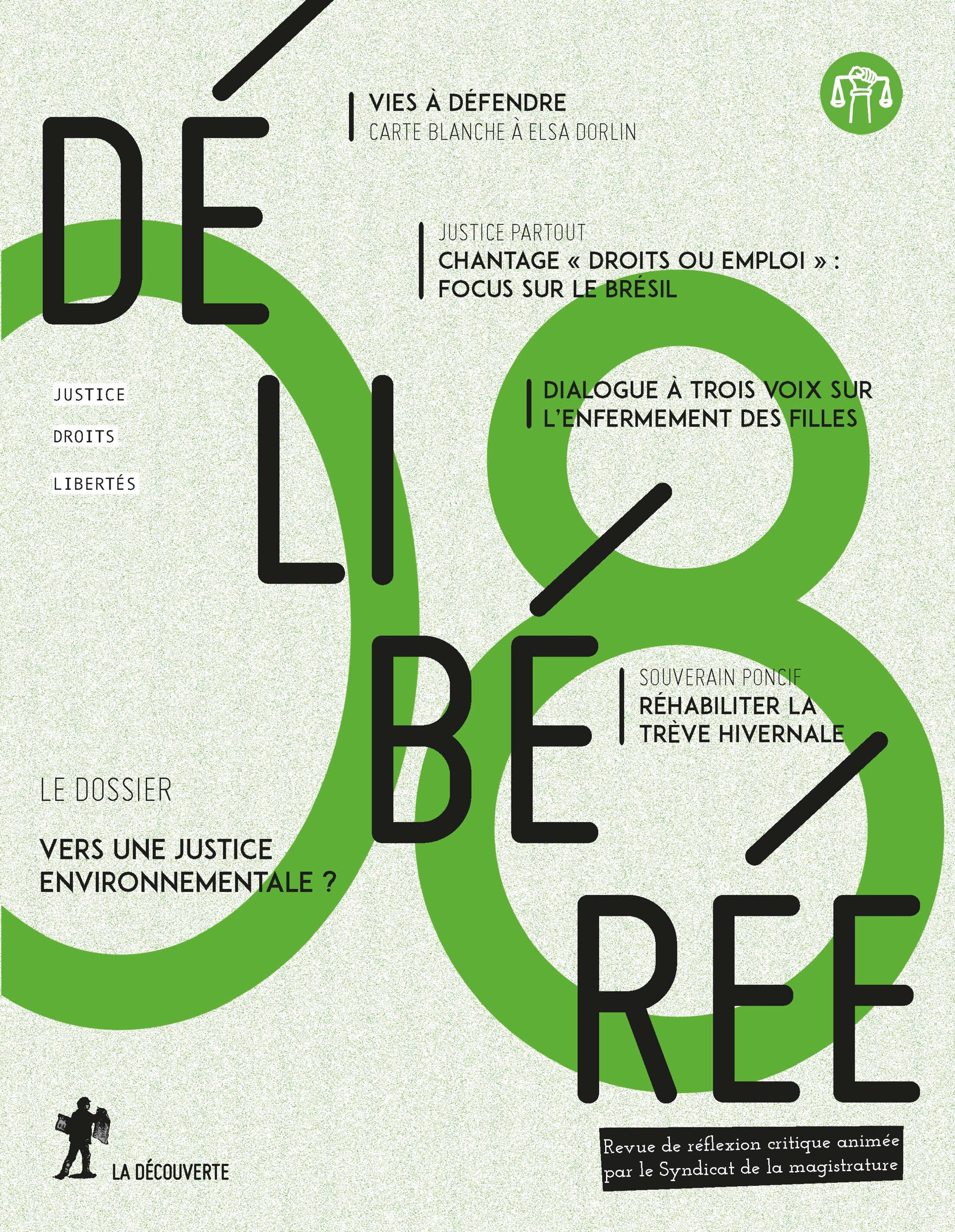
Elsa Dorlin est professeure des Universités ; elle enseigne la philosophie sociale et politique à Paris 8. Elle est notamment l'auteure de Se défendre : une philosophie de la violence (Zones, 2017).
Difficile de couper dans le fil du temps présent : mais prenons une séquence, définissons un segment qui partirait de la fin de l’hiver 2018 et courrait jusqu’au début de l’été 2019. Tendons un fil qui irait des évènements survenus sur la ZAD de Notre-Dame-Landes, des mobilisations
syndicales et sociales à la SNCF, à La Poste, dans les hôpitaux publics et les EPHAD, l’administration centrale, la justice ou l’éducation et les universités, des mouvements des Gilets Jaunes jusqu’à la disparition le 21 juin de Steve sur les quais de la Loire à Nantes ; en passant par ce qui fait figure non pas d’évènement à proprement parler mais de brèves quotidiennes : les centaines de milliers de morts en méditerranée ou dans les « jungles » de Calais, de Paris ou de Vintimille.
Cette chronologie, définie en ces termes, est quelque peu assommante. Difficile de se confronter à une matière dont on aurait distillé le tragique pur. Il faudrait mobiliser d’autres façons de penser, de réfléchir, ce qui n’est pas seulement un objet philosophique mais touche à l’expérience de nos vies politique. Bien sûr, cette chronologie marque la normalisation de mesures d’exception adoptées en 2015 dans le cadre de l’état d’urgence, passées désormais, pour partie, dans le droit commun. Les dispositifs légaux ne cessent d’étoffer un régime qui entérine, on le sait, un certain nombre de principes dignes des plus angoissants romans d’anticipation. À titre d’exemples, je retiendrai : les arrestations préventives, les interdictions de manifester, les obstructions à la libre information, la surveillance des réseaux sociaux et l’ensemble des dispositifs de fichage, qui au nom de la lutte contre le « terrorisme » touchent largement militantes et militants de ce que l’on appelle désormais les « mouvements contestataires », « casseurs » ou « ultras »… mais aussi l’octroi d’un droit à la légitime défense étendu par rapport au droit commun, spécialement conçu pour les forces de police et calqué sur celui dont jouissaient déjà les militaires (et donc les gendarmes)1.
Lutte pour le sens
Ce droit étendu à la légitime défense ne modifie pas franchement les contours de la légitimité acquise des interventions policières, les forces de l’ordre bénéficiant d’une relative protection juridique et jurisprudentielle en la matière2 ; en revanche, il intervient de façon significative dans la rhétorique justificative des techniques de maintien de l’ordre. En témoignent, au cours du segment défini plus haut, les discours mobilisés pour justifier le déploiement humain, logistique et balistique (dans certaines circonstances sans précédent en métropole comme dans le cas de l’opération à Notre-Dame-des-Landes) afin de réprimer des mobilisations ou pour justifier les « dommages » consécutifs à l’usage de la force : ces discours n’ont cessé d’évoquer la légitime défense des forces de l’ordre risquant leur vie pour rétablir « l’État de droit » face à des hordes stigmatisées comme « assassines ». Le mythe de la « force défensive » est, pour reprendre la définition de la mythologie de Roland Barthes3, une construction rhétorique qui permet efficacement de dépolitiser, c’est-à-dire de totalement désaffilier un évènement, une image de la trame historique dans laquelle il ou elle apparaît, et qui devient ainsi juste un signifié donnant lieu à un signifiant univoque : Christophe Dettinger est un dangereux agresseur4 et Geneviève Legay, une vieille dame qui n’aurait pas dû se trouver là qui a trébuché5.
Ce type de lutte pour le sens est difficile à percevoir tant elle est sidérante et entrave notre saisie de l’histoire, de l’historicité, c’est-à-dire des antagonismes et rapports sociaux, tant elle nivelle la complexité du réel commun, simplifie le monde vécu. « Dépolitiser » est une façon de réduire le politique (le réel commun donc), de rabattre ce qu’est le politique au seul acte du vote ; pour le reste retournons à nos écrans et aux soldes d’été.
Il demeure cette séquence historique qui se matérialise dans la chronique (notamment tenue par le journaliste David Dufresne6) des dizaines de mutilations par l’usage de LBD ou de grenades – œil, main –, la systématicité du gazage, du tabassage, du matraquage - comme récemment contre la mobilisation des Gilets noirs au Panthéon à Paris en juillet 20197-, les techniques de « nassage », les humiliations – rappelons-nous les images des lycéens à genoux à Mantes-La-Jolie en décembre 20188 –, la destruction de matériel – caméra, appareils photos, téléphones, lunettes, banderoles, nécessaire des street medics dans le cadre du mouvement des Gilets Jaunes – ; mais aussi le fichage, le profilage, les arrestations et les peines d’emprisonnement ferme qui, au-delà du fait de laminer les contestations et mouvements sociaux, suffisent à eux seuls à faire passer l’envie d’exercer ses droits fondamentaux à commencer par la liberté d’opinion et de manifestation.
Ainsi, c’est bien l’idée que la légitimité de la défense policière se fonde désormais non pas sur un danger réel, imminent et directement menaçant pour un individu (en uniforme ou non), mais sur le soupçon d’une telle menace, ou d’une potentielle menace, attentant à « la vie » des forces de police, à « l’intégrité » du territoire nationale ou des valeurs de la République, c’est-à-dire à des dispositifs, des biens matériels et symboliques ; c’est cela qui prime et a valeur de justification dans l’usage disproportionné et toujours déjà légitimé d’une violence mortifère. Mortifère au sens propre du terme, car sans parler de la dimension éminemment brutalisante et terrorisante de telles techniques de pouvoir, il faut désormais compter nos mains, nos yeux mais aussi nos vies dès lors que nous sortons pour aller faire la fête ou tout simplement que nous regardons à la fenêtre de notre appartement : le décès de Zineb Redouane à Marseille9 en témoigne, la disparition de Steve Maia Caniço à Nantes10 également.
Lutte contre le silence
Mais, ici point de déferlement rhétorique assourdissant et abrutissant sur les plateaux télévisés ou les fils des réseaux sociaux de la part des membres du gouvernement, représentants de l’État français : silence11. Le silence est cette autre arme idéologique que l’on peut considérer comme le pendant de la saturation sémantique à laquelle s’adonnent les stratèges de la communication politique. Car parallèlement à cette guerre des mots où l’imposition d’éléments de langage sur la violence depuis ces derniers mois consiste à renverser le rapport de cause à effet – comme si les répressions policières n’étaient « que » des réactions défensives à une violence première, barbare, apolitique, sauvage – il y a ce silence comme arme si caractéristique de la période contemporaine où la suspension même de tout communiqué officiel joue sur la reconnaissance première de la réalité des faits, et efface tout simplement des vies du réel.
Finalement, de la même façon que des Gilets Jaunes se sont exprimés sur le fait qu’ils et elles réalisaient que la violence répressive dont leurs corps ont été la cible depuis des mois ressemblait à s’y méprendre à celle déjà très bien rodée qui se déploie dans les quartiers populaires depuis des décennies, principalement à l’encontre des hommes Noirs et descendants de l’immigration coloniale12 ; de la même façon donc, le slogan « Où est Steve ? », entre en résonance avec les demandes de vérité et justice du Comité du même nom qui se mobilise depuis trois ans pour que la mort d’Adama Traoré, décédé à 24 ans dans la cour de la gendarmerie de Persan en juillet 201613, pour que sa vie, son existence ne soit pas un fait divers oublié. Arborer un tee-shirt « Vérité et Justice pour Adama » comme signe de ralliement du mouvement de lutte contre les violences policière et l’État policier, arpenter les rues de Marseille et lire sur tant de murs le nom de Zineb Redouane avec ses dates de naissance et de décès comme autant de stèles farouches, folles de chagrin et de rage ; répondre à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi par la seule question "où est Steve?", qui oblige jusque sur les bancs des assemblées parlementaires certain.es élu.es à interpeller le ministre de l'intérieur… Tout cela relève d’une forme de lutte pour défendre la vie, des vies, nos vies.Cette lutte vise bien sûr à restaurer la dimension politique de la mort, mais se déploie encore pour que des vies ne disparaissent pas du réel commun, soient reconnues comme dignes : a minima dignes d’être nommées, dignes aussi d’être pleurées – nationalement –.
L’enjeu réside donc dans le nom, c’est-à-dire dans ce qui fait d’une vie une existence, celle d’un alter ego : la mobilisation sociale en est à lutter contre l’oubli, plus encore à combattre l’effacement et la déréalisation. On comprend pourquoi la demande de justice et les actions en justice constituent alors la dernière chance de la reconnaissance, le dernier recours, tant l’institution judiciaire se fonde et tire sa légitimité de son pouvoir de qualification et donc précisément de reconnaissance.
A l’aune des centaines de milliers de morts anonymes qui périssent dans la Méditerranée depuis plusieurs années, dans les jungles de Calais, de Paris et d’ailleurs, de cet homme, exilé – dont précisément je ne peux pas dire le nom –, retrouvé pendu en juillet 2019 dans un jardin public du 18e arrondissement de Paris14, les vies que l’on ne peut plus dénombrer, dénommer, témoignent d’une nouvelle cartographie biopolitique : le principe discriminant entre les vies que l’on « fait vivre », à qui on assure les conditions de leur existence biologique, sociale, culturelle et politique, et celles que l’on « laisse mourir » selon la formule Foucaldienne15, ne passe plus seulement par le droit et les cadres légaux dans lesquels on est interpellé ou destitué comme un sujet politique, mais aussi par ce dernier degré de la reconnaissance où des vies sont devenues tuables précisément parce qu’elles sont déjà considérées comme innommables.
Il n’est jamais facile de réfléchir le contemporain : ce que nous vivons, ce dont nous sommes témoins ici et maintenant. Il se peut que transpire de ce récit philosophique la dimension tragique du politique tel que nous en faisons l’expérience, précisément parce que face à l’État contemporain tel qu’il se façonne dans des pratiques et s’incarne dans des dispositifs matériels et discursifs, nous sommes de plus en plus à sentir dans notre chair le risque de blessure, de mort auxquelles il nous expose. La biopolitique est passée du côté de la thanatopolitique. Désormais la révolte se jouera autour de cet ultime élan d’autodéfense de nos vies : « Vies à défendre ».
Elsa Dorlin
Pour vous abonner à notre revue Délibérée c'est ici ou là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info
1 La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique insère dans le code de la sécurité intérieure de nouvelles dispositions sur l’usage des armes, et notamment l’article L.435-1. Pour une critique de ces dispositions, voir le communiqué de presse du Syndicat de la Magistrature du 7 février 2017 (http://www.syndicat-magistrature.org/Projet-de-loi-securite-publique-2561.html).
2 Lire Vanessa Codaccioni, La légitime défense. Homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières, CNRS éditions, août 2018.
3 Pour Barthes, « Le mythe est une parole » qui s’analyse comme un système sémiologique, c’est à dire par l’étude des signes et de leur signification (Roland Barthes, «Le mythe aujourd’hui», in Mythologies, Seuil, 1957, pp. 181 à 233).
4 Christophe Dettinger, ancien boxeur professionnel, a été identifié comme la personne ayant, pendant la manifestation des Gilets Jaunes du 5 janvier 2019 à Paris repoussé un groupe de gendarmes en boxant puis, lors d’une autre séquence, donné des coups de pieds à un autre gendarme à terre, sur des vidéos devenues virales. Il se rend de lui-même aux autorités le 7 janvier, est placé en garde à vue puis en détention provisoire dans l’attente de son procès en comparution immédiate. Jugé le 13 février 2019, il explique notamment avoir défendu une femme frappée à terre à coup de matraque et de pieds par un gendarme, version confirmée par la personne ; une autre témoin indique que Dettinger et d'autres l'ont protégée des forces de l'ordre. Il est condamné à 30 mois d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, une interdiction de paraître à Paris pendant 6 mois, la prison ferme étant à exécuter sous un régime de semi-liberté accordé ab initio.
5 Geneviève Legay est une militante d’Attac de 73 ans, qui, alors qu’elle manifestait en portant un gilet jaune à Nice dans le périmètre d’interdiction de manifestation selon un arrêté préfectoral publié très tardivement, chutait du fait d’une charge policière, et subissait de graves blessures à la tête. La séquence filmée devenait virale et était largement commentée par politiques et autorités, dans un storytelling évolutif mais ayant pour point commun le déni d’un emploi illégitime de la force policière ayant causé les blessures. À ce jour, une information judiciaire est toujours en cours, et a fait l’objet d’une délocalisation à Lyon compte tenu de l’attitude du parquet durant l’enquête initiale, tandis que des éléments vont dans le sens d’une charge policière disproportionnée.
6 Lire David Dufresne, «Six mois d’«Allô Place Beauvau»: chronique des violences d’État», Médiapart, 17 mai 2019.
7 Lire Thomas Clerget, «Occupation du Panthéon : « Ils ont voulu terroriser des gens qui ont relevé la tête, et qui n’ont plus peur », Bastamag, 15 juillet 2019.
8 Voir «À Mantes-la-Jolie, des images choquantes de lycéens interpellés par la police», Le Monde, 6 décembre 2018.
9 Zineb Redouane, habitante de Marseille âgée de 80 ans, est décédée à l’hôpital le 2 décembre 2018 lors d’une opération le lendemain de son admission pour des blessures graves au visage subies alors qu’elle fermait la fenêtre de son appartement situé au 4ème étage, ces blessures étant causées par un jet de grenade lacrymogène par un membre des forces de l’ordre présentes dans la rue dans le cadre de manifestations. Une information judiciaire est en cours pour recherche des causes de la mort, les parties civiles sollicitant le dépaysement de l’affaire en lien avec l’attitude du parquet.
10 Steve Maia Caniço est porté disparu depuis le 21 juin 2019, nuit de la fête de la musique ; une information judiciaire en recherche des causes de la disparition est en cours. Il a été vu pour la dernière fois participant puis dormant à proximité d’un rassemblant festif organisé sur les quais de la Loire, rassemblement interrompu par les forces de l’ordre usant notamment de gaz lacrymogène de façon abondante, acculant ainsi plus d’une dizaine de personnes à se jeter ou tomber dans la Loire d’environ 6 mètres de haut.
11 Louise Fessard, «Zineb Redouane: sa famille s'étonne du «silence politique» après sa mort», Médiapart, 9 mars 2019 ; Julie Carriat, Yan Gauchard, Abel Mestre et Sylvia Zappi « Où est Steve ? » : le grand silence politique autour du disparu de Nantes», Le Monde, 12 juillet 2019.
12 Voir par exemple Anna Mutelet, «Marche pour Adama Traoré : avec les gilets jaunes, «l’union fait la force», Libération, 21 juillet 2019.
13 Adama Traoré, âgé de 24 ans, est contrôlé en compagnie de l’un de ses frères le 19 juillet 2016 vers 17 heures à Beaumont-sur-Oise ; il sera interpellé après une course poursuite, avec utilisation de la technique dite du « plaquage ventral », transporté en voiture à la gendarmerie de Persan, où son décès sera constaté environ 2 heures plus tard alors qu’il se trouve au sol, menotté, face contre terre. La communication et les investigations initiales menées par le parquet de Pontoise ont là aussi été largement critiquées et l’affaire a été dépaysée. L’information judiciaire est toujours en cours.
14 «Un migrant retrouvé pendu dans un square parisien, près de la porte de la Chapelle», Infomigrants, 18 juillet 2019.
15 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, vol. 1, La volonté de Savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 177 et s.



