Ce texte est tiré de la rubrique "Justice partout" du numéro 18 de la revue Délibérée sorti en librairie en mars dernier. Il a été écrit par Jérôme Baschet historien. Longtemps enseignant-chercheur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, il travaille actuellement à l’Universidad Autónoma de Chiapas (San Cristobal de Las Casas). Outre ses ouvrages d’histoire médiévale, tel Corps et âmes. Une histoire de la personne au Moyen Âge chez Champs-Flammarion (2022), il est notamment l’auteur de Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits (2018) et de Basculements. Mondes émergents, possibles désirables (2021) tous deux chez La Découverte.
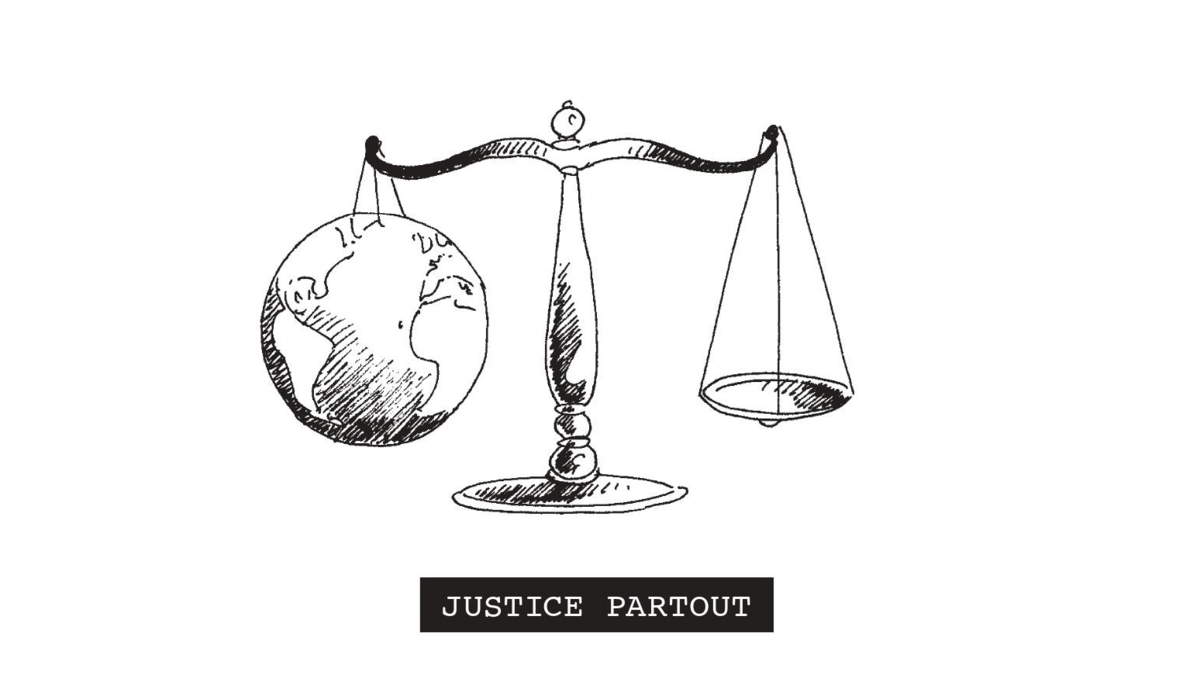
Agrandissement : Illustration 1
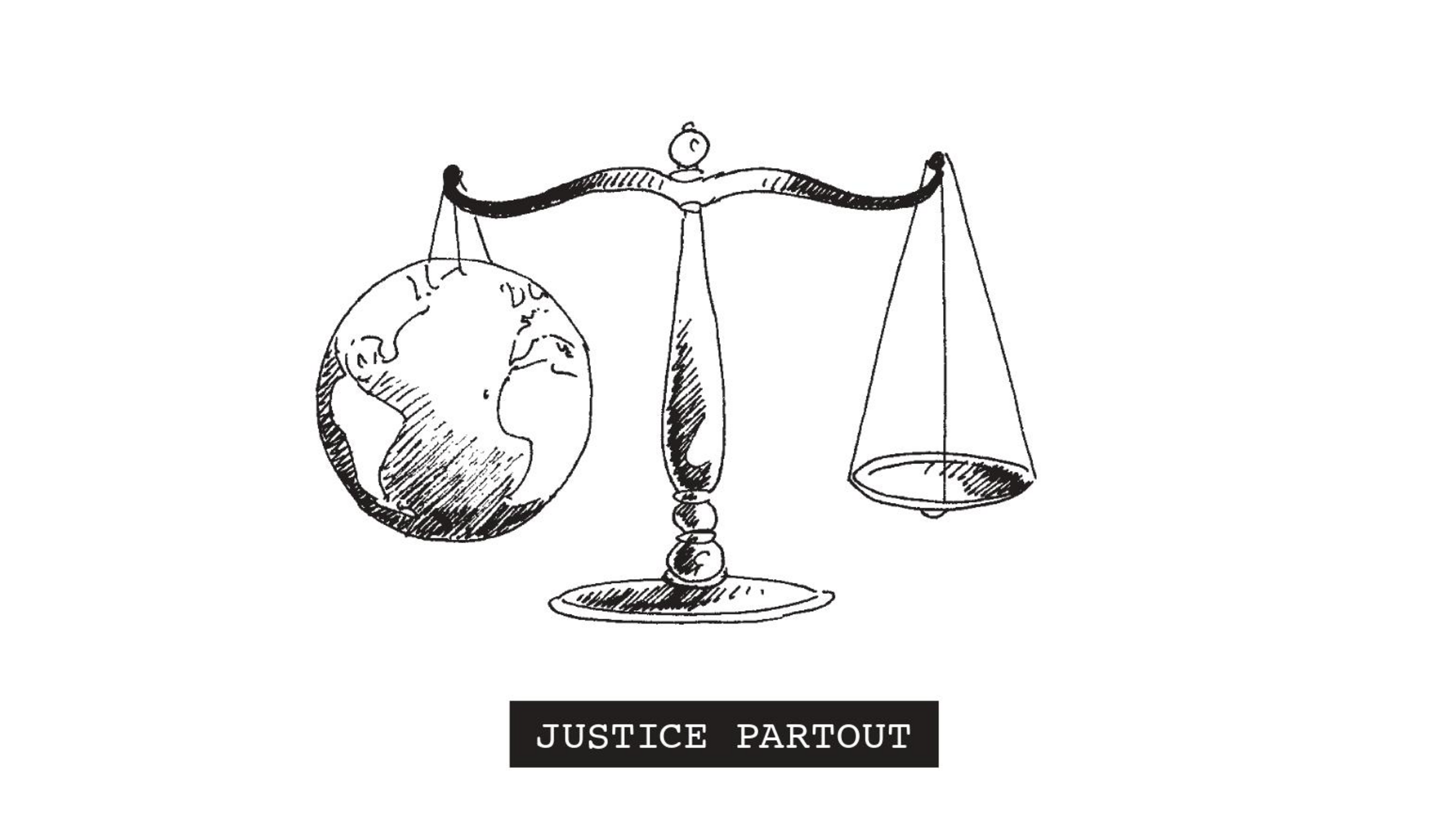
Dans les territoires rebelles du Chiapas, depuis le soulèvement du 1er janvier 1994, les zapatistes expérimentent des formes d’autogouvernement populaire. Dans une complète sécession vis-à-vis des institutions de l’État mexicain et avec le souci de se dissocier autant que possible des logiques de marchandisation qui, partout, dévastent les mondes du vivant, ils ont mis en place, malgré un contexte hostile et dans des conditions précaires, leurs propres instances de gouvernement et de justice ; ils inventent aussi des formes originales d’organisation du travail productif et organisent leur propre système d’éducation et de santé1. Ils déploient ainsi ce qu’ils nomment leur autonomie, c’est-à-dire la liberté de créer des formes de vie autodéterminées et éprouvées comme leurs, à la fois ancrées dans la tradition communautaire des peuples indigènes et soucieuses de se transformer dans un sens émancipateur. Ce qui émerge ainsi, non sans difficultés ni limites, dans les territoires zapatistes du Chiapas peut être considéré comme l’une des utopies réelles les plus remarquables qu’il soit donné d’observer aujourd’hui à l’échelle planétaire.
Dans un tel contexte, la pratique de la justice paraît réintégrée dans le tissu d’une vie communale auto-organisée ; elle vise la médiation plutôt que la punition carcérale et rompt avec une logique de spécialisation et d’hyperinstitutionnalisation.
Une justice intégrée dans les instances d’autogouvernement
L’autonomie dans les territoires zapatistes articule trois échelles d’organisation : les villages (ou communautés), les communes autonomes (elles regroupent chacune des dizaines de villages et sont actuellement au nombre de 31) et les régions, appelées ici « zones », avec leurs « conseils de bon gouvernement » qui coordonnent l’action de plusieurs communes autonomes (5 conseils ont été créés en 2003, puis 7 autres en août 2019). À chaque niveau interagissent des assemblées et des instances élues (agent communautaire avec ses aides ; conseils municipaux ; conseils de bon gouvernement).
La justice peut être rendue par l’ensemble des «instances de l’autonomie», à ces trois niveaux, en privilégiant autant que possible l’échelle la plus locale2. C’est alors l’agent communautaire qui est saisi ; mais lorsque l’affaire est plus délicate, elle peut aussi être soumise à l’assemblée tout entière. Si la communauté ne parvient pas à résoudre le problème, notamment en cas de récidive, il est transmis aux autorités de la commune, voire au conseil de bon gouvernement de la zone correspondante. Les instances communales ou de zone peuvent aussi être saisies directement s’il s’agit d’un cas particulièrement grave – ce qui est rare – ou lorsque sont mises en cause des personnes appartenant à différentes communautés ou communes, ou encore lorsque sont impliqués à la fois des zapatistes et des non-zapatistes.
Le plus étonnant est que de nombreux non-zapatistes choisissent de faire appel aux autorités autonomes. En contraste avec le haut degré d’impunité, de corruption et de racisme qui caractérise la justice constitutionnelle mexicaine, la justice autonome est rendue attractive par le fait que ses instances agissent à partir de leur propre implication dans la réalité des communautés indiennes et par sa complète gratuité. Non seulement la justice autonome n’exige pas de payer pour chaque document émis, ou encore pour couvrir les frais d’avocat, mais elle exclut toute forme d’amende, dès lors que, dans l’ensemble des domaines de l’autonomie, les zapatistes s’emploient à réduire autant que possible le rôle de l’argent, entendu comme forme dominante des relations sociales dans le monde capitaliste.
Les problèmes traités sont en partie différents, selon que l’on se situe à l’un ou l’autre des trois niveaux indiqués. Au sein de la communauté, on peut mentionner des vols d’animaux, des conflits liés aux limites des parcelles, la coupe d’arbres en contravention des règles communautaires, la vente d’animaux sauvages ou de poissons pêchés dans les rivières, des infractions à l’interdiction de la consommation d’alcool, des faits de violence intrafamiliale, ainsi que des cas de divorce. Pour l’essentiel, il s’agit, comme le résume Paulina Fernandez, de « problèmes simples, propres aux relations de voisinage, qui peuvent souvent se résoudre de façon immédiate, par une simple clarification de la situation »3. Lorsqu’il s’agit de situations peu graves – comme la diffusion de rumeurs (chismes, en castillan), c’est-à-dire de propos diffamatoires envers une personne – un simple rappel aux bons usages communautaires suffit, tandis que c’est seulement en cas de seconde récidive qu’une sanction peut être prononcée.
En revanche, la violence de genre, considérée comme grave, fait l’objet d’une attention particulière, puisque sa dénonciation figure déjà dans la « Loi révolutionnaire des femmes », imposée par ces dernières dès 1993, avant même le soulèvement4. C’est aussi à l’initiative des femmes zapatistes que la consommation d’alcool, instrument historique de la soumission des indigènes notamment dans les haciendas du XIXe siècle, mais aussi cause majeure de la violence intrafamiliale, est totalement interdite dans les territoires zapatistes. Cette mesure drastique a permis d’en réduire fortement l’incidence, même si de telles situations restent avérées. Dans ce cas, l’instance de justice convoque les parties et établit un document par lequel le mari s’engage à mettre fin à toute forme de violence. En cas de récidive, une enquête est menée et plusieurs journées de travail communautaire sont requises. Si la femme demande la séparation, l’autorité engage la procédure de divorce et s’assure qu’elle se déroule sans nouvelles violences.
À l’échelle municipale, la majorité des cas est marquée par une implication de non-zapatistes. On y voit apparaître des vols plus importants, par exemple de chevaux ; il arrive aussi que les autorités municipales interviennent pour mettre fin à des trafics de bois précieux ou de drogue (menés par des non-zapatistes). Les litiges agraires sont aussi volontiers traités à ce niveau. Ainsi, une veuve se plaint que le frère de son mari défunt prétend la déposséder de ses terres (selon une logique traditionnelle qui ne reconnaît pas la possession des parcelles par les femmes) ; mais, après enquête, les autorités municipales font signer aux deux parties un accord reconnaissant à la veuve la possession des terres et elles en fixent les bornes de délimitation5.
Quant aux conseils de bon gouvernement, ils traitent les problèmes non résolus par les communes, notamment en matière de conflits agraires ou de trafic de bois, de drogue ou de migrants, ainsi que des cas de plantation de marijuana (par des non-zapatistes). Y sont aussi traités les conflits provoqués par les membres d’autres organisations. Enfin, dans le cas très exceptionnel d’un homicide, le conseil de bon gouvernement souligne combien il est important d’écouter la famille de la victime, de lui accorder son soutien et de lui laisser le temps nécessaire pour affronter cette situation. Sous ces conditions d’écoute attentive et de temporalité adéquate, le conseil peut mettre en discussion la possibilité d’un accord entre la famille et le coupable. Dans le cas rapporté par Paulina Fernandez, un tel accord, prévoyant que l’auteur de l’homicide cède une partie de ses terres et de ses animaux à la famille de la victime, finit par être accepté6. Reste au conseil à veiller à ce que le coupable tienne parole et cesse tout comportement agressif, auquel cas la vie communautaire peut reprendre son cours.
Une justice de médiation
La justice autonome est une justice de médiation. Les autorités autonomes de la zone de La Garrucha l’expliquent ainsi : « la justice, cela consiste à régler les problèmes d’une manière bonne et pacifique. Ici, il y a une médiation, on peut parler, enquêter, demander à chaque partie ; il y a la réconciliation […]. C’est pour cela que les gens d’autres organisations viennent ici chercher la solution » ; « les parties se rencontrent, chacun peut expliquer sa version et l’autorité modère la discussion entre les parties afin de parvenir à un accord »7. Dans ce cas, un « Acte d’accord » est établi et signé par tous. Ainsi, ce que fait l’autorité – outre enquêter lorsque c’est nécessaire –, « c’est tout simplement raisonner avec les personnes, les prendre en compte […] afin que les deux parties soient satisfaites et qu’ainsi [la situation] soit résolue ».
Certes, on peut s’interroger sur les conditions de possibilité d’une telle justice de médiation qui, au demeurant, a existé dans de très nombreuses sociétés. Elle repose notamment sur le fait que l’instance médiatrice bénéficie d’une légitimité reconnue par tous et d’une autorité morale dont découle une efficace incitation à rechercher un accord. C’est parce qu’on voit en elle une garantie de justice et de bonne solution pour tous que la médiation peut fonctionner. De ce fait, la médiation n’est pas sans limites. Ainsi, lorsqu’un accord ne peut pas être trouvé au niveau de la communauté, le cas est transmis aux autorités de la commune autonome, et lorsque celles-ci n’y parviennent pas davantage, il revient aux instances de justice du conseil de bon gouvernement d’intervenir. Cependant, même à ce niveau, il est clair qu’aucune médiation n’est possible avec les membres des organisations qui ne reconnaissent pas la légitimité des instances autonomes et qui, bien souvent, agressent les zapatistes, cherchent à s’emparer de leurs terres ou à les chasser de leurs villages. Ces organisations, qui ont bien souvent un caractère paramilitaire, poussent à l’exacerbation des tensions dans une perspective contre-insurrectionnelle au sein de laquelle les gouvernements chiapanèque et fédéral jouent un rôle d’incitation. Dans de tels cas, les conseils de bon gouvernement n’ont guère d’autre moyen d’action que le recours à une dénonciation publique, en quête de soutien national et international. En septembre 2021, face à la séquestration de deux membres de l’un des conseils de bon gouvernement, c’est même l’EZLN (Ejército Zapatista de Liberación National) qui avait dû émettre un communiqué pour faire connaître cette situation particulièrement grave8. Déjà en 2014, l’assassinat par une organisation paramilitaire d’un membre du conseil de bon gouvernement de La Realidad, Galeano, avait conduit cette instance à se dessaisir de son rôle et à demander à l’EZLN d’assumer la responsabilité de la situation, notamment pour prévenir la tentation de la vengeance et éviter une escalade de la violence9.
Il va de soi que l’exercice de la justice autonome trouve ses limites lorsqu’elle se confronte avec un monde hostile au projet d’autonomie. Elle ne peut être effective que sur la base d’une reconnaissance partagée des instances de justice et de leur capacité à impulser un accord – capacité qui n’est pas liée uniquement au sens de l’écoute des personnes qui exercent de telles charges, mais aussi à la légitimité d’instances capables de faire valoir à tous le bénéfice qu’il y a à surmonter les conflits et à restaurer les conditions du bien-vivre communautaire et communal.
Dans une telle logique de médiation, la prison n’a pas sa place. De fait, la justice zapatiste offre une critique radicale de la prison – critique particulièrement pertinente au Mexique où les emprisonnements sur la base de délits fabriqués sont monnaie courante, tandis que nombre de crimes réels sont voués à une impunité généralisée10. En outre, à la souffrance de la victime et de sa famille, la prison ajoute celle des proches du coupable, privés de son travail et de son rôle familial. Enfin, loin de préparer à une quelconque réinsertion sociale, les prisons sont des écoles de la délinquance, en particulier au Mexique, où l’institution carcérale est gangrenée par le pouvoir des cartels.
Dans la justice autonome zapatiste, la prison ne fait pas partie du répertoire des peines et son usage (limité) est essentiellement préventif, pour répondre aux besoins de l’enquête ou lorsqu’une personne accusée est menaçante11. Par ailleurs, une personne en état d’ivresse sera tenue enfermée pendant 24 heures dans une simple pièce fermée à clé. C’est exceptionnellement que certaines fautes mineures peuvent faire l’objet d’un bref emprisonnement en cas de récidives multiples : 24 heures, par exemple, pour avoir continué à colporter des informations diffamatoires, en dépit de deux avertissements préalables. Malgré ces usages ponctuels, l’expérience de l’autonomie zapatiste permet d’entrevoir ce que peut être une justice débarrassée de l’usage punitif de la prison.
Ce qui est recherché ici, c’est l’accord, comme condition de la réconciliation entre les parties mais aussi avec la communauté dans son ensemble, dès lors que ses règles ont été enfreintes. Dans bien des cas, cette réconciliation a pour préalable une réparation. Il peut s’agir d’une simple restitution – en cas de vol notamment – ou bien, lorsque cela n’est pas possible, d’une compensation pour le dommage subi (« reponer el daño »). Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce principe s’applique également en cas d’homicide. La solution qui prévaut alors repose le plus souvent sur la cession d’une terre, à moins que le coupable ne s’engage à travailler durant plusieurs années pour le bénéfice de la famille de la victime, notamment afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais si malgré des tentatives réitérées de médiation, le temps ne permet pas de retrouver les conditions d’une coexistence acceptable et notamment si l’auteur de l’homicide continue de se montrer agressif, la seule option viable peut être son exclusion de la communauté, de façon temporaire ou définitive. C’est là une limite de la justice de médiation ; mais c’est aussi, du fait du caractère dissuasif d’une telle sanction, une des conditions sous-jacentes de son efficacité, du moins dans les cas graves.
Compte tenu du souci de restreindre le recours à l’argent, la justice autonome exclut les amendes, de sorte que la réparation consiste le plus souvent en jours de travail au bénéfice des victimes ou de la communauté. Pour certains vols graves (un cheval, par exemple), trois ou quatre jours de travail communautaires peuvent s’ajouter à la restitution. De même, en cas d’ivresse : deux jours de travail, la première fois ; quatre, s’il y a récidive. Dans des cas plus graves, le nombre de jours de travail peut s’élever à 15, voire 30. On pourra s’étonner que le travail collectif soit effectivement réalisé, y compris par des non-zapatistes ou par des personnes d’autres communes. Selon les explications des membres des conseils autonomes, tous comprennent pourtant qu’il vaut mieux suivre la voie qui conduit à la réconciliation : « en reconnaissant ton erreur, tu t’en sors mieux qu’en ne respectant pas l’accord »12. On peut citer le cas, exceptionnel mais significatif, d’un trafiquant de migrants venu du Guatemala et arrêté par les autorités autonomes. Il a accompli, sans s’enfuir, une sentence de six mois de travail communautaire, au cours desquels il a notamment participé à la construction d’un pont donnant accès à l’hôpital autonome de San José del Rio. À la fin, il a remercié les autorités autonomes : « vous m’avez mis dans une école et maintenant je peux m’en aller et construire des maisons »13.
À ce stade, on peut se demander s’il ne conviendrait pas de remettre en cause les notions mêmes de délit et de punition (castigo, en castillan). On a en effet le sentiment que les instances en charge de la justice ont moins pour logique de déterminer des délits et des peines que d’affronter des problèmes portant atteinte au tissu de la vie collective et de rechercher les solutions permettant de les surmonter. Pour les autorités zapatistes, il s’agit en effet de « résoudre les problèmes et [de] trouver une bonne solution pacifique »14. Comme l’indique Raoul Vaneigem, « un grand progrès aura été accompli lorsque, révoquant la culpabilité et le châtiment, on commencera à penser qu’il s’agit bien plutôt d’une erreur qui exige réparation. Quand une blessure a porté atteinte au tissu de la communauté – non pas une communauté abstraite, mais la vie de chacun et la relation accordée avec les autres –, celui qui en est responsable doit prendre soin de la situation et aider à soigner cette blessure »15.
La déspécialisation de la justice
L’autonomie zapatiste invite également à penser une radicale déspécialisation de l’exercice de la justice. De fait, la justice autonome est rendue par des personnes ordinaires, membres élus (pour trois ans) d’un conseil communal ou d’un conseil de bon gouvernement, mais n’ayant ni formation spécifique ni expérience particulière, et qui pourtant s’acquittent de cette responsabilité de façon satisfaisante pour leurs communautés. C’est que le rôle de médiation suppose moins un savoir spécialisé, séparé, qu’une capacité d’écoute et un sens de l’accord. Dans une justice ainsi conçue, le pouvoir de celles et ceux qui rendent temporairement la justice est faible et leur rôle est directement ancré dans les formes de la vie quotidienne. C’est tout le contraire de ce que l’on voit s’affirmer lorsque la procédure inquisitoire prend son essor, à partir du XIIIe siècle, en Europe : le pouvoir des juges s’en trouve d’autant renforcé, a fortiori si l’on considère qu’il leur revient d’établir la Vérité, par l’enquête dont ils ont, dès lors, l’initiative.
Certes, on ne saurait dire que tout droit a disparu. Il existe en effet des règles communautaires. Celles-ci relèvent en grande partie de l’oralité, mais de nombreux villages zapatistes se sont donné pour tâche de fixer par écrit, à chaque fois localement, les règles qu’ils assument et qui peuvent en partie s’écarter de la tradition, notamment en ce qui concerne les rapports de genre. De cette manière, le principe selon lequel « nul ne peut ignorer la loi » qui, dans le droit abstrait est lui-même une abstraction, devient ici une réalité concrète, puisque tous les membres de la communauté ont participé à l’élaboration de ces règles ou du moins à leur actualisation régulière : « chaque communauté établit sa propre loi », expliquent les zapatistes, « le peuple l’a approuvé ; ils l’ont signé ; ainsi chacun sait ce qu’il recevra s’il viole ces règles »16
Nous sommes ici au plus loin d’une justice hautement spécialisée, fortement ritualisée et fondée sur une extrême codification du droit. Et tandis que la justice d’État, drapée dans la solennité imposante de l’institution et jouant des ressources de la théâtralisation, se sépare du commun des mortels et infériorise bien souvent celles et ceux qu’elle soumet à ses procédures, la justice autonome refuse de se constituer en pratique dissociée du monde quotidien. Elle s’exerce sans spécialisation, dans la simplicité d’un agir ordinaire. La leçon pourrait alors se formuler de manière double. D’un côté, on perçoit la nécessité de formuler des règles collectivement assumées mais toujours fluides et de recourir à des instances spécifiques qui, pour pouvoir remplir leur rôle de médiation, doivent être dotées d’une légitimité reconnue par toutes et tous. De l’autre, cette expérience suggère qu’il est possible d’opérer une ample désinstitutionnalisation pour réincorporer la résolution des conflits dans le tissu d’une vie collective autodéterminée.
Au total, la justice autonome zapatiste offre l’exemple d’une justice arbitrale de médiation, soucieuse d’apporter une solution aux problèmes de la vie collective et s’exerçant de façon déspécialisée, comme un aspect des pratiques d’auto-organisation communautaire et communale. Mais la question ne saurait se limiter à déterminer le type de justice auquel nous avons à faire, sans se demander dans quel monde elle prend place. En l’occurrence, il s’agit de savoir ce qu’il peut rester des tâches de justice dans un monde qui s’emploie à faire prévaloir le bien vivre de toutes et tous et dont l’organisation même pourrait être qualifiée de juste. Sans prétendre constituer la pleine matérialisation de ces principes, l’autonomie zapatiste suggère qu’un tel basculement a toute chance d’entraîner une réduction massive des délits commis, sans pour autant s’en remettre au vain postulat d’une complète élimination des conflits et des actes contraires aux règles collectivement acceptées. De fait, ce qui rend possible le fonctionnement des justices autonomes zapatistes, c’est aussi la relative simplicité des cas à traiter et la rareté des crimes graves. À cet égard, on doit relever que les zapatistes ont tenu à souligner qu’au cours des dernières années, il n’y a eu aucun féminicide dans les territoires autonomes – ce qui, au vu de la violence structurelle qui règne au Mexique, porte une signification particulièrement frappante17.
L’expérience zapatiste ne s’en déploie pas moins dans un environnement très hostile. De nombreux facteurs de conflits sont liés aux politiques contre-insurrectionnelles qui la visent, tandis que la délinquance organisée, avec son lot de trafic de drogue, d’armes ou de migrants, est omniprésente autour d’eux. Jusque très récemment, les zapatistes sont parvenus à la tenir à distance ; et de fait, au Mexique, il n’y a guère que la capacité d’auto-organisation et d’autodéfense des communautés indiennes qui soit en mesure de résister à la narco-violence, là où l’État a échoué dans sa guerre contre les cartels – à moins qu’il n’en ait favorisé l’essor. À cet égard pourtant, la situation au Chiapas change rapidement depuis quelques années, au point qu’on peut se demander si la pénétration de la délinquance organisée et des trafics qu’elle engendre n’est pas la plus efficace des stratégies contre-insurrectionnelles.
L’expérience zapatiste offre l’exemple d’une transformation radicale des pratiques de la justice – laquelle n’a de sens que dans la perspective plus large d’une affirmation de formes de vie autodéterminées, au sein desquelles le mot « justice » ne saurait désigner seulement les instances de résolution des « problèmes » mais suppose aussi une vie digne et bonne pour toutes et tous. C’est sans doute le sens principal que les zapatistes donnent à la notion de justice.
* * * *
Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.
Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com
* * * *
1 Pour une présentation d’ensemble, voir Jérôme Baschet, La rébellion zapatiste. Insurrection indienne et résistance planétaire, Paris, Champs-Flammarion, nouvelle édition mise à jour, 2019.
2 Dans tout ce qui suit, on se fonde essentiellement sur le travail de Paulina Fernández Christlieb, Justicia Autónoma Zapatista. Zona Selva Tzeltal, Mexico, Ediciones autónom@s, 2014. Voir aussi les quatre cahiers de la « Petite École zapatiste », Cuadernos del curso “La libertad según l@s zapatistas”, EZLN, 2013 (traduction française : http://ztrad.toile-libre.org).
3 Justicia autónoma, op. cit., p. 215.
4 https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/
5 Justicia autónoma, op. cit., p. 255-259.
6 Ibid., p. 284.
7 Ibid., p. 211 sq.
8 https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/21/le-chiapas-au-bord-de-la-guerre-civile/
9 https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/17/le-conseil-de-bon-gouvernement-hacia-la-esperanza-denonce-vigoureusement-les-paramilitaires-de-la-cioac-organises-par-les-trois-niveaux-des-mauvais-gouvernements-contre-nos-bases-d/
10 Justicia autónoma, op. cit., p. 349 sq.
11 Ibid., p. 228 sq. Bien qu’il n’y ait pas de règles strictement fixées, les mesures d’enfermement sont en général de quelques jours – une durée d’un mois constituant un cas exceptionnel.
12 Ibid., p. 249.
13 Gobierno autónomo II, Cuadernos de la Escuelita, p. 5-6.
14 Justicia autonoma, op. cit., p. 211.
15 Raoul Vaneigem, Ni pardon ni talion. La question de l’impunité dans les crimes contre l’humanité, Paris, La Découverte, 2009.
16 Justicia autónoma, op. cit., p. 351.
17 « Lettre des zapatistes aux femmes qui luttent dans le monde », février 2019 ; http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/02/21/lettre-des-zapatistes-aux-femmes-qui-se-battent-dans-le-monde/.



