L’Illibéralisme : voilà l’ennemi ?
Sur les plateaux, dans les éditos, dans les cénacles du pouvoir politique et économique, l'illibéralisme connaît un succès considérable, le terme servant à déplorer l'évolution de certains régimes politiques.
Si l'on se contente de la prime définition donnée du phénomène par l'encyclopédie participative en ligne ainsi caractérisé, l'illibéralisme est le rejet des valeurs politiques libérales. Il sévit non pas en autocratie, ni en tyrannie ou dans tout régime autoritaire mais dans une "situation démocratique"( Wikipédia). Il se manifesterait par une justice dont l'indépendance est malmenée et un État n'assurant pas la protection de ses citoyens face à ses agissements ou ceux d'acteurs privés. Bref, un pays dans lequel l'architecture même de l’État de Droit est remise en cause.
Avant d'aller plus avant deux remarques préliminaires :
- Qu'est ce qu'une "situation démocratique" où l'universalité de la loi n'est plus respectée ? Où la Justice est placée sous coupe réglée de l'exécutif et/ou du législatif ? Reformulée, l'assertion reviendrait à dire qu'il peut exister une "situation démocratique" là où l'état de droit n'est pas ou plus garanti. Affirmation qui n'est pas tenable ou qui, au mieux, désignerait un régime qui put, à un moment donné, être qualifié de "démocratique" mais désormais très engagé dans une dérive autoritaire (au point de ne plus faire respecter les droits fondamentaux)...tout en maintenant une "apparence démocratique".
- Dès lors, le régime illibéral ne s'épanouit plus en "situation" démocratique mais en "vitrine démocratique". Donc, deuxième remarque, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque des régimes "d'apparence" démocratique ? La catégorie comprendrait sans nul doute, un ensemble de pays où des élections régulières sont convoquées et assurées à peu près honnêtement, même si l'opposition ne peut pas concourir à égalité, ou si l'issue des urnes peut être contestée si elle est défavorable au pouvoir en place, même si la neutralité des commissions électorales est douteuse, etc.
Bref, des pays où les entorses au régime représentatif (compris comme le noyau dur de la démocratie) sont légion au point de questionner la loyauté de l'ensemble du processus électoral sans pour autant nécessiter l'envoi d'observateurs des Nations unies ou de l'OCDE.
Si donc il est acté que qualifier certains États de "démocratie illibérale" n'a pas de sens, comment expliquer l'usage exponentiel de ce vocable par les bouches autorisées ?
Reprenons. Si "illibéral" est le Mal, le Bien est "libéral". Donc le premier effet politique recherché par l’emploi du terme est obtenu par contraste.
Au delà de cette évidence, une nuance : si la démocratie libérale constitue le bien absolu et indiscutable de l'univers mental et médiatique de l’Occident, la "démocratie illibérale" n'est cependant pas la terminologie associée au "mal absolu". Il ne viendrait à l'esprit d'aucun de nos sachants de qualifier la Corée du Nord, l'Iran, le Venezuela ou la Chine, qui sont l'incarnation du mal absolu, de régimes illibéraux : Dictatures, systèmes totalitaires, islamistes étant les qualificatifs les plus usités pour nommer le "mal absolu".
L’illibéralisme un pêché véniel ?
Du fait de cette difficulté à les situer dans l'échelle du Mal, les régimes "illibéraux" tombent dans le purgatoire de la pensée, sorte d'antichambre entre l'absolution et l'excommunication. Bref, l'illibéralisme n'est pas idéal...mais il serait le moins pire des autres modèles politiques.
Voyons la Turquie :
La vision moyenne de ce pays par les Français peut se résumer ainsi. Pays dont l'appartenance à l'Europe est plus que douteuse, mais pays important dont il faut se méfier mais ne pas trop vexer bien que peuplé de musulmans. En langage de plateaux télé cela donne grosso modo : Etat qui, vu d'Europe est sur le fil du rasoir, perçu comme islamiste inachevé grâce à quelques garde-fous constitutionnels, certes il y a Erdogan, certes les Kurdes MAIS il y a des élections, un certain pluralisme politique, un camp laïque et surtout un membre de l'Otan. La Turquie navigue entre deux eaux, utile pour retenir les réfugiés syriens sur son sol et détestable dans son retour au culte musulman de Sainte Sophie, acceptable comme intermédiaire russo-ukrainienne, haïssable dans son soutien à l’Azerbaïdjan contre l’Arménie chrétienne…La Turquie, à l'instar de l'Union indienne, est une incarnation quasi parfaite des régimes illibéraux extra européens.
La Russie poutinienne est un autre cas d'espèce. Le qualificatif d'illibéral a pu lui être accolé avant 2022. Les contorsions et modifications constitutionnelles visant à établir une véritable autocratie élective n'avaient pas suffi à la faire basculer dans la "dictature" au moins avant 2014. En 2018, peu, si ce n'est aucun pays n'avait envisagé un boycott de la coupe du monde de football, les différents chefs d'Etat avaient auparavant également eu l'occasion de se rendre aux jeux olympiques d'hiver de Sotchi 4 ans plus tôt. Mais l'invasion de l'Ukraine qui provoque un bannissement des relations internationales avec l'Occident a provoqué, chez nos fins limiers, un basculement du régime dans la catégorie "dictature".
Par effet miroir, le cas de la Pologne est des plus révélateurs. A l’instar de la Hongrie, la Pologne a été affublée de 2015 à 2022 du titre de régime illibéral. Mais, à l’inverse de Poutine, elle s'en est aujourd’hui débarrassée. Cela signifie-t-il que le régime se serait (re)libéralisé ? Malgré quelques concessions du gouvernement polonais sur sa "réforme" (l'idée même de réforme subjugue les libéraux attitrés) de la Justice et les faibles amendes infligées par l’Union européenne, la normalisation du régime polonais doit beaucoup à sa position de soutien inconditionnel à l’Ukraine, à l’accueil de ses réfugiés et aux livraisons d’armes offensives à Kiev. Que cette attitude s’explique d’abord par russophobie que par amitié réelle avec l’Ukraine importe guère. Toujours est-il que, bien que la nature du régime polonais n’ait pas varié d’un iota, la voici subrepticement redevenue tout à fait fréquentable.
Dernier cas, le plus emblématique de la catégorie illibérale est, sans conteste possible, la Hongrie. Dirigée depuis 2010 par V. Orban au mépris des minorités nationales, des droits constitutionnels, des immigrés, mise au pas de la justice, droits de l'opposition rognés et de tant d'autres principes fondamentaux de la démocratie libérale. Hormis la tenue d'élection et de lambeaux de société civile, la Hongrie entretient un rapport très lointain avec ce que l'on peut appeler décemment une démocratie. Malgré cela, l'Union européenne n'est toujours pas parvenue à statuer sur son cas (en dépit du déclenchement du recours à l'article 7 qui peut priver le pays de l'exercice du droit de vote au sein des institutions européennes). Pas ou très faiblement sanctionnée mais toujours rangée comme illibérale car pro-russe, la Hongrie n’en reste pas moins un partenaire européen, Etat membre de plein droit de l’Union. Hormis les questions de libre circulation des personnes, elle applique et participe à l'ensemble des politiques communes européennes. On y revient donc, pour les Européens l'illibéralisme est un mal acceptable avec lequel on peut continuer à traiter, qu'il soit turc ou hongrois. Rappelons tout de même ici que pour postuler à l'entrée dans l'Union les critères de Copenhague posent comme condition préalable à l'ouverture de négociations d'adhésion que le régime politique du candidat soit démocratique.
L'illibéralisme qualifie donc exclusivement des pays qui, bien que notoirement très éloignés de ce que l'on peut appeler démocratie, ont su/pu entretenir quelques liens puissant avec le camp "occidental" (Otan dans le cas turc, UE pour la Hongrie, Pologne et Italie).
Notons aussi que l'illibéralisme a pu renouveler un registre : définitivement trop vague et désormais obsolète le "populisme" qui, jusqu'à peu, pouvait aussi bien qualifier Trump que Chavez a disparu des radars médiatiques même s'il peut rester utile pour rassembler Mélechon et Le Pen sous une même bannière, quoique la bannière de Mélenchon soit désormais bien moins "républicaine" que celle de Le Pen si l'on se fie à la doxa médiatico-politique française.
L’illibéralisme lave-t-il plus blanc ?
Comment expliquer que le camp du Bien démocrate-libéral accepte de passer sous les fourches caudines en transigeant avec l'illibéralisme ?
Pour le comprendre, appuyons nous sur le discours libéral français au sujet de l’actualité italienne, dirigée par une neo-fasciste assumée et identifiée comme telle, G. Meloni. Son arrivée à la tête du pays en octobre 2022, n’a pas provoqué de vaste réprobation de la part des libéraux européens comme ils ont pu le faire par le passé pour l’élection d’Orban voire celle de Trump. La raison ? En dépit de son obédience partisane, la présidente du conseil des ministres italien avait mis beaucoup d’eau dans son vin nationaliste et europhobe. La sortie de l’union monétaire, du cadre budgétaire ou de certaines politiques communes avaient en effet été discrètement remisés au placard durant sa campagne électorale. La menace éco-financière levée, l’inscription du nouveau gouvernement italien dans le cercle du respectable allait de soi.Méloni s'est orbanisée en quelque sorte avant même d'arriver au pouvoir. Dans le cénacles bruxellois comme à Francfort, on pouvait souffler. On a gardé Orban, on peut continuer avec Meloni.
6 mois d’exercice du pouvoir plus tard l’opinion libérale cherche à tracer le bilan du gouvernement dirigée par une fasciste mais dont les cordons de la Bourse restent tenus par la Droite propre sur elle et néolibérale (Giancarlo Giorgetti, ministre des finances est un libéral européen convaincu, membre de la Ligue du Nord, totalement normalisée sur la scène politique nationale et européenne quoique d'inspiration elle aussi fasciste ). Il s'agit donc de savoir dans quelle catégorie ranger le régime Meloni ? Pour le très (neo) libéral institut Montaigne, sous la plume de Marc Lazar, on s’interroge logiquement sur une «présidence « normale » de G. Meloni.

Agrandissement : Illustration 1
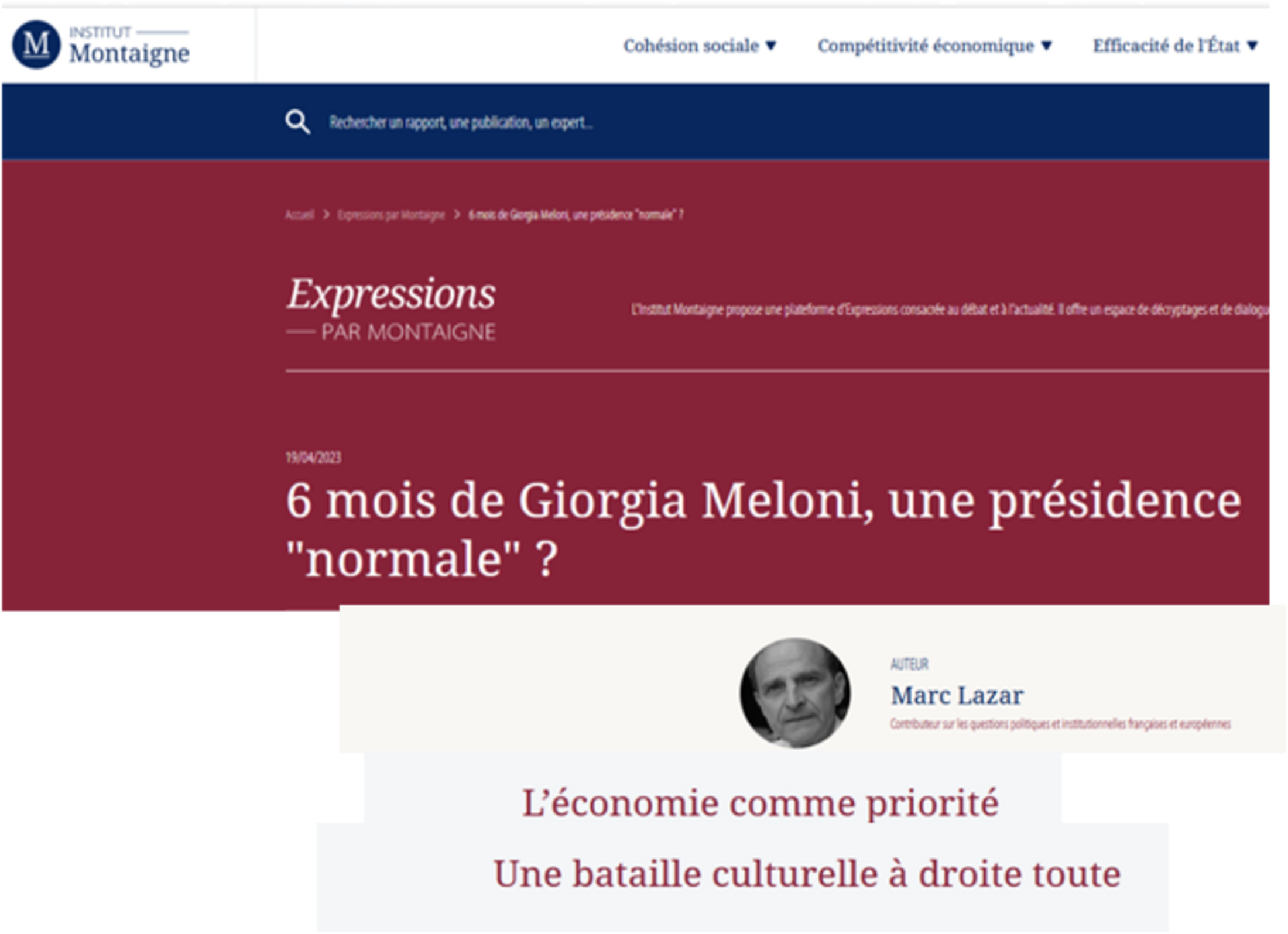
Normalisation du néo-fascisme donc. Car après tout, les intertitres démontrent qu’elle remplit fidèlement sa feuille de route en plaçant « l’économie (selon les standards néolibéraux) comme priorité » notamment en supprimant le 1er mai ! l’équivalent du RSA français. Ensuite, malgré une politique culturelle « à droite toute » (durcissement des lois migratoires, politique notoirement anti minorités sexuelles et anti féministes), l’enjeu véritable se situe selon l’auteur dans la capacité de Giorgia Meloni à « relever les grands défis structurels auxquels le pays fait face » malgré sa « coupable discrétion » sur le sujet du réchauffement climatique. Rien que du très normal donc. Catégorie peut mieux faire.
Pour Les Echos, l’engagement de la « réforme constitutionnelle », qui vise à présidentialiser le régime parlementaire italien réveille des « craintes d’une dérive populiste et autoritaire ». Si toutefois elle apporte de la stabilité institutionnelle, cette "réforme" (encore elle) sera la bienvenue et les craintes infondées. La dérive bonapartiste se justifie dans la mesure où elle maintient l’ordre établi ou mieux qu'elle le renforce, plans d'austérité budgétaire toujours bienvenus.

La magie des « réformes » opère encore chez les libéraux si elles visent à maintenir l'ordre. "Ordre", autre mot qui connaît une inflation grandissante également par les mêmes bouches qui emploient "illibéral" au passage. Pourtant ce mot n'appartient pas (ou ne devrait pas appartenir) au registre "libéral", qui est forgé concomitamment à deux immenses "désordres" que furent la Révolution française et l'industrialisation. Bref revenons à l'Italie et au projet de refonte institutionnelle que la Présidente du conseil envisage de mener et apprécions la différence de traitement de la même actualité par les magazines italiens non foncièrement libéraux, orientés à gauche : Meloni cherche à « obtenir les « pleins pouvoirs » comme Orban en Hongrie […] afin de passer par-dessus le Parlement [pour dissimuler] son échec à surmonter la crise économique et sociale profonde du pays. » Pour MicroMega aucun doute, on est dans une dérive autocratique et nullement dans un régime potentiellement illibéral.

Cependant les développements récents de la politique méloniste finissent tout de même par gêner les entournures des libéraux patentés, contraints, à regret, de reconnaître une « première croisade illibérale » qu’il s’agit de stopper : la cheffe de gouvernement italien attaque ainsi, au delà du raisonnable, les « familles homoparentales » italiennes.

Le talent et la popularité de G. Meloni en Italie comme en Europe consiste donc à être parvenue à échapper à l’infamie du qualificatif néo fasciste à celui plus propret d’illibéral qu'on hésite encore à lui accoler, tout en menant une politique résolument…fasciste. L’Italie est donc le prochain domino à tomber officiellement dans l’escarcelle des « illibéraux » tandis que la France la suivra de près…sans que cela ne heurte outre mesure ceux qui feignent de s'en affoler au nom de l'Europe et plus rarement de la démocratie italienne.
L’illibéralisme comme deus ex machina
Un pouvoir concentré, des inégalités sociales, juridiques et politiques accentuées, un appareil policier sans cesse renforcé, des politiques ségrégatives envers les composantes minoritaires de la population (immigrés, homosexuels, pauvres…), de forts relents islamophobes, un nationalisme pour tout viatique… c’est ennuyeux pour les libéraux, mais si le tout est accompagné d’une politique économique conforme aux standards néolibéraux (L’argent public pour soutenir les activités privées de manière à garantir des taux de rentabilité actionnariale suffisants ) et d'un discours européiste à leur attention, tout ceci ne constitue pas une raison suffisante pour froisser les liens amicaux que le "régime illibéral" entretient avec ses partenaires européens. Le maintien de l’ordre socio-économique (intérieur et européen) et des intérêts financiers (intérieurs et européens aussi) étant la tâche prioritaire affectée aux pouvoirs politiques par les libéraux. C’est ainsi qu’ils ont agi avec Mussolini, Franco, Salazar et Hitler aussi longtemps qu’ils le purent.
L’illibéralisme n’est donc pas l’ennemi des libéraux. Il est leur recours : en cas d’incapacité politique de faire accepter à leur population des « réformes » antisociales, les libéraux autoproclamés au pouvoir et leurs relais d’opinion n’ont d’autre solution que la répression policière, la concentration des pouvoirs et une voie de transmission hiérarchique sans cesse plus courte.
Examinons brièvement ces trois outils : la répression policière est vendue comme une nécessité face au risque de désordre (attaque contre la démocratie sociale). La concentration des pouvoirs est vendue comme un gage d'efficacité face notamment à des débats inutiles et stériles au Parlement (attaque de la démocratie parlementaire). Enfin la négligence des hiérarchies intermédiaires comme l'inversion de la hiérarchie du droit garantiraient la rapidité d'exécution là où elles amènent à la confusion juridique et à l'incapacité d'interpréter la loi. (attaque de l'Etat de droit)
Autrement dit la négation de la démocratie sociale jusqu’à son humiliation (des syndicats, des associations de spécialistes, ou d’expertise ainsi que des corps administratifs intermédiaires). Enfin, tendanciellement, les régimes illibéraux favorisent l’affaiblissement institutionnel de l’opposition politique (accès aux médias plus difficile, excommunication de l’arc ou du champ républicain désormais applicable qu’à « l’extrême gauche », (en réalité la Gauche), procédures juridiques bâillon, pratique du lawfare, criminalisation de la contestation…).
Dans ces conditions, les biais du jeu électoral deviennent béants, tandis que les campagnes qui le précèdent sont escamotées par une dramaturgie exponentielle du « la continuité ou le chaos ». C’est que dans un premier temps pour les illibéraux, il convient de pouvoir se parer des atours de la « légitimité des urnes ». D'ailleurs, quatrième mot toujours plus couramment usité par les libéraux (après "illibéralisme", "réforme"et"ordre") la légitimité des urnes est d'autant plus fortement rappelée au bon citoyen qu'elle est devenue contestable tant dans son obtention (condition de campagne) que dans son résultat final (loin d'être une victoire d'adhésion) ou dans la pratique du pouvoir (objectivement dirigée contre la majorité de la population qui l'a porté au pouvoir).
Ainsi donc, les autoproclamés libéraux qui nous gouvernent décident-ils qu'à un moment donné, il faut qu’une autorité (libérale au pouvoir) signe la fin des débats (démocratiques). Et pour ce faire, le Parlement, la rue, ou 70% de la population doivent être réduits au silence. Pour nos libéraux contemporains, la démocratie des uns (gouvernés) s’arrête là où commence la démocratie des autres celle des gouvernants et des décideurs économiques main dans la main. Or, cette cosanguinité entre les premiers et les seconds, cette alliance renforcée, cette confusion des pouvoirs politiques et économiques, l’illibéralisme ne les menace aucunement. Et s'ils sont en difficulté pourquoi ne pas y sauter à pieds joints ?
Puisque les libéraux sont libres échangistes avant tout et non démocrates par dessus tout, leur ennemi ne peut être la finance quand bien même le proclameraient-ils. S’ils doivent choisir entre les libertés politiques et les libertés de la finance, lesquelles choisiraient-ils ? L’épaisseur de leur portefeuille peut donner une idée.
Le petit entrepreneur et le préfet annonceront que la comptabilité de la PME et l’ordre dans la rue valent bien une messe illibérale
TOTAL et BNP estimeront que leurs principaux actionnaires valent bien une cure illibérale
WALL STREET admettra volontiers qu’une purge illibérale serait bien peu de choses pour sauver le Dow Jones et le Nasdaq.
Cela vaut pour tous les pays européens et américains dont la démocratie-libérale-représentative est fragilisée. En France, cela se traduit par mieux vaut le Pen que LFI. La première est une adversaire respectable des libéraux quand les Insoumis incarnent l’ennemi à abattre, de moins en moins au figuré, à l'heure où on interdit des casserolades et qu’on permet aux néonazis de défiler en toute quiétude sur le pavé parisien.
Apprendre à aimer l’illibéralisme
L’illibéralisme n'est rien d'autre qu'un néolibéralisme autoritaire, mâtiné de christianisme réactionnaire et de xénophobie islamophobe (et parfois antisémite). En Europe, n'est illibéral que celui qui, a des tendances europhobes ou eurosceptiques en sus.
L’illibéralisme est donc le mot des libéraux pour qualifier ce qu’en sciences sociales, historiques ou politiques, l’on intègre dans les variantes de fascisme. Car comment qualifier autrement un régime autoritaire, doté d'un chef unique,qui criminalise l'opposition, réduit la liberté d'expression dès ses débuts, instaure un état policier et cherche à militariser la société tout en préservant les intérêts capitalistiques ? La seule nuance entre l'illibéralisme et le fascisme "pur" est la suivante : le nationalisme doit être troqué par un européisme de bon aloi.
Près d'un siècle après la seconde guerre mondiale, les prétendus libéraux savent que le souvenir s'émousse, d'autant que ce sont eux qui narrent l'Histoire. Il est donc possible de jouer franc jeu :
D’abord faire de l'illibéralisme-fascisme un adversaire et non plus l'ennemi. Ensuite le rendre acceptable à la population sur le mode du : « ce n’est pas idéal (mais c’est à cause de vous), et de toute façon, there is no alternative. Comprenons nous bien, ânonneront-ils d’ici peu, nous n’avons d’autre possibilité que celle du pis-aller » Le rendre désirable enfin, en vendant comme issue de secours populaire, l’assurance vie de l’oligarchie.
****
Addendum 1: le cas allemand.
Réputée libérale, l'Allemagne a néanmoins su, dans une certaine mesure, profiter de la mondialisation néolibérale en préservant une structure industrielle détenue par des capitaux nationaux. L'ordo-libéralisme d'outre Rhin, est un alliage entre des principes de rigueur d'airain budgétaire ( face au spectre de l hyperinflation) et une capacité à entretenir une puissance exportatrice dans certains secteurs industriels ( automobile, machines outils...) Sur les plans des libertés publiques et institutionnels, le parlementarisme libéral est indiscutable. Le succès du modèle allemand sur le plan économique se nourrit partiellement au moins des difficultés rencontrées par les autres grandes économies européennes comme de la délocalisation intérieure vers l'Europe centrale et orientale. Ainsi, la réussite éclatante de l'Allemagne dans un environnement déprimé accentue le ressentiment des voisins, obligés de serrer les vis budgétaires sans résultats probants, provoquant colère et résignation dans leurs populations respectives. Prémunie pour l'heure de toute tentation illibérale, l'Allemagne n'en est donc pas moins un de ses vecteurs de développement sur le vieux Continent.
****
Addendum 2 : Où se situent les libéraux européens sur l'échiquier politique ?
Eux ne se posent pas la question, ils s'auto-situent résolument parmi les modérés, aussi proches que possible d'un introuvable centre. Selon eux, ce positionnement est un gage d'objectivité, de pondération et de sérieux. Ils cherchent à incarner une continuité réformiste, censée rassurer les populations ( en fait les marchés). Ils ont la certitude de détenir la Vérité en toutes choses et, par leur sagesse, capables de naviguer entre Charybde et Scylla. Hors d'eux, ne braillent que des variantes "d'extrémistes" ou de "radicalisés" au mieux échevelés au pire terroristes. Il n'y a donc qu'une voie raisonnable qui ne peut échouer à emporter l'adhésion universelle qu'en raison d'une pédagogie inefficace auprès de leurs ouailles ( comprendre :en raison de la bêtise du peuple). Si donc, la pédagogie a été insuffisante, il faut "avoir le courage de l'impopularité et savoir trancher dans le vif". Ainsi, les libéraux sont-ils, selon plusieurs enquêtes, la famille politique la moins attachée... à la démocratie puisqu'ils s'estiment capables de faire le bien du peuple sans son approbation. C'est peu ou prou "l'extrême centre" développé notamment par Pierre Serna.
****



