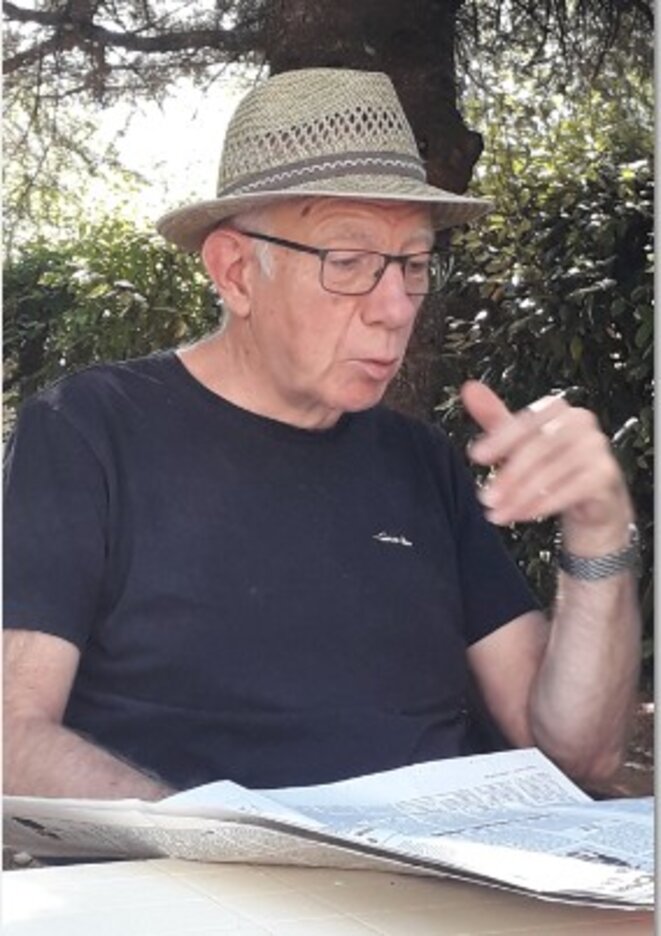La distinction entre la notion de réfugiés et de migrants économiques n’est pas si triviale, si ce n’est au sens juridique donné par la Convention de Genève : l’asile s’applique à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Exit donc, dans cette définition, les « migrants économiques ».
Mais la distinction entre celles et ceux qui « méritent » l’asile et les autres est-elle pertinente ?
Selon les mots de Macron, il faut éviter « à des femmes et des hommes de prendre des risques inconsidérés dans une zone extrêmement dangereuse, puis en Méditerranée ».
Si on considère cette notion de « risques inconsidérés » et qu’on l’applique aux conditions de vie et de travail de ces personnes dans leurs pays d’origine, il y a de quoi dire !
Prenons quelques exemples :
- les mineurs d’or ou de toute autre matière précieuse. Ces produits (or, terres rares, diamants) sont essentiels pour les industries électroniques ou du luxe. Les personnes qui les extraient sont soumis à des risques d’effondrement, de maladie professionnelles, de violences maffieuses.
- Les paysan-ne-s chassé-e-s de leur terre par leur Etat au profit de multinationales de l’agro-alimentaire ou encore pris à la gorge par les produits phytosanitaires et les semences OGM de ces multinationales.
- Les pêcheurs dont les prises se raréfient dramatiquement à cause de la sur-pêche pratiquée au large de leurs côtes par des chalutiers géants affrétés par des compagnie du Nord.
- Les prolétaires des usines du Sud (dont des enfants) au temps de travail (in) digne du XIXème siècle et touchant un salaire qui leur permet à peine de survivre.
- Les gens victimes de pollution en lien avec l’extraction ou la transformation des matières premières (voir comment le delta du Niger est pollué par le pétrole, voir comment le Niger est pollué par l’extraction d’uranium par Areva) ou encore par les déchets des pays du Nord.
Il s’agit bien de personnes plongées dans l’économie mondialisée, avec des conditions de travail et de salaire indécentes. Celles qui auraient l’idée de contester ou revendiquer sont régulièrement réprimées (voir la difficulté à s’organiser en syndicats ou associations dans ces pays, avec de nombreux assassinats de syndicalistes, d’écologistes par des milices patronales ou les forces gouvernementales).
Le problème est ici l’extrême inégalité dans les rémunérations et les protections. Outre l’exploitation des personnes, le problème est aussi le partage de la valeur ajoutée entre entreprises du Nord et du Sud. D’un côté, les firmes du Nord prennent des marges importantes, tandis que leur homologues du Sud ne touchent pas beaucoup (on pourrait en dire autant en France où les firmes du CAC 40 ramassent la mise, au détriment des entreprises sous-traitantes qu’elles fragilisent par leurs politiques d’achat, tout en accusant, par l’intermédiaire du Medef, le Code du travail d’être à l’origine des difficultés des PME/TPE).
Macron, au lieu d’énoncer qu’il veut « éviter aux gens de prendre des risques inconsidérés en Méditerranée… ‘gnagnagnagna’… » serait bien avisé de déclarer qu’il veut « éviter aux gens de prendre des risques inconsidérés dans des travaux dangereux, voire toxiques » et qu’il entend prendre sa part dans des rapports Nord-Sud plus justes. Mais ça, c’est juste de la politique fiction. Les peuples du Sud n’ont rien à attendre de ce bonhomme et des classes sociales qu’il représente : il leur reste à présenter des revendications et un rapport de forces.
Les problèmes économiques des pays du Sud et les difficultés de leurs populations sont bien une question politique globale, dont les migrations sont un symptôme. L’ouverture des frontières, si elle ne résout pas tout, permettrait de manière simple et juste d’éviter « à des femmes et des hommes de prendre des risques inconsidérés… ».