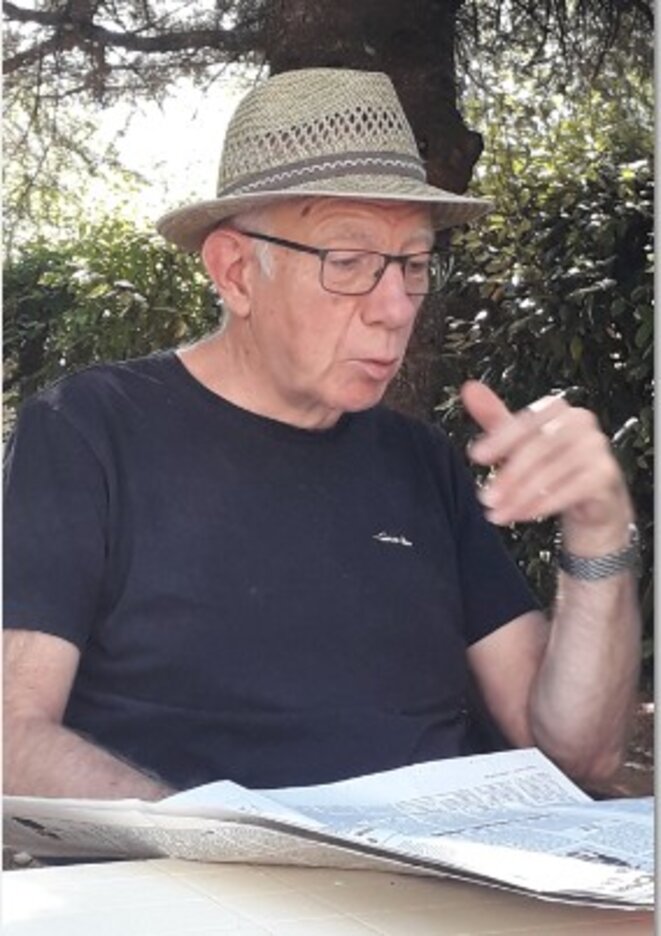Guerres internationales et populations en insécurité :
Au delà du conflit en Ukraine, des sales guerres, des coups d'État ou des répressions sanglantes ont lieu partout dans le monde et les populations civiles sont décimées ou du moins en insécurité.
Avec le conflit en Ukraine, grand exportateur de blé, l'insécurité alimentaire est ou va être importante.
Parmi les guerres en cours en ce début 2022, notons le conflit entre les forces armées d'Ethiopie et la province du Tigré, le conflit au Yémen mené par les monarchies du Golfe Persique, la paix impossible en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Sud-Soudan, dans les pays du Sahel, en Birmanie, au Congo.
On note aussi des tensions entre le Maroc et l'Algérie.
Et toujours l'influence de forces impérialistes, de marchands d'armes, de multinationales minières, comme au Yémen, en Libye ou dans les pays du Sahel.
Global Peace Index: le palmarès de la paix et de la sécurité pays par pays :
L'Institute for Economics and Peace (basé à Sydney en Australie), plutôt libéral dans son genre (en gros, il compare les niveaux d'insécurité de pays afin d'orienter les investissements ou les voyages organisés, ce qu'on appelle du benchmarking en franglish), établit chaque année un index de l'insécurité dans le monde, avec trois grands indicateurs : les conflits internes et internationaux, la sécurité et l’insécurité dans la société et la militarisation du pays. On y trouve par exemple outre les pays précités, l'Afrique Du Sud, le Nigéria, la Zambie, la Namibie, le Brésil, le Mexique, le Vénézuéla, le Liban, la Russie, la République centrafricaine. Mieux vaut vivre en Islande ou en Nouvelle-Zélande, au Danemark (j'y reviendrai dans un prochain article) ou au Portugal, si on se réfère à cet index (données de 2019), https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index
Dans l'indice 2019, pour l'Afrique, Botswana, Malawi, Tanzanie, Ghana, Sénégal sont les mieux classés, mieux que les Etats-Unis et la France (60ème en 2019, 55ème en 2021). Pour la France, est-ce lié aux nombreux blessés dans les manifestations de Gilets Jaunes, aux violences policières dans les quartiers, à la situation dans les départements d'outre-mer, aux féminicides, à la violence dans les milieux de la drogue ou les opérations militaires au Sahel au nom de l'antiterrorisme ? En fait,il semble surtout que ce classement est déduit du fait que la France est un gros exportateur d'armements et surtout dispose d'armes nucléaires.
Selon cet institut, en 2020, « l’impact annuel de la violence est estimé par le GPI à la somme colossale de 15 000 milliards de dollars, soit 11,6 % du PIB mondial. Les dépenses militaires représentent 43 % de ce montant total, la sécurité internationale 31 % et la sécurité privée près de 8 %, le reste se répartissant entre les conflits (3 %), les crimes violents (3,1 %) et les homicides (7 %) ».
Même si ce discours mêlant sécurité des personnes et sécurité des affaires est agaçant, on se rend compte de l'état du monde et depuis 2020, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Par contre, ce que cet institut ne met pas en exergue, c'est le caractère « policé » ou policier de certains États. Par exemple, Singapour (7ème) ou la Malaisie (16ème) arrivent en bonne place, mais ce sont des États relativement policiers, mais aussi économiquement stables. Et la Chine, si elle arrive en 110ème position, c'est plus par rapport à sa relation avec ses minorités, ouïghoures ou tibétaines. Mais le contrôle social qu'elle inflige à sa population au travers du « crédit social » serait peu pris en compte.
Quant aux nombreux migrants périssant durant leur périple, on ne sait pas, à partir de cet indice, à quel pays leur décès est imputé, le pays d'origine ou le pays souhaité. En fait, ce sont la totalité des pays européens qui devraient chuter dans l'indice s'il prenait ce fait en compte. Car la violence institutionnelle n'est pas prise en compte dans ce palmarès, par exemple le fait de refuser un visa à des personnes, qui les amène à prendre tous les risques pour faire une traversée, alors qu'un voyage en bateau ou en avion serait bien plus sûr.
En résumé, il est difficile de jauger le niveau de violence d'un État à l'autre, alors que la violence a aussi un lien avec des rapports de domination entre les États, ceux-ci ne se traduisant pas toujours par une violence formelle, mais par une violence plus feutrée. Ainsi, les plans d'ajustements structurels imposés par le FMI (Fonds monétaire international) ou la « gestion » de la dette par des créanciers sont bien des facteurs de violence, car ils se concluent par des politiques d'austérité qui sèment la misère dans de nombreuses populations.
Il convient alors de rappeler un bon vieux principe : sans paix, pas de justice, mais sans justice, pas de paix.